— Par Jean-Marie Nol, économiste —
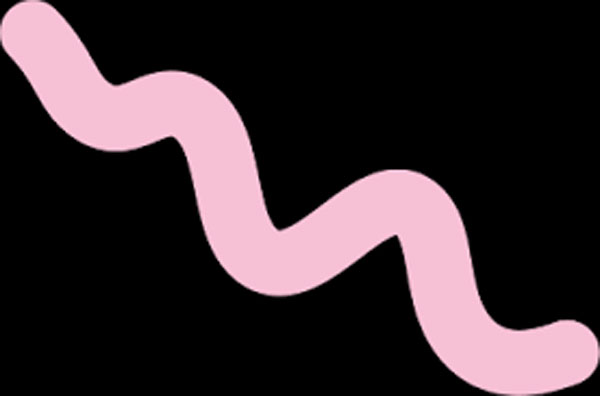
Avec la crise inflationniste et l’instabilité géopolitique mondiale actuelle , nous sommes à un tournant par rapport aux trente dernières années. En France comme dans le monde, ce sont les enjeux politiques et climatiques qui domineront, davantage que l’économie.
Nous nous plaisons à penser que le monde a gagné en humanisme car il fait passer la politique avant l’économie et c’est une première. Mais, est-ce là la vérité ? Ou est-ce tout bonnement un faux semblant du pouvoir ?
Les enjeux économiques vont -t – ils bientôt reprendre la main sur la politique ?
A notre avis pour ce qui concerne la Martinique et la Guadeloupe, l’avantage du politique sur l’économie va bientôt tourner en trompe-l’œil.
Au lieu d’anticiper et de prévenir, nos décideurs politiques locaux s’emploient à guérir les maux qui touchent les classes sociales les plus fragiles. L’intention est louable mais ne s’attaque pas au fond du problème, car dans un contexte économique où s’envolent non seulement le prix des carburants mais également ceux des produits de consommation courante, l’inquiétude est surtout grandissante au sein de la classe moyenne déjà fortement en prise avec une fiscalité confiscatoire. Toute tentative politique de rattrapage du mal développement de la Martinique et de la un Guadeloupe par le statut d’autonomie, va nécessairement impliquer un coût financier pour la collectivité. Il est donc nécessaire que les pouvoirs publics nationaux et locaux l’explicitent à la population des Antilles.
Nous surestimons les probabilités de vivre des évènements heureux au cours de la vie et sous-évaluons les probabilités d’en vivre de mauvais. C’est à la fois avantageux et dangereux, puisque ce biais nous conduit à moins évaluer les risques politiques et économiques d’une situation de crise. De façon paradoxale, c’est davantage participant d’un déni du réel, le ressenti de l’absence de risques avérés, voire de la disparition de toute menace qui prévaut et qui va imprégner les esprits des élites politiques, de la technostructure et des intellectuels. Et par voie de conséquence, celle des masses qui, en retour, vont imposer aux dirigeants le primat de la satisfaction de l’instantané. En retour, les politiques locaux vont brandir l’étendard du changement de statut comme étant la panacée de nature à résoudre tous les problèmes de la Martinique et la Guadeloupe, notamment le mal être identitaire et le mal développement économique.
A ceux qui penseraient que l’on suscite la peur du changement de statut, et qu’il n’est rien de nouveau sous le soleil, il est conseillé de se replonger dans l’histoire de la première République noire, Haïti, pour comprendre comment l’économie peut supplanter la politique et le secteur bancaire jouer un rôle néfaste déterminant dans la vie d’un pays.
L’indépendance est proclamée en Haïti en 1804. Mais le conflit avec la France n’est soldé qu’en 1825, quand le roi Charles X accepte de reconnaître Haïti contre une importante somme d’argent. Donc, bien que Haïti fut la première nation moderne à obtenir son indépendance grâce à une révolte d’esclaves, son développement économique a été sans cesse entravée financièrement sur plusieurs générations par les réparations exigées au bénéfice des anciens colons français. En déclarant son indépendance le 1er janvier 1804, Haïti s’est donc retrouvé au ban des nations d’un monde alors dominé par les puissances esclavagistes. Les paiements exigés par la France ont autant privé l’économie haïtienne de ressources vitales à son essor qu’ils ont permis à son ancienne métropole de prospérer.
Cette histoire, c’est celle de « la rançon de l’indépendance » – expression utilisée par François Hollande en 2015 – payée par Haïti à la France de 1825 au début des années 1950 pour indemniser les propriétaires esclavagistes ; et l’implication, jusqu’à présent méconnue, du Crédit industriel et commercial (CIC), aujourd’hui filiale du Crédit mutuel. Plusieurs articles parus dans le New York Times ont retracé comment le C.I.C. a créé et géré la Banque nationale d’Haïti à partir de Paris. Les dossiers découverts par les enquêteurs montrent qu’elle n’a fait aucun investissement dans les entreprises haïtiennes et a facturé des frais sur presque toutes les transactions effectuées par le gouvernement haïtien.
La Banque Nationale d’Haïti, sur laquelle tant d’espoirs étaient fondés, n’avait en fait de nationale que le nom. Loin d’être la clé du salut du pays, la banque a été, dès sa création, un instrument aux mains de financiers français et un moyen de garder une mainmise asphyxiante sur l’ancienne colonie jusqu’au 20e siècle.
Derrière cette banque fantoche, on retrouve un nom bien connu des Français : le Crédit Industriel et Commercial (CIC).
Alors qu’à Paris, le CIC participe au financement de la tour Eiffel, symbole de l’universalisme français, il étouffe au même moment l’économie haïtienne en rapatriant en France une grande parties des revenus publics du pays, au lieu de les investir dans la construction d’écoles, d’hôpitaux et autres institutions essentielles à toute nation indépendante.
À un moment donné, Haïti a affecté environ la moitié de sa source de revenus la plus importante – les taxes sur le café – au paiement du C.I.C. et ses investisseurs dans la Banque Nationale.
En 1875, Haïti a déjà réglé une grande partie de sa « dette », dont le poids a parfois dépassé 40 % de ses recettes annuelles. Elle a plongé sa population dans la misère, un mot sur toutes les lèvres quand on évoque le pays le plus pauvre de l’hémisphère Nord. Cette série d’articles du New York Times publiés récemment remet en lumière la tragique histoire de l’indépendance d’Haïti et la dette astronomique que le pays a dû payer à la France au 19e siècle, un sujet peu connu à ce jour. Après plusieurs mois d’analyse d’archives, le journal américain a estimé que les paiements, versés à compter de 1825 par la première république noire de l’histoire, pour indemniser les anciens colons esclavagistes, «ont coûté au développement économique d’Haïti entre 21 et 115 milliards de dollars de pertes sur deux siècles, soit une à huit fois le produit intérieur brut du pays en 2020.» Comme l’Etat français, la banque a sciemment privé la première république noire de l’histoire des moyens d’investir dans l’éducation, la santé et les infrastructures porteuses de développement, et de s’insérer ainsi dans l’économie mondiale. Le résultat de ce désastre financier imputable à une mainmise de type capitaliste et néo coloniale est sans appel.
Haïti est aujourd’hui l’un des pays les moins développés au monde, avec un taux de chômage variant de 50 à 80 %. Sur une population estimée à 10,85 millions d’habitants, 80 % des personnes vivent sous le seuil de pauvreté et 44% sous le seuil de pauvreté extrême.
La leçon à tirer de cette histoire tragique d’Haïti est la possible prédominance des faits économiques sur l’action politique au cours d’une période donnée, et la sous estimation des rapports de force. Le rapport de force est un piège qui produit dans les relations internationales une escalade de violence – qu’elle soit de nature morale, économique, ou militaire – fortement toxique et destructive, car dès qu’elle vous aspire, elle vous prive de discernement.
Il se caractérise par une relation dominant-dominé et se résume à une logique binaire : la loi du plus fort.
C’est cette absence de discernement et la sous estimation des rapports de force par Toussaint Louverture qui ont plongé Haïti dans le chaos.
La deuxième leçon est que de tous temps,le nerf du développement d’un pays, passe obligatoirement par la maîtrise du secteur financier et bancaire, or les martiniquais et Guadeloupéens ne contrôlent plus aucune banque dans leurs pays. Tous les leviers du pouvoir bancaire et financier sont localisés à Paris. De fait, c’est l’impuissance qui est courrue d’avance, même en obtenant le levier de la fiscalité avec un changement statutaire. C’est la raison pour laquelle je plaide pour une action forte d’abord sur le modèle économique et social. Ensuite cela n’exclut nullement un changement des institutions et d’ailleurs même si la réforme avait lieu demain avec l’assentiment du peuple, la mise en œuvre effective prendrait au moins 10 ans. Alors entre-temps que fait on?
De fait, mes divergences avec les tenants de l’autonomie portent pour l’essentiel sur la problématique de la temporalité. Oui, je réitère que le temps de la politique n’est pas celui de l’économie. Chaque individu possède son propre rapport au temps. Et notre construction psychologique en est en partie responsable. La façon de dire le thème des changements permanents qui touchent aujourd’hui la société antillaise nous interpelle finalement en ce qu’elle n’apparaît pas propre à une catégorie spécifique de problèmes d’ordre idéologique purement identitaires, mais se repère à de multiples niveaux de responsabilités dans l’organisation économique et sociale de notre modèle de société. Le contexte de changement permanent de la société antillaise doit être impérativement relié à l’influence de la mutation de la société française. C’est en ce sens que j’ai précédemment écrit que l’État français n’est autre dans cette affaire d’évolution institutionnelle que le maître de l’échiquier et le président Macron le maître des horloges. Aussi les mises en récit, de la notion d’autonomie doivent être soumises à une temporalité plus cyclique, vécue et dite non plus sur un mode affectif, émotionnel, et idéologique passéiste au sens phénoménologique du terme, mais sous l’angle de la prédominance de l’économie sur le politique. La crise inflationniste actuelle, et bientôt financière, dont nous sous-estimons gravement les futures conséquences financières, vraisemblablement très fâcheuses pour les citoyens, les entreprises, et les collectivités locales permet de penser ces difficultés de nature macroéconomique de façon originale en liant les notions de temps, d’action et de discours. En rapprochant la perspective de grande crise mondiale avec ce qui se passe aujourd’hui dans l’organisation des institutions de la Guadeloupe et la Martinique, nous proposons l’hypothèse suivante : les acteurs politiques ne pourraient plus, dans un contexte de changement du statut, considérer leurs actions à partir de ressources typifiantes et donc ne pourraient plus les situer sur un axe temporel distinguant clairement un « avant » et un « après ». Ils se retrouveraient de ce fait plongés dans une situation de dépendance financière qu’ils ne parviendraient pas à maîtriser, et surtout dans un temps qu’ils ne parviendraient plus à organiser discursivement : le futur comme le passé ne seraient plus lisibles, et les expériences en matière d’effet de levier des compétences élargies se succéderaient sans résultats tangibles, et sans qu’aucun fil conducteur d’une meilleure visibilité de l’avenir (si ce n’est celui de la crise de trésorerie permanente) ne puisse être trouvé par le politique, que ce soit par anticipation ou par rétrospection.
Pour ce qui nous concerne, nous souhaitons nous concentrer sur quelques questions qui nous paraissent essentielles. La prudence nous semble nécessaire, tant en termes de méthode que de pistes théoriques explicatives des bénéfices à opérer un changement de statut. Il faut en effet se garder des « précipitations » théoriques, si elles sont données comme définitives et non comme de simples et stimulantes hypothèses pour temps changeants. Je préfère y voir autant de pistes qui témoignent de l’heureuse vivacité du débat pour changer la donne, en même temps qu’elles attestent de l’importance prise par l’analyse sous un nouvel angle économique et financier.
« Mieux vaut combattre le pire que rêver perpétuellement du meilleur »
En ce qui me concerne, j’ai jugé nécessaire d’apporter mon éclairage personnel en fonction de mon statut d’économiste, certes marginal, j’en conviens, et ce dans nos pays eu égard à la doxa de la pensée dominante du microcosme politique. Pour autant , mon rôle de lanceur d’alerte s’arrête là aujourd’hui, alors advienne que pourra. Je me retire de nouveau sur l’aventin et laisse au temps le soin de décider qui avait raison et qui avait tort….L’élégance d’un silence vaut mieux que l’impuissance de tous les mots. « .
Jean Marie Nol, économiste
