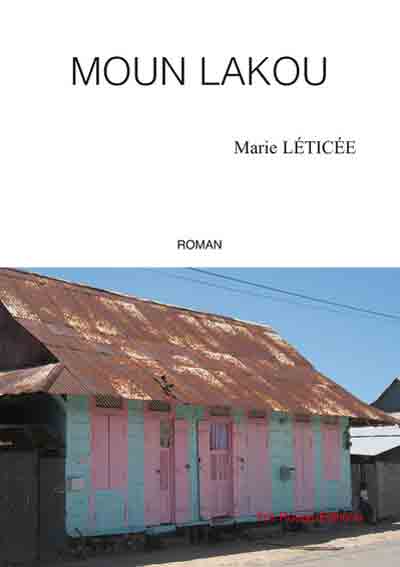 Sommes-nous vraiment qui nous sommes ?
Sommes-nous vraiment qui nous sommes ?
Ce roman, empreint de tendresse et de nostalgie, est l’histoire d’une petite fille qui grandit à la cour Monbruno, dans une Guadeloupe d’antan, entre souvenirs et questionnements. Dans ce milieu défavorisé mais pourtant loin d’être miséreux, l’enfant questionne sa place dans cet univers de lakou ou « quartiers pauvres » dans lequel elle évolue. Progressivement, elle intériorisera les différents éléments qui peut-être constitueront la personne qu’elle deviendra dans le futur…
MOTS DE LECTEUR :
« Ce roman, un délicat voyage dans les souvenirs d’une île d’avant la modernisation. Le goût des plaisirs simples : des jeux en plein air, des plats préparés pour survivre, des relations directes avec autrui et surtout ses voisins. Bref, une régression qui n’érige pas le passé en élément parfait d’une époque ou d’une existence, mais plutôt comme déclencheur de sourires et de questions sur soi même. »
.
*****
***
*
Extraits croustillants (la larme à l’oeil ou l’eau à la bouche, au choix)
« Autant que je m’en souvienne, la cour Monbruno m’avait toujours déplue, commença Camille. Je ne m’étais jamais sentie partie intégrante de ce monde. Pourtant n’étais-je pas parmi les plus pauvres ? Les plus démunis de ce quartier ? N’en étais-je pas le produit ? Ma mère m’avait eu dans ce quartier. Plaisir volé de sa jeunesse innocente. Et j’étais demeurée accrochée à ses entrailles, seul témoin de sa douleur, seul résultat de ce malheureux jour de pluie où sa seule erreur avait été de demander « un ti caché lapli, s’il vous plaît… Mésiédam bonjou ! » Elle continua son histoire et c’est ainsi que tous les jours, pendant au moins deux heures, installée dans sa chaise préférée, faisant face au verger d’arbres fruitiers tropicaux de Jean-Luc, (il en avait des centaines
de variétés) qui s’allongeait jusqu’au lac qui bordait leur propriété du Chamberlin’s Estate, elle la racontait à Evelyn qui la retranscrivait. Elles en étaient maintenant à des pages et des pages… (page 35)
Étroite et défoncée par endroit, elle m’apparaissait telle une vipère s’allongeant avec nonchalance d’un bout à l’autre du quartier. Elle avait l’allure d’une commère vicieuse comme il y en avait tant qui s’en allait d’une démarche de « mi ta’w mi tan mwen, mi ta’w, mi tan mwen », cherchant qui serait sa prochaine proie, victime de son venin engourdissant. Elle n’était ni droite ni crochue, elle avait de l’allure, la cour Monbruno. De ses hanches s’étiraient plusieurs autres petites artères qui s’enfonçaient dans nombres de directions. Une véritable toile d’araignée où maintes vies se perdaient, englouties par les entrailles voraces de la misère.
La cour était flanquée de petites maisons de toutes les couleurs et de toutes grandeurs, toutes coiffées d’une toiture de tôle en zink ondulée en forme de V renversé. Cette toiture était tout ce qui séparait ces hommes et ces femmes, crabes sans tête dont les yeux ne voyaient que derrière leur vie de misère, du soleil mordant guadeloupéen.
Ils mijotaient tous dans leur sueur de rivière salée, se reproduisant sans espoir d’un lendemain meilleur.
« Dèmen si pwèta Dié » disaient-ils tous. Et demain arrivait, sans qu’à Dieu ne plaise. Et c’était ainsi. Et les enfants voyaient, et ils entendaient, et ils comprenaient et ils acceptaient. Et c’était ça être qui on était ! Tout comme une bouche édentée s’ouvrait pour découvrir ses quelques dents cariées, ainsi me paraissait la cour avec toutes ses maisons à misère.
Quand on arrivait de la rue nationale, la cour paraissait accueillante. Elle s’emblait vous inviter à la pénétrer.
Sa bouche s’ouvrait toute grande comme pour mieux engloutir ceux qui avaient le malheur de s’y attarder, pour se rétrécir petit à petit, pour se multiplier en plusieurs petites ruelles ou les voitures Deux Chevaux ne pouvaient même pas se filer un petit chemin. La cour étouffait ainsi ses habitants qui demeuraient ses prisonniers comme qui dirait un serpent qui avalait petit à petit sa proie dans un venin de misère gluante et paralysante qui vous collait à la peau. (page 37)
Dans les transports en commun, nous étions toujours assis sur des banquettes recouvertes d’un vinyle rouge ou vert, qui nous faisaient transpirer dans les entrejambes. Coincés, les uns sur les autres comme partageant un destin unique, nous macérions dans la chaleur et dans les odeurs de transpiration qui dégoulinait de dessous des aisselles couvertes d’une forêt de poils noirs et roussis, aplatis par des bras d’une épaisseur colossale. Je subissais ces événements, fouettée par le vent qui s’engouffrait par rafale à l’intérieur du bus, me faisant pleurer des larmes qui me laissaient des traces d’eau salées au coin des yeux comme si j’avais passé une nuit à pleurer toutes les larmes de mon existence de ti négrès lakou a chivé grenné, à l’aube de son voyage.
Le trajet vers La Pointe durait une éternité même si nous habitions à peine à quelques kilomètres de l’enville.
Le transport en commun s’arrêtait tout le temps. Peu s’en fallait-il qu’un passager soit monté trente secondes avant le lieu où vous deviez descendre. Vous vous faisiez un honneur de demander votre arrêt à l’endroit exact de votre destination. Pas une seconde avant, pas une seconde après. Toute cette opération s’effectuait par un simple : « Arété » ou, dans les transports les plus fortunés, en appuyant sur le bouton d’arrêt. C’était donc un branle-bas incessant, un mouvement de flux et de reflux qui transformait l’autobus en une sorte de monstre vorace, d’allure gargantuesque, qui avalait à longueur de journée des quantités innombrables de Nègres pour pouvoir les éjecter par l’arrière d’une manière scatologique très singulière. À bien y penser, jamais je n’ai vu un Blanc, un Béké ou même un Nègre mulâtre user de ce genre de transport qui paraît-il à mes yeux n’était réservé qu’aux nèg nwè. Même les kouli malabas ne s’y aventuraient pas sauf ceux qui les conduisaient ou les « aides » du chauffeur.
Chaque transport en commun avait son propre « aide ». Un jeune homme très maigre et élancé, en général un ti zindien, qui se tenait debout à l’arrière de l’autobus entre la dernière rangée de siège et la porte arrière ; c’est dire qu’il devait être bien maigre ! Son rôle à part celui de faire la collecte du prix du voyage, était de guider ou plutôt de bousculer les voyageurs vers l’avant du bus en veillant bien à ce que tous les sièges soient occupés. Pas un espace ne devait rester libre d’où l’aspect boîte de sardine que prenaient tous ces transports en commun. C’était un constant « lévé sizé, lévé sizé » sans arrêt pour accommoder ceux qui montaient et ceux qui descendaient.
Mon unique plaisir dans les transports en commun était l’atmosphère musicale qui y régnait. Les transports automobiles guadeloupéens servaient de jukebox ambulants et contribuaient à leur manière au hit parade antillais.
On y entendait toute sorte de musique : biguines guadeloupéennes, mazurkas martiniquaises, salsas et meringués venant des îles espagnoles, compas d’Haïti, musiques latino, cadences lypso de la Dominique et bien d’autres rythmes tous aussi entraînants que les autres. Cette ambiance créait une atmosphère pan-antillaise et nous donnait une impression d’union fraternelle, presque familiale qui conjurait toutes barrières linguistiques.
Nous étions tous dans le même bain et partagions les mêmes expériences, que nous soyons Haïtiens, Dominicains, Portoricains, Cubains, Martiniquais ou Guadeloupéens. En musique, c’était menm biten, menm bagay !
(page 61)
Marie Léticée
Dr. Marie Léticée est professeur de littérature et de langue à l’université de la Floride Central (UCF) ou elle enseigne depuis 1988. Originaire de la Guadeloupe. Dr. Léticée a publié des articles dans Callaloo, Labrys Review et dans Secolas Annals. Elle a aussi reçu plusieurs bourses d’initiative et un prix de l’enseignement à UCF. De plus, elle a créé plusieurs nouveaux cours tels que : La poésie noire des Amériques, la littérature francophone, la littérature antillaise, la littérature créole et le français des affaires (en ligne). Dr. Léticée a publié “Education, Assimilation and Caribbean Identity: The Literary Journey of the French Caribbean” dans Caribbean Studies Press (2009). Marie Léticée vit à Orlando en Floride avec son époux Max (Albert) Camboulin, originaire des Abymes et ses deux enfants, Lina et Michael nés tous les deux à Orlando. Sa mère, Lina Léticée, fait le va et vient entre le Moule où elle demeure et Orlando.
Marie Léticée a publié un livre chez Ibis Rouge:
Moun lakou
Genre: Roman
Caractéristiques:
ISBN: 978-2-37520-506-8
Date de parution: 17 mars 2016
Type: Livre broché
Nombre de pages: 132
Dimensions: 220 × 140 × 15 mm
Poids: 300 g
