par Michel Herland
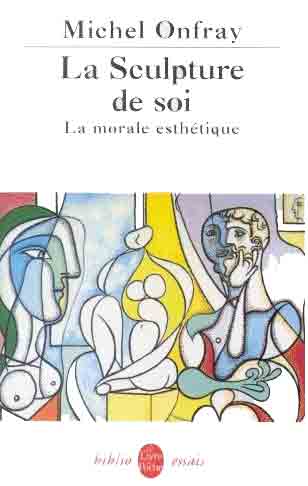 La réédition récente en Poche « Biblio essais » de deux ouvrages de Michel Onfray qui traitent directement de morale – en schématisant, d’abord le rapport à soi (La sculpture de soi – la morale esthétique, Grasset 1993 et Le Livre de Poche 2005, ci-après SS), puis le rapport aux autres (Politique du rebelle – traité de résistance et d’insoumission, Grasset 1997 et Le Livre de Poche 2006, PR) – est l’occasion de s’interroger sur la portée d’une œuvre plébiscitée par ce qu’il est convenu d’appeler le grand public cultivé mais souvent décriée par les philosophes patentés (1). De livres en livres, Michel Onfray se consacre à détruire les préjugés de toute sorte qui nous empêchent, selon lui, de vivre bien, et à proposer à la place une éthique hédoniste. Nul ne contestera l’intérêt de l’entreprise, d’autant qu’elle passe par la mise en évidence d’auteurs souvent injustement méconnus de l’histoire de la philosophie, tous ces marginaux en lesquels M.O. se retrouve davantage que dans les grands auteurs du programme. Il récuse en effet tout autant l’idéalisme de Platon ou de Hegel que le matérialisme de Marx et l’existentialisme sartrien. Son goût le porte vers les cyniques, les libertins, les athées ; Nietzsche est le premier de ses maîtres. De même, en philosophie politique, il en appelle aux anarchistes, à Stirner, à Proudhon, à Foucault, aux « situs », contre les théoriciens du contrat social, de la démocratie ou de la dictature du prolétariat.
La réédition récente en Poche « Biblio essais » de deux ouvrages de Michel Onfray qui traitent directement de morale – en schématisant, d’abord le rapport à soi (La sculpture de soi – la morale esthétique, Grasset 1993 et Le Livre de Poche 2005, ci-après SS), puis le rapport aux autres (Politique du rebelle – traité de résistance et d’insoumission, Grasset 1997 et Le Livre de Poche 2006, PR) – est l’occasion de s’interroger sur la portée d’une œuvre plébiscitée par ce qu’il est convenu d’appeler le grand public cultivé mais souvent décriée par les philosophes patentés (1). De livres en livres, Michel Onfray se consacre à détruire les préjugés de toute sorte qui nous empêchent, selon lui, de vivre bien, et à proposer à la place une éthique hédoniste. Nul ne contestera l’intérêt de l’entreprise, d’autant qu’elle passe par la mise en évidence d’auteurs souvent injustement méconnus de l’histoire de la philosophie, tous ces marginaux en lesquels M.O. se retrouve davantage que dans les grands auteurs du programme. Il récuse en effet tout autant l’idéalisme de Platon ou de Hegel que le matérialisme de Marx et l’existentialisme sartrien. Son goût le porte vers les cyniques, les libertins, les athées ; Nietzsche est le premier de ses maîtres. De même, en philosophie politique, il en appelle aux anarchistes, à Stirner, à Proudhon, à Foucault, aux « situs », contre les théoriciens du contrat social, de la démocratie ou de la dictature du prolétariat.
Les livres de M.O. sont écrits dans un style baroque, fugué, avec des variations qui peuvent paraître à la longue redondantes sur quelques thèmes majeurs. Néanmoins le procédé ne garantit pas que le lecteur ne passera pas à côté de certaines idées essentielles car des éléments clés de la démonstration soit sont sous-entendus, soit n’apparaissent que de manière fugace (et non fuguée). En tout état de cause, il faut saluer l’ambition de M.O., son aptitude à sortir des sentiers battus et sa volonté de produire une philosophie accessible et utile à tous les lecteurs – que l’on peut imaginer effectivement nombreux – à la recherche des principes d’une vie meilleure.
La logique semble plaider en faveur d’une démarche conforme à celle de M.O. : Poser d’abord les règles du gouvernement de soi-même avant de s’interroger sur celles de la vie en société. Mais il n’y a là aucune certitude. On pourrait très bien adopter la démarche inverse, considérer que les exigences du bon fonctionnement du groupe dictent les règles du comportement individuel. Par ailleurs, l’opposition entre l’individuel et le collectif fonctionne mal puisqu’il n’y a pas de morale qui ne concerne d’une façon ou d’une autre les relations avec autrui. Quoi qu’il en soit, M.O. argumente successivement en faveur d’un « utilitarisme jubilatoire » (SS) et d’une politique libertaire (PR) le tout situé sous l’invocation d’un « nietzschéisme de gauche ».
De gauche ou pas, l’influence de Nietzsche sur M.O. est en effet partout présente. Le point de départ est le même : l’angoisse provoquée par la contemplation de l’âme humaine, sa mesquinerie, son conformisme et le refus de rentrer dans ce moule, la volonté quelque peu désespérée d’inventer de nouvelles règles de vie, fut-ce pour quelques-uns seulement. Reste à examiner si l’on peut réconcilier une telle manière de voir avec la morale.
Mais n’anticipons pas. La Sculpture de soi commence par l’examen de certains modèles possibles pour une vie bonne : le condottiere, le dandy, l’artiste – et des qualités qui les caractérisent : virtuosité, légèreté, prodigalité, magnificence. Il s’agit de choisir Dionysos contre Apollon, Eros contre Thanatos, le loup contre le chien, donc de privilégier l’être contre l’avoir, la dépense contre l’accumulation, la volonté de jouissance contre l’idéal ascétique, les vertus « viriles » (2) et le « sublime » contre la soumission abjecte aux fausses valeurs qui caractérisent les « esclaves ». Tout cela jusqu’à présent n’a pas grand-chose à voir avec la morale, sinon avec une acception très partielle, solipsiste de celle-ci. Comment, à partir de ce point de départ, passer au souci des autres ? La réponse, chez M.O., requiert un glissement radical dans la problématique. Soudain, ce n’est plus Nietzsche l’inspirateur mais Adam Smith. Certes ce dernier n’est pas cité mais l’adhésion à une problématique de l’intérêt, ou de l’« amour-propre », n’en est pas moins entière. Avec un double discours. D’une part l’amour propre est présenté comme relevant du cerveau reptilien, si l’on peut dire : « Impossible à éradiquer, il est la mémoire et la trace des jungles, des forêts et des périls dont notre espèce procède ». Il est alors « principe de survie » (SS, p. 157-158). Mais il est également présenté comme l’horizon indépassable de la moralité, tout aussi présent chez celui qui se sacrifie jusqu’à consentir à sa propre immolation que chez le profiteur sans scrupule. « Qu’on n’aille pas chercher une seule action contredisant cette loi : aucune n’est désintéressée » (p. 156).
Sur cette base, il devient aisé de justifier le souci d’autrui : il n’est toujours et encore que l’expression du souci de moi-même. L’hédoniste proposé en modèle par M.O. « considère qu’il n’est pas de volupté possible sans considération de l’autre. Non par amour du prochain, mais par intérêt bien compris… Tous sont autrui pour moi, mais je suis autrui pour tous les autres… La jouissance que je donne rencontre, sur son trajet, la jouissance qu’on me donne » (p. 148-149). Une telle approche contractuelle de la morale (je te fais du bien tant que tu me fais du bien) est sans nul doute légitime mais dans quelle mesure s’accorde-t-elle avec les valeurs prônées par M.O. ? En d’autres termes, la dépense, le gaspillage, la magnificence, toutes ces attitudes sont-elles vraiment compatibles avec le calcul intéressé qui vient de nous être présenté ?
À cette interrogation, qui relève de la psychologie, s’en ajoute une autre d’ordre plus global, macroéconomique. C’est bien beau de faire l’éloge de la prodigalité, de la magnificence, mais quelle économie est derrière ? Il est intéressant de considérer les exemples retenus par M.O. Il y a d’une part les peuples primitifs qui pratiquent le potlatch ; d’autre part des individus très privilégiés par la fortune et qui peuvent sans nul doute se montrer généreux et magnifiques : les « évergètes » de l’Antiquité grecque (p. 125) et quelques souverains qui ont marqué l’histoire comme Laurent « le magnifique » ou notre François 1er. Pour ces derniers, M.O. admet que « leur situation à la tête d’un pays rendait possible (leurs) pratiques sur de pareilles échelles ».
« Le capitalisme a contribué à l’effacement de tout souci de noblesse », nous dit-on. Peut-être mais qu’y avait-il de si noble à dilapider ses richesses quand on les tirait/extorquait du travail d’autrui ? Et en quoi cela nous concerne-t-il ? On veut bien entendre M.O. quand il ajoute – « sur des terrains plus singuliers, plus intimes et individuels, en l’occurrence l’éthique des particuliers, il est possible de vouloir pareilles magnificences, du moins de tendre vers des morales hédonistes et dispendieuses » (n.s, p. 131) – mais l’on n’est pas sûr néanmoins de comprendre. Le B-A-BA de la morale indique qu’il n’est juste de dépenser que ce que l’on a honnêtement gagné. Si l’on s’en tient à ces seules ressources-là, il ne peut pas y avoir beaucoup de superflu à dilapider. M.O. préfère les cigales aux fourmis ; c’est son droit. Néanmoins les réalités de la vie quotidienne, dès lors que l’on refuse les privilèges des prédateurs et des rentiers, nous obligent à nous faire plutôt besogneux que dispendieux.
C’est à se demander pourquoi M.O. a voulu se donner des exemples aussi flamboyants. Il aurait pu s’en tenir à son mot d’ordre (déjà chez Chamfort). « Jouir et faire jouir » : une version particulière de l’utilitarisme, plus accessible que celle de Bentham puisqu’elle place mon plaisir (jouir) avant celui des autres (faire jouir) (3). On peut être séduit en effet par cet eudémonisme raisonnable au terme duquel la jouissance (entendue au seul large) doit se répandre en des cercles concentriques en se diluant au fur et à mesure qu’on s’éloigne de l’individu-centre. Une morale qui ne se paye pas de mot, qui appelle à faire le bien pour le bien, à préférer l’oubli des offenses au ressentiment, qui privilégie l’amitié, qui encadre les relations sexuelles par des « contrats hédonistes », qui accorde une attention particulière à la politesse. M.O. nous propose ainsi une éthique réaliste, ou rationnelle, qui a toutes ses chances face aux morales du renoncement.
Après « l’éthique », la « politique ». La Politique du rebelle s’ouvre sur une critique du capitalisme, assez convenue, et une théorie de la justice sociale, assez classique elle aussi, exclusivement en termes de droits (nourriture, logement, santé, éducation, culture, etc.). Il n’est pas fait allusion, à ce niveau, aux moyens les plus adaptés à ces fins. M.O. réserve cette question pour le chapitre intitulé « Économie » dans lequel, par exemple, lorsque, suivant André Gorz, il retient l’idée de « découpler revenu et quantité de travail », il semble prendre parti pour un « revenu d’existence » garanti à tous (4). Ce chapitre est inspiré principalement par Proudhon,… que l’on ne saurait tenir pour responsable des affirmations surprenantes que l’on trouve ici ou là : les impôts comme instrument de paupérisation (comme si les services publics ne comptaient pour rien dans le niveau de vie) ; ou le recours au protectionnisme pour « éviter qu’un pays où les enfants travaillent pour des salaires de misère puisse… emporter des marchés là où d’autres jouent selon une règle du jeu qui reconnaît le droit au travail, etc. » (PR, p. 127 – comme si l’ouverture internationale des marchés n’était pas le meilleur moyen qu’on connaisse pour élever le niveau de vie, et par là améliorer les conditions de travail, dans les pays émergents).
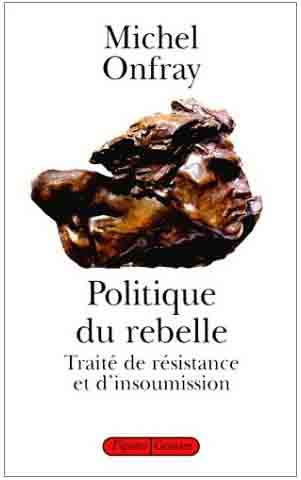 D’une manière générale, M.O. se montre fort peu proudhonien en mettant systématiquement en exergue le côté noir du capitalisme : une « économie cannibale » (p. 109), « la misère, la décrépitude, l’exploitation, la pauvreté, la servitude des ouvriers, la décrépitude des prolétaires, la paupérisation » (p. 117). Que le capitalisme – dans les pays où il a triomphé – ait permis l’élévation générale du niveau de vie, l’accès aux soins pour tous, l’allongement de la durée de la vie humaine, l’alphabétisation, l’éducation gratuite, les droits de l’homme (et de la femme), et l’on en passe, tout cela est occulté (5). Et que les difficultés traversées actuellement par les vieux pays industriels comme la France (cf. p. 118) ne s’expliquent pas par les tares du capitalisme mais qu’elles soient simplement l’envers des progrès accélérés, du rattrapage des pays émergents, cela n’est pas évoqué non plus.
D’une manière générale, M.O. se montre fort peu proudhonien en mettant systématiquement en exergue le côté noir du capitalisme : une « économie cannibale » (p. 109), « la misère, la décrépitude, l’exploitation, la pauvreté, la servitude des ouvriers, la décrépitude des prolétaires, la paupérisation » (p. 117). Que le capitalisme – dans les pays où il a triomphé – ait permis l’élévation générale du niveau de vie, l’accès aux soins pour tous, l’allongement de la durée de la vie humaine, l’alphabétisation, l’éducation gratuite, les droits de l’homme (et de la femme), et l’on en passe, tout cela est occulté (5). Et que les difficultés traversées actuellement par les vieux pays industriels comme la France (cf. p. 118) ne s’expliquent pas par les tares du capitalisme mais qu’elles soient simplement l’envers des progrès accélérés, du rattrapage des pays émergents, cela n’est pas évoqué non plus.
Si M.O. se réclame d’un « nietzschéisme de gauche », on l’a vu, il faut prendre garde aux définitions qu’il retient de la droite et de la gauche : « La droite montre à toute occasion sa haine de l’individu qu’elle veut au service du groupe quand la gauche célèbre ce dernier comme une occasion de pallier les défaillances des singularités les plus fragiles » (p. 141). On associe pourtant traditionnellement la droite, l’individualisme et le libéralisme, d’une part, la gauche, le socialisme et le dirigisme d’autre part. Il s’agit certes de simplifications mais elles sont utiles. À cette aune, on est en droit de douter que Michel Onfray, et son maître Nietzsche, puissent être rangés à gauche. Sauf à inverser les sens des mots, le culte du sublime (6), l’individualisme, l’utilitarisme (avec sa part de solipsisme) ne relèvent pas de la culture de gauche. De même paraît-il abusif de caractériser la gauche par la « célébration de la diversité » et un « principe de mosaïque » (p. 147-148) qui conduit tout droit au communautarisme (même si le mot n’est écrit nulle part).
En tout état de cause, M.O. n’a que mépris pour la politique, qu’elle soit de droite ou de gauche, qui s’incarne dans les instances démocratiques. « Les partis valent les autres machines d’asservissement » (p. 283) et « l’excellence du principe d’égalité absolue devant la loi issu de la révolution française a péri paradoxalement dans les lieux de représentation populaire où l’on se réclame du peuple pour permettre les agissements d’une aristocratie non des mérites, ou de l’argent, mais de la servitude » (p. 281). Il lui faut donc la remplacer par autre chose. Si la politique, aujourd’hui, sert uniquement à conforter le « désordre établi » (7), la vraie politique doit se donner pour mission d’améliorer l’état des choses. M.O. se trouve dès lors sommé de proposer une philosophie de l’action. Il la trouve dans l’anarchie, non pas celle de Bakounine, celle qui « fétichise l’État » (p. 204), mais chez Proudhon, Stirner et Sorel. Du dernier (et de Pelloutier), il retient en particulier le syndicalisme révolutionnaire et il vante leurs avatars modernes, les « coordinations ». Il s’en remet donc à l’action directe (avec ses gradations de la grève à la destruction des moyens de production – p. 294), éventuellement violente (pourvu qu’elle épargne « les innocents, ceux qui ne sont en rien les auxiliaires du pouvoir bourgeois » – p. 293).
Il ne s’agit pas pour autant d’aller jusqu’à la destruction du capitalisme, car ce serait jeter en même temps la liberté (p. 122). M.O. campe sur les positions des socialistes associationnistes du XIXe siècle ; il souhaite l’avènement « d’une démocratie industrielle où surgiraient des propriétés individuelles d’exploitation aux côtés d’une agriculture de groupe, des propriétés collectives d’entreprise couplées à des ateliers autonomes, des compagnies ouvrières animées par la participation, des fédérations industrielles de producteurs et de consommateurs, des organisations coopératives de service, l’ensemble générant une socialisation libérale sinon un socialisme libertaire » (p. 129). Il s’agirait donc de faire cohabiter des entreprises capitalistes classiques avec des coopératives, des firmes autogérées, donc des entreprises dont le capital est partagé entre les producteurs (ou les consommateurs).
L’association présente un grand intérêt théorique (mettre fin à l’exploitation en faisant de chaque travailleur un capitaliste). Force est de constater, cependant, que cette formule a du mal à décoller (en dehors de l’agriculture, sous un régime fortement administré) alors même qu’il existe des dispositifs spécifiques destinés à la favoriser. On s’est longtemps demandé pourquoi. Il a fallu l’apparition, chez les économistes, d’une nouvelle théorie, dite des droits de propriété pour que l’on commence à y voir plus clair (8). La cohabitation entre les entreprises capitalistes classiques (avec une propriété distincte du travail) et les firmes autogérées (avec confusion de la propriété et du travail) conduit à terme à l’élimination des secondes parce qu’elles sont structurellement moins performantes. Et cela tient effectivement à la nature et à la répartition des droits de propriété. D’une part le travailleur de l’entreprise en autogestion possède un droit de propriété incomplet (l’usus et le fructus mais pas l’abusus ce qui induit une négligence pour le long terme) ; d’autre part la confusion entre le travailleur (titulaire du salaire) et le propriétaire (titulaire des profits), empêche que les profits jouent le rôle qui leur est normalement dévolu d’indicateur de performance et de sélection des entreprises les plus efficaces.
En définitive, si l’ambition de M.O. de refonder la morale et la politique apparaît entièrement légitime, on ne peut s’empêcher de rester sur notre faim. En effet son éthique hésite entre la tentation nietzschéenne de proposer une morale surhumaine et le souci bien plus pragmatique de fournir quelques règles de vie (sur ce plan-là sa tentative est plutôt réussie). Quant à sa politique, elle demeure fondée sur une appréciation purement négative du capitalisme qui ne trouverait réellement sa justification que si l’auteur proposait une vraie solution de remplacement.
****************
(1) Ceux-là mêmes qui « la bouche pleine de vérités éternelles… pourfendent le philosophe-artiste, trop artiste à leur goût, et pas assez philosophe » (SS, p. 75).
(2) Celles qui font la grandeur de l’homme… comme de la femme (SS, p. 159).
(3) Suivant le « principe d’utilité » benthamien, une action est bonne lorsqu’elle augmente le « bonheur général ». Dès lors mon propre bonheur ne compte pas plus que celui des autres.
(4) PR, p. 129. Sur les fondements du revenu d’existence (ou de l’allocation universelle) et les critiques qu’on peut lui adresser, cf. M. Herland, Lettres sur la justice sociale à un ami de l’humanité, Le Manuscrit, 2006, lettre 8.
(5) S’il y a eu des progrès (démocratisation, décolonisation), ceux-ci ne sont pas imputés au capitalisme mais à la « mystique de gauche » (cf. infra). M.O., on le voit, croit à l’autonomie des superstructures par rapport à l’infrastructure.
(6) Voir SS et le dernier chapitre de PR : « De l’action – une dynamique des forces sublimes ».
(7) Expression forgée par Robert Aron et Arnaud Dandieu. Cf. La Révolution nécessaire, 1933, réédition Jean-Michel Place, 1993.
(8) Cf. par exemple Armen Alchian et Harold Demsetz, « Production, Information Costs and Economic organization », American Economic Review, 1972.
