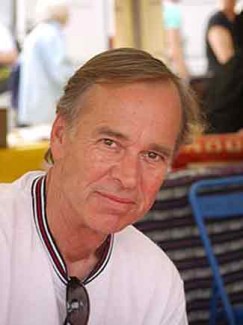 Réaction au manifeste : Björn Larsson
Réaction au manifeste : Björn Larsson
Littérature, identité et nationalisme
Le lundi 2 avril 2007
Par Björn Larsson, écrivain et professeur de français à l’université de Lund en Suède.
Chaque année, vers le mois d’octobre, la tension monte dans les ambassades étrangères à Stockholm et en particulier dans les services culturels. Quel est le pays qui cette fois-ci aura la gloire de recevoir le prix Nobel de littérature ? Ceux qui croient avoir un candidat en lice achètent déjà du Champagne et préparent les listes d’invitations pour les réceptions à venir. Il faut dire que certains pays auront dépensé beaucoup d’énergie et d’argent à essayer d’influencer — sans aucun doute inutilement — le choix de l’Académie. Peu d’écrivains refusent d’ailleurs une invitation à venir en Suède donner des conférences, frais payés… par leur propre pays.
Une fois le lauréat annoncé par le secrétaire permanent de l’Académie suédoise, les cris d’enthousiasme et de déception s’étalent dans les médias. Certains se plaignent – les Français souvent plus que d’autres – que l’Académie a manqué de jugement en négligeant tel écrivain national. D’autres protestent parce que celui ou celle – plus rarement – qui a été choisi n’est pas le meilleur écrivain du pays, c’est-à-dire que l’écrivain en question n’est pas le meilleur représentant de la littérature nationale. Cela, on le sait, est arrivé avec Dario Fo. Lors de l’attribution du prix à Saramago, beaucoup des Portugais contestèrent le choix parce que Saramago était communiste et parce qu’il avait choisi de s’exiler à Lanzarote, en Espagne. Il y a même eu ceux qui s’élevèrent contre le choix d’Imre Kertész parce qu’il n’était pas un « vrai » Hongrois, mais un hongrois juif, ou un Juif vivant en Hongrie — sauf qu’on n’osait tout de même pas le dire aussi explicitement que cela.
Dans la plupart des capitales de l’Europe se côtoient des Centres culturels dont le premier rôle est de promouvoir la culture de la nation. Au Centre Culturel Suédois à Paris, par exemple, on organise régulièrement des lectures avec des écrivains suédois déjà traduits ou susceptibles de l’être. On rend service aux éditeurs et aux traducteurs qui s’intéressent à la littérature suédoise. L’Institut suédois à Stockholm accorde des subventions à la traduction et paie les frais de déplacement pour les écrivains invités aux festivals du livre à l’étranger. Au Danemark, le ministère de la culture a créé un organisme spécifique, le Centre de littérature danoise, qui a pour seul et unique objectif de promouvoir la littérature danoise à l’étranger.
Dans les écoles et les universités du monde développé, des hordes d’étudiants en littérature remplissent les amphithéâtres et les salles de cours chaque année. Pour celui qui aime la littérature, cette affluence doit être une source de réjouissance. Dans la grande majorité des pays, cependant, l’étude de la littérature équivaut à l’étude de la littérature nationale. Un étudiant qui voudra enseigner le français au lycée passe ainsi cinq années à étudier la littérature française sans aucune obligation de lire un seul chef-d’œuvre étranger, même pas ceux des écrivains qui ont le plus influencé la littérature française. Un étudiant en littérature française peut donc très bien ne jamais avoir lu Dante, Cervantes, Shakespeare, Scott, Richardson, Dostoïevski, Kafka, Goethe ou Strindberg.
Dans la plupart des pays, aussi, la grande littérature est posée comme modèle d’excellence linguistique. La langue des grands écrivains nationaux est érigée en norme. Le mythe — et c’en est un — de la clarté de la langue française a été largement entretenu, littérature française à l’appui. Si, à la rigueur et du bout des lèvres, on permet à des écrivains francophones extra-hexagonaux, comme Kourouma ou Chamoiseau, de tordre le cou à la syntaxe française, l’écrivain français de souche sera sévèrement corrigé par les éditeurs et par les critiques pour toute liberté prise avec les règles de la grammaire standard. On permettra éventuellement à un Houellebecq de provoquer et offenser au niveau du contenu, mais seulement s’il maîtrise l’art de « bien écrire », tel que celui-ci est défini par les détenteurs du pouvoir symbolique. N’oublions pas que deux tiers des exemples du Littré sont tirés de la littérature canonisée.
On connaît les efforts des autorités soviétiques pour gagner les écrivains domestiques et étrangers à la cause communiste pendant la guerre froide. L’association des écrivains soviétiques de l’époque était une formidable machine de propagande intérieure et extérieure, dirigée par le parti et surveillée de près par les services des renseignements. Des études récentes ont montré à quel point les dirigeants soviétiques cherchaient le soutien des intellectuels et des écrivains — d’ailleurs en contradiction flagrante avec la doctrine du matérialisme historique selon laquelle la culture n’était que le reflet fidèle et passif des conditions de production économique. Pour les dirigeants et les idéologues, cependant, il ne faisait aucun doute que la littérature était un élément essentiel de l’action politique.
Que ceux qui pensent qu’il s’agit là d’un temps heureusement révolu se détrompent ! Il y a un an environ, le ministre de la culture danois a réuni une commission nationale constituée d’écrivains et d’universitaires qui a reçu pour mission d’établir un canon d’œuvres classiques de la littérature danoise que tout élève devait avoir lu. Dès le départ, l’initiative du ministre a été vivement discutée dans les médias. Il est notable, cependant, que les débats portèrent avant tout sur la possibilité d’établir des critères esthétiques sur lesquels pouvait être fondée la sélection des textes à lire. Rares étaient ceux qui remettaient en question le fait que le canon était constitué uniquement d’œuvres littéraires danoises. Jusqu’au jour où le même ministre, une année plus tard, déclara dans une interview que le véritable objectif du canon était la défense des « valeurs spécifiquement danoises » contre les valeurs étrangères, en particulier celles des immigrés, et encore plus particulièrement celles des immigrés musulmans !
Chaque pays d’Europe organise des foires du livre où la littérature nationale se taille la part du lion. Rien de plus naturel, bien sûr, ces foires étant aussi – ou surtout — d’énormes librairies. N’invite-on pas également des littératures étrangères, en leur accordant la place d’honneur ? Si, mais il s’agit presque toujours d’une littérature nationale, avec, en conséquence, des querelles et des imbroglios politiques de tout ordre. On se rappelle, récemment, les cas de l’Italie et de la Chine au salon du livre à Paris.
On accuse souvent la France de ne pas s’intéresser suffisamment à la littérature étrangère. Cependant, le chauvinisme culturel de la France n’est pas — ou n’est plus — pire qu’ailleurs ; celui-ci a beaucoup à envier aux pays anglo-saxons où, par exemple, l’attribution d’un prix Nobel à un écrivain « étranger » se remarque à peine dans les ventes — si encore l’écrivain est traduit. Gardons le sens des proportions : on a toujours abondamment traduit la littérature étrangère en France et les écrivains se sont largement laissés influencer par celle-ci. Sans Kafka, Joyce, Dostoïevski, Hemingway, Dos Passos, Calvino et d’autres encore la littérature française ne serait pas devenue ce qu’elle est. Aujourd’hui encore, il suffit d’ouvrir Le monde des livres ou Le magazine littéraire pour voir que la littérature étrangère est loin d’être négligée. Le succès du festival des Étonnants voyageurs à Saint-Malo a été en grande partie construit sur l’ouverture au monde.
Il n’empêche que les œuvres littéraires sont presque toujours classifiées par leurs origines dans les librairies et dans les catalogues des éditeurs. Il y a des collections pour la littérature étrangère, pour la littérature africaine ou pour la littérature hispanique, que celles-ci soient traduites ou écrites directement en français. Les magazines et suppléments littéraires consacrent régulièrement des pages à la littérature de tel ou tel pays. À Paris, on trouve des librairies spécialisées dans la littérature d’un seul pays. Sur la quatrième de couverture, l’information incontournable est le pays d’origine de l’écrivain. Récemment, j’ai découvert qu’un de mes romans, Le cercle celtique, était décoré d’un bandeau rouge qui portait le texte « Polar suédois ». Pour un roman qui parle d’identité celtique sans contenir un seul mot sur la Suède et qui est écrit par un écrivain déraciné et dénationalisé comme moi qui vit à l’étranger depuis vingt ans !
Tous ces exemples, et on pourrait en citer de nombreux autres, abondent dans le même sens : la littérature fait partie de l’intérêt national. Elle est un élément important de l’identité nationale. Qu’on le veuille ou non, qu’on résiste ou non, la littérature participe à la légitimation de la culture nationale et au rayonnement de la nation à l’étranger. Elle est un objet de fierté et de prestige. On se vante de ses grands écrivains. On les couvre d’honneurs et des prix. On les momifie dans les uniformes de l’Académie. On leur donne des apanages et on les invite aux dîners organisés par les représentants du pouvoir. On fait volontiers appel aux écrivains célèbres dans les campagnes électorales. On brandit leurs chef-d’œuvres comme autant de signes du génie de la nation, sous-entendant qu’il ne s’agit que de la partie visible de l’iceberg.
À la condition, cependant, que la littérature se montre bonne élève ! À la condition que les écrivains se montrent conciliants et respectueux envers ceux qui les invitent à leur table !
En effet, le paradoxe est là : si on regarde l’histoire de la littérature, il n’y a aucun doute que la littérature s’est toujours montrée rebelle à la récupération idéologique, nationaliste ou politique. La liste des écrivains qui ont été censurés, persécutés, exilés ou même assassinés est désespérément longue. Jusqu’en 1954, le Vatican interdisait aux croyants de lire certaines œuvres jugées impies ou immorales, mettant celles-ci à l’Index . En France, parmi les plus illustres, Rabelais, Molière, Rousseau, Voltaire, Diderot, Sade, Beaumarchais, Chateaubriand, Madame de Staël, Hugo, Flaubert et Baudelaire ont tous eu à lutter contre la censure de l’État et de l’Église.
Aujourd’hui encore, Salman Rushdie reste condamné à mort, même si la plus grande menace qui pesait sur lui a été levée. Il n’y a pas si longtemps, revers de la médaille de l’importance accordée à la propagande intellectuelle, les anciens régimes communistes soumettaient la littérature à une censure sévère. Les écrivains qui ne s’y pliaient pas furent réduits au silence, condamnés aux camps de travail forcé, à la prison, aux hôpitaux psychiatriques ou à l’exil. Ce système reste en vigueur en Chine et en Corée du Nord. Dans de nombreux autres pays du monde, les écrivains continuent à être harassés. Index of Censorship, qui depuis 1968 défend la liberté d’expression, semble malheureusement n’avoir jamais eu de difficultés à trouver des matériaux pour ses articles. Dans son rapport pour l’année 1994, Amnesty International constatait qu’il y avait plus de 700 écrivains dans le monde qui étaient ou bien en prison ou bien rapportés disparus. On connaît le sort tragique de beaucoup d’écrivains africains qui se sont élévés contre leurs régimes autoritaires et corrompus. Pendant la terreur en Algérie, qui, espérons-le, touche à sa fin, des douzaines de poètes et de romanciers furent froidement abattus par des commandos fondamentalistes.
La méfiance envers la littérature n’est pas non plus d’hier. On se rappelle que Platon voulait reléguer les poètes hors de la Cité . L’institution de la censure, il faut le rappeler, a existé et continue à exister dans tous les régimes. De tous les temps, ceux qui détiennent le pouvoir ou qui aspirent à le gagner ont tenté d’enrôler les écrivains pour leur cause — le cas exemplaire étant Gorki — ou, dans le cas d’un refus, de les réduire au silence — le cas exemplaire étant encore Gorki.
Il n’est donc guère aventureux d’affirmer que le rôle social et politique de la littérature est au plus haut degré ambivalent. D’un côté, elle est valorisée comme faisant partie du projet identitaire national ou nationaliste. De l’autre, elle est dévalorisée si elle refuse de soutenir les aspirations nationales ou identitaires des assoiffés du pouvoir. D’un côté, la formule « c’est de la littérature » est un jugement de valeur positif. De l’autre, l’expression « ce n’est que de la littérature » est tout autant négatif. Si par périodes, les écrivains ont joui d’une certaine liberté, il reste vrai que le pouvoir a toujours cherché à circonscrire cette liberté. Aujourd’hui même, la censure civile ayant remplacé celle de l’État dans nos pays dits de démocratie libérale, des écrivains sont traduits devant la justice, accusés de blasphème, de calomnie, d’incitation à la haine raciale ou d’immoralité.
Dans les études d’histoire de la censure et dans les écrits de défense des écrivains et de la littérature, il y a une tendance à mettre les seuls représentants du pouvoir sur le banc des accusés. D’un côté, il y a les bons, les écrivains. De l’autre, il y a les méchants, les politiciens et les idéologues. Or, à présenter la réalité ainsi, on oublie les écrivains, et parfois pas des moindres, qui ont mis leur plume volontairement au service d’une idéologie, d’un mouvement ou d’un régime. Personne ne forçait Brasillach, Céline, Drieu la Rochelle ou Hamsun à défendre l’idéologie national-socialiste. Dans toutes les dictatures, que celle-ci aient été militaires ou de parti, il y a eu des écrivains qui ont pratiqué l’auto-censure ou qui ont composé avec le pouvoir, par conviction ou pour garder leurs privilèges.
Mais la question du rapport entre les écrivains et le pouvoir ne se pose pas seulement dans les régimes autoritaires. Elle se pose tout autant dans nos démocraties libérales chaque fois qu’une collectivité revendique ses droits identitaires, que ce soit les gays, les Bretons, les femmes ou les immigrés. L’écrivain beur, par exemple, a-t-il pour premier devoir d’écrire des romans sur les conditions des beurs dans la société française ? L’écrivain breton doit-il d’abord raconter la réalité bretonne ou peut-il tout aussi bien parler d’amour ou des beurs ? L’écrivain femme peut-elle se permettre de décrire la condition masculine, sans pour autant dénoncer celle-ci ?
Il y a quelques années, je participai à la 26ème rencontre québécoise internationale des écrivains qui réunissait une quarantaine d’écrivains francophones, dont la moitié environ venaient du Québec et l’autre moitié du monde, pour discuter les rapports entre l’identité, la nation et la littérature. Dès le premier jour, il devint clair que le thème de la conférence divisa les écrivains en deux camps. D’un côté, la plupart des écrivains québécois qui voyaient dans la littérature une arme pour défendre la culture nationale, plus précisément la culture francophone, contre l’impérialisme anglophone. Quelqu’un parlaient même du besoin d’un « service littéraire national » qui demanderait à chaque écrivain du Québec d’écrire d’abord un ou deux ouvrages à la défense de la langue et de la culture québécoise avant d’écrire « librement ». De l’autre, la plupart des écrivains du reste du monde qui dénonçaient la récupération nationale ou identitaire de leur littérature. Je me rappelle surtout Maryse Condé qui non seulement refusait avec force l’étiquette d’ « écrivain des Caraïbes », mais également celle d’écrivain femme. Pour elle, la vocation profonde de la littérature était d’être universaliste et humaniste, pas une défense de quelque groupe spécifique d’humains, opprimés ou non.
La question qu’on doit se poser est donc celle de savoir si la littérature a une vocation propre, une spécificité qui la rendrait réfractaire à la récupération idéologique, identitaire ou nationaliste. Ou si, au contraire, la littérature est un phénomène hétérogène sans spécificité véritable qui peut être utilisé à des fins divers, voire contradictoires.
Répondre à cette question éuivaudrait à proposer une théorie de la littérature à la fois comme phénomène social et comme texte, ce qui dépasserait de loin les limites d’un seul article. Ici, je me contenterai de résumer brièvement les résultats de mes réflexions déjà présentées ailleurs et d’essayer d’en tirer quelques conclusions.
La première chose à dire est que tout porte à croire que la littérature n’est pas un phénomène homogène, invariable et transhistorique. Si on regarde les textes qui à travers l’histoire et dans différents pays ont été désignés comme étant littéraires, on se rend vite compte qu’il y a de grandes différences. Il suffit de jeter un coup d’œil dans n’importe quelle histoire de la littérature pour constater, par exemple, qu’y apparaissent pour les époques révolues des écrivains et des textes qui ne figureraient plus aujourd’hui dans une histoire de la littérature moderne : des philosophes comme Descartes et Pascal, des historiens comme Froissart ou un mémorialiste comme Saint-Simon . On peut également constater que les critères de la littérarité ont connus une évolution à travers l’histoire. Si, pour les textes anciens, le premier critère de littérarité était un certain style ou certaines qualités esthétiques, aujourd’hui on insiste beaucoup plus sur le critère de la fictionnalité. Lorsque, par exemple, on dit que La vie de Saint-Alexis est la première œuvre littéraire en langue française, c’est entièrement en raison d’une certaine recherche stylistique et esthétique. N’y entre pas la question de la véracité ou non des faits racontés, c’est-à-dire la question de savoir si l’histoire est inventée ou pas.
Lorsqu’on discute le rôle que peut avoir – ou que devrait avoir — la littérature dans la société, il faudrait donc d’abord s’entendre sur une définition de la littérature. Ou, plutôt, il faudra décider de quelle littérature on parle. C’est ainsi que la question du rapport entre la littérature et l’identité se posera différemment si on pense aux romans de Céline ou de Hamsun ou à leur pamphlets politiques et idéologiques. De la même manière, il me semble évident qu’il y a une différence assez marquée entre la littérature de confession — l’autobiographie ou l’auto-fiction — qui prétend raconter la vérité des événements réels spécifiques et une littérature d’imagination d’un Balzac ou d’un Camus.
La différence entre ces deux formes principales de discours est fondamentalement une différence entre liberté et contrainte. Si on veut dire la vérité et raconter ce qui est ou ce qui a été, on n’est pas libre de dire n’importe quoi n’importe comment. Déjà, évidemment, on est limité par ce qui est effectivement arrivé. Deuxièmement, pour que les affirmations proférées puissent être vérifiées, il faut un langage qui tend à l’univocité. Ensuite, si on prétend dire la vérité, on n’a pas le droit de mentir ou de défigurer la réalité décrite. Enfin, s’il est vrai — dans une certaine mesure — que chaque représentation de la réalité implique une sélection des données, l’auteur d’un texte visant la vérité ne peut pas faire la sélection d’une manière tendancieuse pour manipuler son lecteur. Prenons un exemple concret et controversé : s’il est vrai que certains nationalistes bretons ont collaboré avec l’occupant nazi, on n’a pas le droit pour autant de laisser entendre que tous les Bretons étaient collaborateurs.
Ces exigences d’ordre éthique disparaissent en grande partie lorsqu’il s’agit d’une littérature d’imagination où tout, d’une certaine manière, est mensonge. Dans un roman, on a le droit de raconter l’histoire de quelques Bretons — ou de quelques Irlandais — qui avaient la naïveté de penser que faire route commune avec les Allemand était un moyen de se libérer de leur propre État-nation ou de leurs anciens colonisateurs. Tout comme on a le droit de raconter la vie de quelques Bretons ou Irlandais qui refusaient d’employer des moyens immoraux pour atteindre un objectif peut-être légitime. À la condition que l’histoire et les personnages soient imaginés. À la condition que les histoires racontées ne soient pas copiées du réel, mais imaginées à partir du réel. En effet, la littérature d’imagination appartient au monde du possible ; ses modes sont le conditionnel, le subjonctif et le futur, incertain et conjectural par définition, pas l’indicatif. Raconter et dire ce qui peut être, ce qui aurait pu être, ce qui pourrait être ou ce qui pourra être est moralement et épistémologiquement une autre activité que celle de dire ce qui est ou ce qui a été. C’est dans ce sens-là que la littérature d’imagination est une expression de la liberté de l’être humain, de cette capacité que nous avons ou que nous pouvons acquérir de nous imaginer que la réalité et notre existence pourraient être autres qu’elles ne le sont. Bref, si la littérature d’imagination a une essence, c’est d’être un exercice de liberté et un appel à la liberté du lecteur.
C’est là, selon moi, la raison profonde pour laquelle cette littérature-là, c’est-à-dire la littérature qui invente la réalité plutôt que la copier — comme disait Baudelaire à propos de Balzac —, est réfractaire à tout pouvoir, à toute idéologie autre que l’humanisme libertaire et à toute identité collective fondée sur l’exclusion de l’autre. C’est cela que Sartre voulait exprimer avec sa formule paradoxale dans Qu’est-ce que la littérature : « On n’écrit pas pour des esclaves ». C’est-à-dire, plus précisément, qu’on écrit pour qu’il n’y ait plus d’esclaves, ni d’esclavage, mais seulement — rêve utopique semble-t-il parfois à la vue du monde — des hommes et des femmes libres. Sartre avait également raison quand il écrivait dans le même ouvrage qu’il n’était pas possible d’écrire un roman à la défense de la tyrannie ou de la peine de mort. Sauf qu’il oubliait de préciser, comme si souvent lorsqu’il avait un but polémique, qu’il ne s’agissait pas d’une impossibilité nécessaire, mais d’une exigence esthétique et éthique.
On dira de même des déclarations de Kundera dans L’art du roman au sujet des rapports entre le roman et la politique : « En tant que modèle de ce monde, fondé sur la relativité et l’ambiguïté des choses humaines, le roman est incompatible avec l’univers totalitaire. […] La Vérité totalitaire exclut la relativité, le doute, l’interrogation et elle ne peut donc jamais se concilier avec ce que j’appellerais l’esprit du roman » . En effet, s’il est vrai que l’« essence » du roman est de s’inscrire en faux contre toute pensée totalitaire, ce que je crois, cela n’a pas empêché certains écrivains de soutenir avec leur littérature des régimes totalitaires. Malheureusement, la seule sanction qu’on peut leur infliger, en dehors de la réputation d’être des lèches-bottes, est le verdict des lecteurs.
Cela dit, ce n’est pas un hasard si le roman à thèse — le roman qui affiche explicitement ses couleurs idéologiques et brandit comme un drapeau les valeurs que le lecteur est censé adopter après avoir lu le texte — tombe des mains d’ennui. La raison en est que le roman à thèse, comme les romans du réalisme social soviétique, comme toutes les œuvres littéraires qui militent pour une idéologie particulière, sont des romans autoritaires qui n’accordent que peu de liberté au lecteur d’interpréter le monde et l’existence. Un signe qui ne trompe pas est que très peu d’œuvres littéraires écrites pour défendre un régime ou une idéologie autoritaires survivent. Comme le dit Camus dans son Discours de Suède : « Les tyrans savent qu’il y a dans l’œuvre d’art une force d’émancipation qui n’est mystérieuse que pour ceux qui n’en ont pas le culte » .
Dans quelle mesure cette vision de la littérature très brièvement esquissée peut-elle nous aider à mieux comprendre les rapports ambigus et souvent conflictuels entre la littérature et le pouvoir nationaliste et identitaire ? D’où vient, par exemple, le prestige dont jouit la littérature même dans les cercles de la société qui voudrait lui mettre un harnais ? D’abord, ne l’oublions pas, il y a le prestige dont jouit l’écrit en général. C’est un fait que les cultures et les sociétés qui n’ont pas d’écriture sont souvent considérés comme plus « primitives » ou « incultes » que celles qui possèdent l’écriture. La dévalorisation de la culture celtique ancienne par rapport à la culture romaine vient sans doute largement de là, et cela même si les Celtes de toute évidence avaient choisi de ne pas pratiquer l’écriture.
Cependant, si la littérature occupe une place privilégiée et particulièrement prestigieuse parmi toutes les formes d’écriture, il me semble que la raison profonde est à chercher dans le fait qu’une certaine littérature, celle que je viens d’appeler la littérature d’imagination, est l’expression de ce que l’homme a de plus humain, à savoir la liberté. La littérature est valorisée parce qu’elle peut accomplir quelque chose que d’autres arts et d’autres genres de textes ne peuvent pas accomplir aussi bien, à savoir proposer, de manière heuristique si l’on veut, d’autres modes d’être et d’autres façons d’employer le langage pour mieux communiquer et pour mieux se comprendre. La littérature d’imagination existe parce que nous avons besoin de savoir que le monde, dont fait partie la langue, peut être autre qu’il ne l’est . La force de la littérature n’est ni de donner des leçons, ni d’être un document véridique, mais réside dans cet appel à la liberté du lecteur dont parlait Sartre. Cela veut dire que l’œuvre littéraire doit inviter le lecteur à participer à la construction du sens et à l’insertion de ce sens dans sa propre vie. Cela veut dire que l’œuvre littéraire doit aider le lecteur à exercer sa capacité de liberté et d’imagination. Cela veut dire que la littérature doit être une main tendue, une offre, une possibilité, qui laisse le lecteur libre de réfléchir, de sentir et de réfléchir. L’écrivain, en s’imaginant autre, en imaginant l’existence de l’autre et en imaginant d’autres existences possibles, donne au lecteur une chance de se demander sérieusement s’il faut rester le même ou devenir autre et si la société doit continuer à être ce qu’elle est. La grandeur de Don Quijote est là : il nous fascine parce qu’il a choisi, avec beaucoup d’humanité, une autre vision du monde et une autre vie que celles tristement réalistes des gens qui l’entourent. Don Quijote, tout simplement, nous fait rêver d’autres vies possibles. Sans Don Quijote et d’autres héros et héroïnes imaginaires comme lui, la liberté des êtres humains serait encore plus piétinée et réprimée que ce n’est déjà le cas.
Fondamentalement, le prestige de la littérature vient de cet appel à la liberté et à l’humanité de l’être humain. Il est intéressant de remarquer que les dictatures communistes, qui prétendaient avoir pour objectif de libérer les hommes opprimés, valorisaient malgré tout la littérature plus que les dictatures qui étaient — et qui sont toujours — basées sur l’oppression pure et simple. On constate également que la littérature occupe une place importante lorsqu’un peuple opprimé cherche à se libérer du joug qui pèse sur lui. La littérature des noirs aux États-Unis, celle des femmes depuis quelques décennies, celle dite prolétarienne en Suède et celle des anciennes ou actuelles colonies aux Caraïbes en sont des exemples. Ceux qui pensent que la littérature est naturellement de gauche n’ont pas entièrement tort, si par gauche on entend une gauche libertaire et pleinement humaniste qui défend la liberté de chacun plutôt que la liberté de tous . Il est également significatif que ceux qui détiennent le pouvoir, qu’ils soient de gauche ou de droite, ont tendance à vouloir neutraliser la portée émancipatrice de la littérature en la définissant comme de l’art pour l’art.
J’irai jusqu’à formuler cette loi, qui n’est pas sans exceptions, comme toute loi dans la sphère humaine : plus il y a de liberté dans une société, moins important est le rôle social et politique de la littérature. Plus il y a de contrainte et d’oppression dans une société, plus important est le rôle social et politique de la littérature. L’illusion, évidemment, serait de croire que la liberté est déjà acquise dans les démocraties occidentales et que, par conséquent, la littérature n’a plus aucun rôle important à jouer. C’est plutôt le contraire qui est vrai.
Résumons : si la littérature jouit d’un prestige privilégié, c’est parce qu’elle est l’expression et l’incarnation de ce qui nous rend humains, à savoir la liberté, cette marge d’action que nous avons ou que nous pouvons acquérir par l’imagination face aux déterminations génétiques, sociales et culturelles. . Mais c’est également pour la même raison que le statut de la littérature dans la société est ambigu. En effet, l’imagination est dangereuse pour le pouvoir parce qu’elle est imprévisible et parce qu’elle contient en germe la liberté de se concevoir autre et de vivre autrement.
En même temps, il est important de souligner qu’une vie, une société, une passion, une douleur, une pensée ou un langage inventés de toutes pièces et mis en forme littéraire peuvent très bien réellement exister dans la réalité. Lorsque Paul Ricœur déclara à une conférence à Copenhague il n’y a pas si longtemps qu’il y avait plus de vérités à découvrir sur l’être humain chez Shakespeare que chez tous les philosophes du XXème siècle réunis, ce n’était pas seulement une boutade. En effet, ce n’est pas parce que la littérature est invention ou imagination qu’elle est nécessairement mensonge ou illusion. De la même manière qu’une hypothèse scientifique peut se révéler juste ou erronée, une conjecture littéraire imaginée peut très bien se voir vérifiée dans la réalité.
La littérature est donc doublement dangereuse pour ceux qui veulent détenir le monopole du savoir et de l’interprétation du monde. D’un côté, par son caractère utopique et imaginaire, la littérature peut inciter le lecteur à changer sa vie, ses attitudes, ses opinions, son langage et ses sentiments. De l’autre, la littérature peut tout autant dévoiler le monde tel qu’il est. La littérature s’inscrit donc dans une tension constante entre le réel et l’imaginaire, entre la vérité et l’hypothèse, entre le réalisme et le symbolisme, entre la révélation de ce qui est et le rêve de ce qui pourrait être. C’est pourquoi, aussi, les plus grandes œuvres littéraires, celles qui durent et qui marquent, sont à la fois réalistes et romantiques.
Il est évident que ce statut ambigu de la littérature et sa nature hétérogène pose un problème pour l’écrivain qui veut mettre sa plume au service d’une cause, d’une identité ou d’une idéologie particulières. Si l’écrivain cherche à convaincre son lecteur de l’excellence de telle idéologie ou de telle identité au dépens d’autres idéologies ou d’autres identités, il court de grands risques de créer une œuvre autoritaire qui desservira la cause qu’il veut défendre. En effet, la littérature qui ne fait que copier le réel existant, même avec du style, reste une littérature amputée de ce qu’elle a de plus précieux et sera sanctionnée par l’oubli et l’ennui. Si en revanche l’écrivain choisit d’appeler à la liberté du lecteur, la seule idéologie qu’il défendra sera celle d’un humanisme libertaire. On peut rappeler que tous les écrivains catholiques de quelque envergure ont été en partie hérétiques et plus universalistes que catholiques. C’est là la grande différence entre la littérature et la plupart des religions ; là où certaines religions prétendent détenir la vérité, la littérature interroge la vérité, toutes les vérités, y compris celles de la foi. Il y a de grandes œuvres littéraires écrites par des musulmans, par des Basques, par des communistes et par des femmes, mais il n’y a pas de grande littérature musulmane, basque, communiste ou féministe.
Que doit donc faire l’écrivain breton ou écossais, pour ne prendre que ces deux exemples, qui voudra à la fois défendre l’identité bretonne ou écossaise et créér une grande littérature digne de ce nom ? En ce qui me concerne, il n’y a qu’une seule réponse à cette question. Pour défendre une identité, il faut défendre le droit identitaire de tous, pas seulement celui des Bretons ou des Écossais, c’est-à-dire qu’il faudra — encore une fois — défendre ce que l’être humain, tous les êtres humains, ont de plus humain, dont la liberté de choisir sa vie et son identité. Le particularisme, le régionalisme, l’exclusion, la réclusion, la peur de l’autre et le repli sur soi amèneront vite la mort de la littérature. Un écrivain breton ou écossais pourra très bien raconter sous forme de roman la lutte pour l’indépendance des deux pays respectifs. Il pourra même imaginer une histoire et un monde où cette indépendance est déjà acquise. Mais ce qu’il ne pourra pas faire, c’est de prescrire ou cautionner la lutte pour cette indépendance. Ou plutôt, s’il veut essayer de convaincre son lecteur de la légitimité des revendications identitaires particulières, il faudra le faire en dehors de la littérature.
On comprend alors pourquoi le nationalisme ne fait pas bon ménage avec la littérature. L’écrivain qui se soumet à une idée préconçue d’une identité ou d’une nation sera toujours perdant comme écrivain, même avec les meilleures intentions du monde. L’écrivain doit rester libre de ses mouvements. Il doit toujours interroger par l’imaginaire la représentation du monde autour de lui. Il doit toujours combattre les stéréotypes et les expressions toutes faites du langage. Mais on comprend également mieux pourquoi l’écrivain africain ou breton qui dans sa littérature dénonce un régime autoritaire ou oppressif peut se le permettre sans trahir la littérature : tant qu’il se contente de raconter et de dénoncer l’oppression et la contrainte, il reste du bon côté de la liberté. Mais dès qu’il commence à définir dans la littérature même le bon usage de la liberté, il commence aussi à compromettre cette même liberté.
Pour revenir au point de départ : un écrivain breton qui recevrait un jour le prix Nobel de littérature, parce qu’étant un écrivain de portée universelle, qu’il écrive en breton, en français ou dans une autre langue, rendrait beaucoup plus service à la cause bretonne qu’un écrivain qui essaierait à tout prix de raconter au monde ce que c’est que d’être breton et rien d’autre.
Pour terminer cet article plus explorateur que scientifique, plus littéraire que théorique, j’oserai peut-être donner quelques conseils aux écrivains qui se retrouvent face au dilemme d’appartenir à une minorité qui doit défendre sa liberté et son identité, mais qui en même temps refusent de trahir ce que la littérature a de plus précieux.
Aux écrivains je dirai :
N’écrivez pas pour être de quelque part. Écrivez pour montrer qu’il y a des humains partout.
N’écrivez pas pour séparer, mais pour lier ; pas pour défendre une identité, mais pour la questionner et pour défendre le droit de tous d’en avoir une dans la dignité.
N’écrivez pas pour défendre une seule identité particulière ou l’idée de la nation, qui est toujours contraignante. D’autres s’occuperont de vous nationaliser. Si, absolument, vous devez écrire au nom d’un groupe, défendez le groupe des êtres humains, un pays plutôt que la Nation, une contrée plutôt qu’un État, un paysage plutôt qu’un pays.
La littérature ne doit pas contribuer à faire des nations, mais à les défaire. Situez vos mondes imaginés dans le local, si vous voulez, mais racontez ce qu’il y a d’universel dans le local, jamais le contraire.
En littérature, c’est comme dans la vie : si vous parlez trop de vous sans écouter ce que disent les autres, vous devenez bientôt très seul et passez pour être autoritaire, non sans raison.
Donnez toujours à votre lecteur les moyens de ne pas être d’accord avec vous.
J’ajouterai ce précepte, emprunté à l’écrivain norvégien Jens Bjørneboe : « Écrivez de telle manière que chaque mot peut être retourné contre vous ! ».
Si vous arrivez à raconter ce que l’être humain a de plus humain, même lorsque vous racontez les pires horreurs commises par l’homme, on vous dira peut-être « Tiens ! même un Breton arriéré, même un Basque borné, même un Palestinien extrémiste est un être humain ». Et vous aurez gagné le pari de la littérature et de la vie en communauté.
