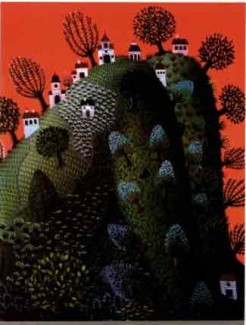 Marqué par l’uniformisation du monde et la perte progressive du sentiment du divers, le monde vit de plus en plus dans le doute et dans un sentiment d’insécurité sous la « menace » de nouveaux barbares venant de l’extérieur avec une culture, une religion, une manière de vivre différentes. Oyez ce qui se passe aujourd’hui dans les cités des ban lieues où des jeunes assiégés dans leur ghetto hurlent leur révolte sociale dans une malencontreuse violence contre l’ignorance et le mépris.
Marqué par l’uniformisation du monde et la perte progressive du sentiment du divers, le monde vit de plus en plus dans le doute et dans un sentiment d’insécurité sous la « menace » de nouveaux barbares venant de l’extérieur avec une culture, une religion, une manière de vivre différentes. Oyez ce qui se passe aujourd’hui dans les cités des ban lieues où des jeunes assiégés dans leur ghetto hurlent leur révolte sociale dans une malencontreuse violence contre l’ignorance et le mépris.
Or la menace des barbares ne vient pas tant de l’extérieur, de la présence des sans papiers ou des jeunes noirs et maghrébins des cités que l’on traite comme des sauvages primitifs, et qui, stigmatisés, renvoient aujourd’hui l’image conforme au regard. Non, cette menace, ‘ (je partage cette idée jadis développée par le philosophe espagnol Ortega y Gasset) vient de l’intérieur, c’est-à-dire de la transformation des personnes cultivées en barbares.
L’exemple du statut du livre aujourd’hui, de l’édition française qui donne la priorité à ce qui se vend, à l’inessentiel, pratiquant l’occultation et le mépris vis-à-vis de l’essentiel, et qui stagne dans le tunnel du cynisme et de l’insignifiance, montre ce que peut être le recul de la culture et l’avancée larvée mais déterminée de la barbarie. C’est ainsi que, dans la fiction, cela se traduit par une littérature essentiellement constituée d’une sorte d’angoisse existentielle, travestie dans une littérature du gémissement, fondamentalement occupée à exprimer la grabatisation mentale des auteurs garrottés par leur mal-être.
Toute une culture littéraire pathologique se développe en France et on explique aux jeunes auteurs qu’il n’y a point de salut sans gémissement. je lis par exemple un compte rendu littéraire où la journaliste s’ébaudit de ce que l’auteur circonscrit son propos aux « blessures familiales (fraternelles ou filiales): l’abandon, la perte, le deuil, la maladie, l’impossibilité d’aimer, la solitude, le silence… » Et on pourrait continuer ainsi, en ajoutant à la litanie des névroses les angoisses de la vieillesse, de la déchéance, de la maladie et tutti quanti. A un point tel que les oeuvres de fiction sont devenues aujourd’hui, à travers l’obsession des auteurs, de véritables journaux intimes restituant le mal-être de ces derniers, lesquels cherchent désormais à toucher ce qu’un écrivain très justement
appelle « les dividendes des perversions humaines ». Et j’ajoute qu’est ainsi offert au lecteur le voyeurisme des perversions de toutes sortes, où il s’agit pour l’auteur d’être le plus choquant possible, ce qui serait une nouvelle forme de liberté. Quand ce ralliement à la perversion cherchant à vendre masochisme, sadisme, scatologie, pédophilie, travestisme, échangisme, zoophilie et j’en passe, n est en réalité qu’un ralliement à l’exigence d’un marché intraitable.
Nous sommes bien sûr aux antipodes des conditions qu’Antonin Arthaud définissait pour une oeuvre réussie: «… un certain niveau formel et une grande pureté de matière ».
Cette perception de la grabatisation, marquant la déchéance de ce qu’il est très justement convenu d’appeler « l’industrie du livre », interpelle aujourd’hui la conscience des auteurs qui demeurent fidèles à une littérature de qualité. A ce titre, je voudrais vous ci ter l’analyse de l’écrivaine croate Dubravka Ugresic, romancière et essayiste traduite en une dizaine de langues, et qui remarque que désormais, dans l’édition, « la médiocrité s’est imposée » et que « produire des livres ne signifie pas produire de la littérature ». Mais cette écrivaine pleine d’humour a poussé son enquête jusqu’à envoyer à des éditeurs, ayant pignon sur rue, des chefs d’oeuvres de la littérature mondiale comme « L’Homme sans qualité » de Musil, Les Mémoires d’Hadrien de Marguerite Yourcenar et La Mort de Virgile de Hermann Broch, je vous laisse deviner la négativité de la réponse faite à propos de ces livres.
Cependant, je ne résiste pas à vous citer ce qu’elle dit du livre du Prix Nobel Gabriel Garcia Marquez: « J’ai récemment envoyé à un directeur littéraire Cent ans de solitude.- Laissez tombé cette histoire, m’at-il déclaré. Elle est si embrouillée que personne ne s’y retrouvera. Cependant, il n’y a pas de raisons que nous ne trouvions à utiliser ce merveilleux titre. » (fin de citation)
je vous signale d’ailleurs que la maison d’édition la plus prestigieuse en France avait refusé la traduction de ce roman à sa sortie.
Le sens de nos réflexions est précisément de soumettre notre littérature à ces questions. Et vous vous rendrez compte que notre littérature, pour l’essentiel et pour l’instant – car j’ai pleine conscience que nous ne sommes pas à l’abri des singeries – se tient à l’écart de cette littérature de gémissement et de divertissement facile.
Nous continuons d’explorer l’histoire, conscient des risques de l’oubli, nous explorons notre époque pour dire ce qu’est devenue notre coexistence, pour dire nos folies et nos joies, nos misères et nos turpitudes. Et si j’ai naguère souhaité plus de buissons ardents et de feux d’artifices dans cette littérature, il demeure que cette expression est certainement, avec notre musique et nos arts plastiques, l’un des secteurs identitairement les plus sains de notre société.
En élargissant l’espace littéraire à ce qui s’écrit en Amérique latine et aux Caraïbes nous pouvons remarquer avec Carlos Fuentes que la fiction dans nos pays se caractérise certes par une « écriture individuelle, mais qui en même temps propose de recréer une communauté blessée » et par des écritures qui apportent un traitement particulier aux langues et aux langages conflictuels, écritures incluant « toutes nos formes verbales: impures, baroques, contradictoires, syncrétiques, polyculturelles. » je voulais ici souligner cette richesse, marquer aussi notre différence en la positivant. Et affirmer, à travers l’exemple de la littérature, que les nouveaux barbares ne sont pas ceux que l’on croit.
André LUCRECE,
Ecrivain.
07-12-05
