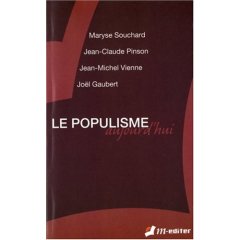Éditions M-Editer, 2007, 110 pages, 10 € ISBN : 978-2-915725-07-0
|
|
|
|
Après les ouvrages fondamentaux parus ces dernières années, Par le peuple, pour le peuple. Le Populisme et les démocraties (Fayard, 2000), de Yves Mény et Yves Surel, et L’Illusion populiste (Berg, 2002), de Pierre-André Taguieff, voici un petit volume d’intérêt public qui, regroupant quatre textes issus des conférences organisées à l’Université Populaire de Nantes par l’Association Philosophia, devrait être dans toutes les mains en cette période d’élections – présidentielles puis législatives.
Héritier de la Révolution, du bonapartisme et du boulangisme au Régime de Vichy, comme au poujadisme et au Front National, le populisme, que Maryse Souchard définit comme l’appel lancé par un chef à un peuple survalorisé (vox populi, vox dei), s’est accompagné en France de paternalisme, d’anti-élitisme et d’un nationalisme plus ou moins xénophobe et antisémite. Aussi, par populisme, faut-il entendre “tout mouvement, doctrine ou idéologie qui prétend exprimer, à la place d’un peuple muet et paralysé, les désirs de ce “peuple” en agissant à sa place, incarnant dans un chef la volonté du peuple ainsi directement représenté” (p. 19).
Le problème actuel, c’est la contamination sémantique entre “populisme” et “valeurs démocratiques”. Et la spécialiste en communication de nous mettre en garde contre deux dangers antithétiques : d’une part, la dérive réactionnaire, qui prend appui sur la défiance envers toute référence au peuple pour justifier la domination des élites, alors même qu’il ne saurait y avoir de démocratie sans lutte pour l’émancipation sociale et politique des dominés ; d’autre part, la dérive populiste propre aux courants extrémistes, qui consiste à tenir un discours alarmiste jouant sur les peurs les plus irrationnelles et à prôner le relativisme absolu, c’est-à-dire à poser l’équivalence de tous les discours, pour mieux disqualifier des élites sociales et intellectuelles rendues coupables de mensonge et de manipulation, et légitimer ainsi sa propre idéologie et/ou son propre chef. Le pire est que le second travers touche également les médias, qui y voient un moyen de conforter leur pouvoir – ce que montre Maryse Souchard en analysant la rhétorique de l’hebdomadaire Marianne.
Mais qu’est-ce qu’en appeler au peuple ?, se demande Jean-Michel Vienne, soulignant l’ambiguïté d’un terme dont l’usage est régi par une série de tensions : “peuple inclusif / peuple exclusif”, “populace / peuple organisé”, “peuple sachant / peuple ignorant”, “réalité sociale / notion idéale”, “réalité géographique / réalité politique”, “classe inférieure / classe rédemptrice”, “peuple traditionnel / peuple eschatologique”. Parce qu’elle considère le “peuple” comme une réalité en soi, la posture populiste est une dangereuse imposture.
Avec la surmédiatisation, la crise de la représentation est l’autre cause principale expliquant le retour actuel du populisme. Pour Joël Gaubert, elle est due à la prédominance des intérêts particuliers sur l’intérêt général ainsi qu’à l’avènement d’une “oligarchie techno-libérale” (p. 91), c’est-à-dire à l’impuissance d’un parlement qui incarne la souveraineté du peuple face au pouvoir exécutif national et supranational, auquel s’ajoutent le pouvoir médiatique et le pouvoir économique des multinationales et des instances mondiales (FMI, OMC, BM, OCDE…). Mais, pour le philosophe, cette crise est avant tout symbolique : dès lors que la démocratie s’est transformée en médiacratie et en médiocratie, peut-elle engendrer autre chose qu’une crise du sens ? De sorte que le meilleur remède ne réside pas tant dans un modèle participatif dont les risques majeurs sont l’autocratie et le populisme, voire l’anarchie à laquelle aboutirait la dissolution du pouvoir légitime dans de multiples groupes d’intérêts particuliers (lobbies), mais dans un système délibératif qui procèderait à la “resymbolisation de l’expérience” en développant l’instruction et l’”éthique de la discussion” (Habermas).
En cette campagne présidentielle où l’étiquette péjorative de “populiste” a été accolée aux trois candidats arrivés en tête du premier tour, chacun aura le loisir de se faire une idée au regard de ces analyses.
Cela étant, après avoir rappelé que le terme même de “populisme” est apparu en 1912 pour désigner une école romanesque visant à décrire de façon réaliste la vie du peuple, Jean-Claude Pinson quitte le champ politique pour le champ esthétique, où il entend “saisir les conditions de cette démagogie insidieuse et doucement endoxique plutôt que brutalement idéologique qu’est aujourd’hui la logique du populisme” (p. 37). Car, pour ce lecteur de Bernard Stiegler, le populisme est favorisé par un monde où la télévision véhicule un individualisme de masse indissociablement lié à l’”ethos démocratique” contemporain ; où l’expérience sensible, parce que médiatisée, n’a plus rien d’authentique ni d’esthétique ; où l’extinction de la sublimation artistique a pour corollaire l’aliénation à la société de consommation. Et pour le poète-philosophe, la seule façon de résister au “populisme culturel”, c’est-à-dire à la “désublimation engendrée par la domination du capitalisme culturel” (p. 46), ressortit moins à la logique avant-gardiste – qui oppose à la culture de masse une “politique de la forme résistante” (Adorno) – qu’à une logique rhizomatique de la “raison artistique”, plus conforme à l’ethos individualiste actuel : il ne s’agit plus d’en appeler à un “peuple qui manque” (Klee), mais de faire advenir le “devenir artiste” (Deleuze) des individus. Reste à savoir l’impact social et esthétique d’une “logique créative” qui, pour être moins ambitieuse que la révolution avant-gardiste, n’en est pas moins presque aussi utopique.
![]()
Le populisme aujourd’hui
Un ouvrage de Maryse Souchard, Jean-Claude Pinson, Jean-Michel Vienne et Joël Gaubert (M-editer, 2007, 109 p., 10€)
Par Igor Martinache [1]
Si les modes existent en politique, le populisme semble bel et bien être celle du moment. Depuis quelques années, la notion est employée à toutes les sauces : pour désigner aussi bien la montée des partis d’extrême droite sur le continent européen, l’avènement de régimes de gauche en Amérique du Sud, mais aussi certaines formes nouvelles de communication politique dans les partis dominants, et autres dispositifs visant à faire progresser la « démocratie participative ». Bref, à trop être employé, le concept a fini par perdre son sens, par devenir un de ces mots creux qui servent moins à alimenter le débat qu’à disqualifier ses adversaires. Il était donc temps de chercher à lui redonner un peu de substance. C’est du moins ce que ce sont dits les co-auteurs du Populisme aujourd’hui.
L’ouvrage est en fait la retranscription d’un cycle de conférences donné dans le cadre de l’Université Populaire de Nantes. Quoi de plus logique dans un tel projet que de s’interroger sur ce qu’est le peuple, et, plus encore, sur la manière de s’adresser à lui ? D’autant que, comme le remarque d’emblée Maryse Souchard, maître de conférences en communication à l’Université de Nantes, peu d’ouvrages ont en fait été directement consacrés à la question du populisme. S’appuyant sur certains d’entre eux, elle retrace ainsi la genèse du terme. Apparu au dix-neuvième siècle, celui-ci désigne dès l’origine des réalités très différentes, voire parfois contradictoires, selon les aires géographiques concernées. Maryse Souchard retient cependant deux acceptions principales du populisme, qui ne se recoupent pas nécessairement. L’une, essentiellement symbolique, consiste à « survaloriser, surestimer la valeur de la pensée, de la culture, des pratiques populaires », tandis que l’autre, plus directement politique, désigne les comportements consistant à d’ « adopter une attitude paternaliste à l’égard du ‘peuple’ en disant à sa place ce qu’il ne serait pas ‘capable’ d’exprimer ». Cette stratégie discursive des bourgeois s’est ainsi véritablement développée à la Révolution française, mais a pu ensuite être stigmatisée dès qu’elle a pris la forme du bonapartisme. Le « national-populisme » que nous pouvons encore voir à l’œuvre aujourd’hui est lui né avec le boulangisme. Cela n’empêche cependant pas Maryse Souchard d’en discerner de nouvelles formes aujourd’hui, dans la « société du micro-trottoir et de la connaissance spontanée », qu’incarne par exemple la ligne éditoriale d’un journal comme Marianne.
Enseignant la philosophie de l’art à l’Université de Nantes, Jean-Claude Pinson rappelle pour sa part que le populisme n’est pas seulement une question politique, mais ressortit à « tout un soubassement dans l’ordre des mœurs dans l’ordre de la « substance éthique » ». La différence cependant du discours démagogique par rapport à celui de l’avant-garde, explique-t-il, c’est que le premier s’adresse à un peuple à l’existence supposée, quand le second s’adresse à un « peuple qui manque ». Ce qui fait la force du populisme, c’est précisément de s’appuyer sur l’ethos démocratique. Jean-Claude Pinson revient ainsi sur l’analyse tocquevillienne de l’égalité, en rappelant que celle-ci est d’abord un sentiment, une affaire « esthético-éthique », avant d’être un état. Or, c’est précisément ce qui le rend sensible à la grammaire démagogique. « L’affect démagogique est facilement abusé par celui qui utilise la grammaire de l’égalité pour asseoir l’inégalité » (p.40). Or, selon l’auteur, l’outil télévisuel se prête particulièrement bien à cette séduction populiste. Pour le contrer, Il met en avant la « multitude artiste », troisième terme à côté de la culture de masse et l’art avant-gardiste, qui se traduit par l’exercice par chacun de sa « créativité dispersée, tactique et bricoleuse », explique-t-il en reprenant les termes de Michel de Certeau dans L’invention du quotidien.
Spécialiste de Locke, Jean-Michel Vienne s’intéresse pour sa part aux différentes sens possibles du mot « peuple ». Il en recense six principaux : le « on » indéfini et universel ; les autochtones, habitants d’un territoire donné ; la « populace » dangereuse et incontrôlable ; le prolétariat ; la communauté politiquement organisée ; et enfin le peuple « choisi » dans une acception originellement religieuse. Par un exercice de logique, il montre ensuite comment ces différents sens ont pu se mêler pour former autant de couples d’antonymes. C’est qu’en fait, le « peuple » est une notion éminemment dialectique, et par là même, n’est pas une réalité stable, mais « un mouvement qui se définit par sa constitution jamais achevée, mouvement entre les différentes tensions qui circonscrivent son champ d’action […] Le peuple est vivant, et comme tout vivant, il doit s’adapter à son environnement. La culture [populaire] est l’adaptation même à cet environnement » (p.74).
Professeur de philosophie en classe préparatoire, Joël Gaubert se penche enfin sur la « crise de la représentation en politique ». Il passe tour à tour en revue les fondements théoriques puis l’application pratique- c’est-à-dire l’expérience historique- du modèle représentatif puis du modèle participatif. Le second était censé résoudre les contradictions du premier, mais est à son tour entré en crise. S’appuyant notamment sur l’« éthique de la discussion » telle que définie par Jürgen Habermas, Joël Gaubert avance ainsi que la solution pourrait bien résider dans un troisième modèle, dit délibératif. Synthèse d’une certaine manière des deux précédents, celui-ci suppose la « participation active de tous les citoyens dans des assemblées populaires », représentées ensuite par les assemblées de deuxième degré, mais aussi troisième et même plus (régional, national, européen et mondial, comme à l’ONU par exemple)… Cela suppose la médiation nécessaire de l’institution scolaire, contre ce que l’auteur nomme la « désymbolisation régressive des esprits », tout en notant d’ailleurs que l’école est justement ignorée aujourd’hui dans les débats sur la question, mais aussi la reconstruction d’alternative, contre le principe « T.I.N.A. » (« There is no alternative ») popularisé par Margaret Thatcher.
Bien qu’adoptant un angle résolument philosophique, ce petit ouvrage fournit cependant quelques éléments de réflexion utiles aux sociologues, sans parler évidemment des citoyens. Ce qui est loin d’être superflu dans une période où, pour paraphraser un célèbre slogan, le populisme semble partout, et le peuple nulle part.
[1] Agrégatif en sciences économiques et sociales à l’ENS Lettres & Sciences Humaines.