Essai sur la valorisation du meurtrier de masse dans la littérature, les arts, la pensée et l’impensé contemporains.
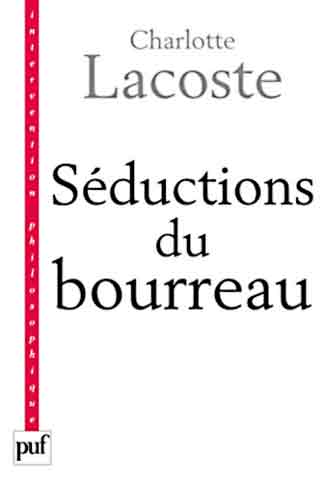 INTERVIEW – Commémoration du génocide au Rwanda, figure du nazi dans la littérature, centenaire de la Grande Guerre… « Séductions du bourreau » nous rappelle qu’il ne faudrait pas que la fiction éclipse le témoignage.
INTERVIEW – Commémoration du génocide au Rwanda, figure du nazi dans la littérature, centenaire de la Grande Guerre… « Séductions du bourreau » nous rappelle qu’il ne faudrait pas que la fiction éclipse le témoignage.
Comment en êtes-vous venue à vous intéresser à la représentation du bourreau dans la littérature?
Je n’y suis pas venue par fascination pour la figure du meurtrier. Ma thèse portait sur les témoignages de victimes de violences politiques qui ont pris la plume pour décrire leur expérience. Or je me suis aperçue que leurs récits avaient trouvé peu d’échos auprès du public, qui s’est toujours montré plus attiré par la prose flamboyante des romans historiques. Ce désintérêt est aussi vieux que le genre : lors de la Première Guerre mondiale déjà, la probe simplicité des témoignages avait nui à leur reconnaissance, le roman de guerre bénéficiant d’un préjugé favorable. C’est ce qui explique que les textes les plus lus aujourd’hui encore à propos de la Grande Guerre soient les romans de Barbusse et Dorgelès. Cela explique aussi l’engouement que suscitent, à chaque rentrée littéraire, les romans portant sur les événements majeurs du siècle passé. Outre que l’on a tendance à réduire la littérature à la fiction, il semble y avoir un consensus autour de l’idée que cette dernière est seule à même de rendre compte de la violence extrême. Je travaillais là-dessus quand est paru, en 2006, le roman de Jonathan Littell, Les Bienveillantes. Il s’agit du récit rétrospectif d’un officier nazi (fictif) nommé Maximilien Aue, qui a séduit l’intelligentsia française. Le succès colossal des Bienveillantes a contribué à entériner une certaine image du bourreau, et à en faire l’un des héros de notre temps.
« Séductions du bourreau » est sous-titré « Négation des victimes »…
C’est l’envers et l’endroit du même problème. Le témoignage de Shlomo Venezia, Sonderkommando, est sorti la même année que Les Bienveillantes, mais on n’en a guère entendu parler. Les témoignages des survivants continuent à être éclipsés par les romans historiques, romans de guerre ou d’extermination. Ces derniers, du Feu, d’Henri Barbusse (Goncourt, 1916) aux Bienveillantes, de Jonathan Littell (Goncourt, 2006), utilisent souvent les mêmes recettes (extrême mobilité de l’instance narrative, intrigue à rebondissements, maniement d’un certain pathos, succession de scènes d’horreur, etc.), au regard desquelles la prose testimoniale fait pâle figure. Avec leur déploiement d’invraisemblances, ces romans confirment le lecteur dans ses préjugés : les auteurs de témoignage eux-mêmes nous incitent, concernant la littérature de guerre, à faire preuve d’exigence et d’esprit critique.
La parole des bourreaux mérite-t-elle d’être écoutée?
Les propos des criminels politiques sont intéressants si l’on cherche à se renseigner, par exemple, sur la part d’automystification nécessaire au passage à l’acte. Pour tuer, le meurtrier se ment à lui-même ; pour se faciliter la tâche, il ment à ses victimes ; pour se dédouaner, il ment à ses juges. Le bourreau n’a pas de parole. On assiste néanmoins à l’ascension du point de vue nazi dans la fiction sur l’extermination. Max Aue, nazi fictif, a réussi à se faire passer pour un « témoin historique fiable ». Prétendre que la parole d’un bourreau fictif vaut celle d’une victime assermentée qui dépose devant l’Histoire, c’est entretenir une confusion dangereuse.
L’image du nazi cultivé est récurrente dans les fictions.
Dans nombre de films et de romans contemporains, on grime le bourreau de différentes manières, ce qui contribue à sa réhabilitation. Ainsi le nazi est-il immanquablement représenté en homme cultivé, intelligent, mélomane. Outre que l’image du SS raffiné va à l’encontre des témoignages des victimes insistant, eux, sur la bestialité de leurs tortionnaires, il convient de rappeler qu’être cultivé ne consiste pas à lire de manière frénétique, mais à comprendre ce qu’on lit afin d’en retirer une conscience. À force de parer les nazis de toutes les vertus, on finit par faire d’eux des surhommes, ce qui correspond à l’image qu’ils cherchaient à donner d’eux-mêmes. Le roman, qui n’échappe pas à l’idéologie, peut ainsi perpétuer sans en avoir l’air un mythe nazi. La mauvaise littérature n’est-elle pas celle qui propage l’erreur?
Les romanciers veulent s’interroger sur l’origine du mal à travers la figure du bourreau.
Lire la suite sur le Jdd.fr
http://www.lejdd.fr/Culture/Livres/Charlotte-Lacoste-Le-devoir-de-memoire-est-devenu-un-slogan-productiviste-662577
Marie-Laure Delorme
