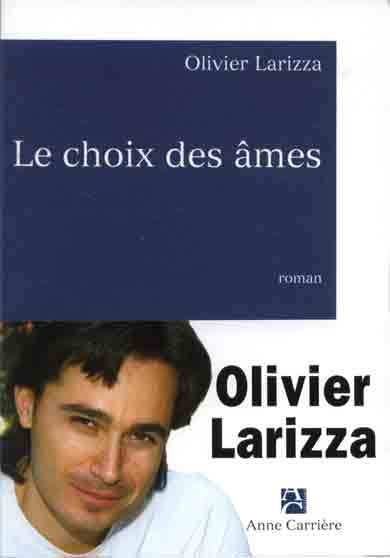
—Par Roland Sabra —
C’est une histoire d’hommes. Une histoire d’hommes dans la tourmente de la première Guerre Mondiale. Une montagne d’Alsace, le Viel-Armand, surnommée HWK pour « Hartmannswillerkopf », est l’enjeu d’un combat aussi absurde, que meurtrier. Des milliers de soldats de chaque coté du front vont mourir là sans que les positions d’un des deux camps aient fini par bouger à la fin du conflit. Le narrateur, qui parle à la première personne du singulier est un horloger de trente-deux ans qui, dans la boucherie, fait figure de survivant et donc de vétéran. A quoi rêve Gaspar? Á sa Doudou martiniquaise, grosse de ses œuvres et qui l’attend dans la maison familiale. L’attente est longue, à l’arrière comme au front. La mort est là omniprésente et le cœur de hommes se donne à dire sur les présences plutôt que sur les absences. Il y a là d’autres hommes dont les vies, comètes dans le ciel de la guerre, ne pèseront pas plus que la lumière éphémère qui les soutient. Surtout il y a Louis. « Parce que c’était Louis, parce que c’était moi » « Lui le Royal et moi le Just« . Entre Montaigne et la Boétie, Olivier Larizza nous conte une belle histoire d’amour, toujours pudique, toujours réservée, entre deux hommes, qui pour survivre s’inventent des lendemains de communion. La Doudou, aussi improbable que le prénom qu’elle porte, Natacha, apparait comme un personnage secondaire, dont la trace dans la construction du récit, tient plus aux attaches martiniquaises de l’auteur qu’à une réelle nécessité littéraire. Elle fonctionne comme un contrepoids, un paravent, un garde-fou à cet élan qui pousse Gaspar et Louis l’un vers l’autre pour survivre. L’acte douloureux par lequel Gaspar va s’extraire de l’enfer s’il lui permet de retrouver sa douce et leur fils Noé fera de lui « un demi homme, mais un père à part entière » comme Larizza l’écrit joliment. A méditer en ces lieux où les hommes à part entière (c’est-à-dire s’imaginant non castrés) sont à peine des demi-pères.
L’écriture est alerte, vive et elle emprunte des tournures d’une autre époque, plus proche de nous que de celle dont il question dans le récit. Il y a des passages, dans lesquels la ponctuation disparaît, alourdissant tout à coup, l’atmosphère du récit. La mise en page, (notamment page 157), participe à la restitution d’une oppression obsédante qui finit par envahir l’espace privé ou du moins ce qu’il en reste. Olivier Larizza utilise aussi de jolis néologismes comme cette trouvaille de vianderie, tellement bienvenue dans le contexte.
Au delà de l’intérêt historique du livre qui contribue à sortir de l’ombre un évènement sans doute écrasé sous la honte d’un commandement dans lequel les Nivelle et autres bouchers furent plus nombreux que ceux que l’histoire retiendra, on aura du plaisir à découvrir un écrivain dont on pressent que le désir de paternité concerne davantage la littérature que les langes à changer de marmots en surnuméraires.
A trente-deux ans, l’âge du narrateur faut-il le rappeler, Olivier Larriza, Maitre de Conférence en littérature anglaise à l’UAG, est déjà l’auteur d’une dizaine d’ouvrages. il nous offre là un roman à la fois historique et très personnel dans lequel, avec une grande élégance, il souligne l’absolue nécessité de l’amitié entre les hommes, au-delà des rivalités qui les opposent, pour faire du lien social. Il rappelle aussi, ce qui relève du volontarisme dans cette anankè : « Je me rends compte que l’amitié -comme l’amour- n’est pas un sentiment-, ou pas seulement : c’est une construction. Une maison. Sans toi, Louis, je suis sans toit. Rien qu’un homme esseulé, un errant. »
Fort-de-France, le 15/09/08
Roland Sabra
