— Par Yves Charles Zarka —
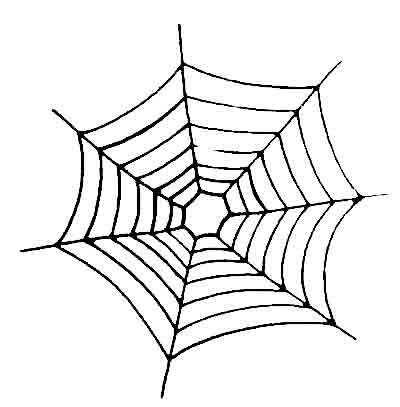 New York 2001, Paris 2015. Le rapport entre ces deux lieux et ces deux dates a été très vite souligné, non en raison du nombre des victimes, mais pour marquer l’ampleur de la signification et le traumatisme provoqué par les massacres de Paris. Ce lien n’est pas artificiel, mais les événements ne sauraient être entendus en termes de répétition à des échelles différentes. Ce qui s’est passé à Paris entre les 7 et 9 janvier derniers ne témoigne pas de la même chose que les attentats du 11 septembre contre les tours du World Trade Center. La crise s’est approfondie, elle s’est intériorisée. Les attentats de Copenhague, le 14 février, dans leur mimétisme avec ceux de Paris, le confirment si besoin était. Contrairement à la lecture en termes de choc des civilisations qui prévalait après New York 2001, Paris 2015 oblige à renoncer à la vision simpliste de deux blocs civilisationnels antagonistes se faisant face et s’affrontant en raison d’idéaux, de valeurs, de religions ou de mœurs, donc de cultures, incompatibles et irréductibles. L’opposition s’est internalisée, elle traverse, quoique en des sens différents, tant les démocraties occidentales que les pays musulmans.
New York 2001, Paris 2015. Le rapport entre ces deux lieux et ces deux dates a été très vite souligné, non en raison du nombre des victimes, mais pour marquer l’ampleur de la signification et le traumatisme provoqué par les massacres de Paris. Ce lien n’est pas artificiel, mais les événements ne sauraient être entendus en termes de répétition à des échelles différentes. Ce qui s’est passé à Paris entre les 7 et 9 janvier derniers ne témoigne pas de la même chose que les attentats du 11 septembre contre les tours du World Trade Center. La crise s’est approfondie, elle s’est intériorisée. Les attentats de Copenhague, le 14 février, dans leur mimétisme avec ceux de Paris, le confirment si besoin était. Contrairement à la lecture en termes de choc des civilisations qui prévalait après New York 2001, Paris 2015 oblige à renoncer à la vision simpliste de deux blocs civilisationnels antagonistes se faisant face et s’affrontant en raison d’idéaux, de valeurs, de religions ou de mœurs, donc de cultures, incompatibles et irréductibles. L’opposition s’est internalisée, elle traverse, quoique en des sens différents, tant les démocraties occidentales que les pays musulmans.
La guerre nouvelle et irrégulière n’oppose pas des ennemis extérieurs appartenant à des camps ou des pays étrangers l’un à l’autre, plus ou moins lointain et se considérant mutuellement comme le mal absolu, mais affecte et s’immisce à l’intérieur de chacun d’entre eux. Comment pourrait-on expliquer autrement que des jeunes gens nés et élevés en France, portant la nationalité française, qu’ils soient musulmans ou non, issus de l’immigration ou non, développent une haine farouche contre ce pays qui est le leur et dont on attendrait qu’il le considère comme tel, quelles que soient leurs difficultés ? Comment expliquer qu’ils puissent se laisser entraîner par une propagande islamiste qui les pousse au meurtre soit en ralliant des bandes armées en Syrie, en Irak, au Yemen ou ailleurs, soit en opérant des assassinats dans les lieux où ils vivent ? A ces interrogations s’en ajoutent d’autres. Comment rendre compte autrement du fait que les mêmes bandes armées, parfois plus puissantes que les Etats régionaux, puissent soumettre à la terreur les populations de pays musulmans, commettre des exactions systématiques contre toute velléité d’opposition à leur conception de la sharî’a et aller jusqu’à soumettre d’autres ethnies ou des populations relevant d’autres religions à l’état d’esclavage quand ce n’est pas à l’extermination pure et simple ?
Les crises sont transversales, mais de nature différente. D’un côté, les pays occidentaux se sont crus immunisés contre un tel risque intérieur par leur système social, leur puissance économique et politique, leur haut niveau de culture et l’institutionnalisation du principe de tolérance des religions. De l’autre, les aspirations démocratiques du « printemps arabe » ont fait oublier un court moment la possibilité du retour de la chape de plomb islamiste qui n’a pas manqué de se refermer sur la plupart d’entre eux, écrasant les aspirations d’égalité et de liberté dans un ordre ou un désordre plus terrifiant encore, et ce n’est pas peu dire, que celui qui prévalait du temps des despotismes personnels. Bien entendu, ces crises ne sont pas du même ordre. Du côté des démocraties, elles résultent à la fois de relégations sociales, de la formation de mémoires imaginaires à travers lesquelles certains jeunes ou moins jeunes s’identifient, et aussi, peut-être surtout, de l’impuissance de plus en plus manifeste du politique face à ces enjeux et de la perte de crédit de l’Etat, en particulier de ceux qui sont censés le représenter. Du côté des pays musulmans, elles tiennent à la force traditionnelle du lien entre société, politique et religion où s’enracinent la puissance de mobilisation des courants islamistes et finalement leur capacité à soumettre par la croyance, l’intérêt ou la terreur des pans entiers de la population. C’est précisément de ces crises profondes et des déchirures qu’elles provoquent que la haine peut naître par projection imaginaire de la cause des maux vécus ou ressentis comme tels sur un individu, une population, un style de vie, un usage jugé excessif et illégitime de la liberté. Mais de la haine à la barbarie, la transition n’est pas continue. Il y faut un moyen terme. La victime doit être représentée comme le mal absolu de sorte qu’à son égard il est non seulement possible mais requis d’user de sévices les plus radicaux, sans considération du plus simple principe d’humanité. Il faut également que le bourreau se représente lui-même comme exécutant d’une mission le plus souvent divine, mais pas toujours, qui lui confère dignité, reconnaissance et récompense. Ce qui veut dire que la barbarie n’a jamais rien de spontané, ni de naturel, elle n’est pas l’acte de « fous solitaires », elle résulte d’un endoctrinement des esprits d’autant plus efficace qu’il s’enracine dans une forme de religion sécularisée. Le même endoctrinement, employant les moyens et les technologies les plus sophistiqués à travers les réseaux sociaux, est susceptible de rendre compte de la promotion du sacrifice de soi dans l’accomplissement de l’éradication de ceux qui sont censés porter le mal et la transfiguration du barbare en martyr1. C’est précisément ce à quoi s’emploient les islamistes radicaux ceux qui veulent purifier la terre des impurs : les libres penseurs, les mécréants, les chrétiens et surtout, évidemment, les juifs, en somme porter à son terme le jihad, tel que certains passages du Coran l’énonce. Il n’y aurait pas d’islamisme sans islam radicalisé. Le nier ou le masquer, en vertu de bons sentiments, c’est s’aveugler soi-même.
Entre New York 2001 et Paris 2015, il y eut nombre d’exactions et de meurtres qui n’avaient pas soulevé la même émotion collective mais traduisaient cette internalisation de la barbarie. Pour n’en retenir que quelques-uns, il y eut la séquestration et la torture du jeune Ilan Halimi laissé pour mort, en janvier 2006, par un groupe d’une vingtaine de personnes se faisant appeler « le gang des barbares », dirigé par Youssouf Fofana. Il y eut aussi les assassinats à bout portant perpétrés, en mars 2012, par Mohammad Merah dans l’école Ozar Hatorah de Toulouse. Il s’agissait bien entendu de tuer délibérément des enfants juifs et les adultes qui les protégeaient. Le meurtre d’écoliers juifs va se retrouver dans d’autres épisodes tragiques en France et à l’étranger qu’ils aient été menés jusqu’à leur terme ou non. Il y eut encore la tuerie du Musée juif de Bruxelles, en mai 2014, par Medhi Nemmouch, jeune franco-algérien qui avait probablement rejoint pendant une période le groupe Etat islamique en Irak. Il y a au moins un élément commun dans ces différents cas : les motifs religieux qui recyclent les mythes les plus anciens et les plus tenaces de l’antisémitisme. Ceux-ci consistent à considérer le juif comme représentant l’argent (le juif est nécessairement riche, voire banquier), la volonté de domination (dans la politique, les médias, l’économie), la persécution (à l’égard du peuple palestinien), le mensonge (la Shoah considérée comme une invention maligne des juifs pour justifier l’existence et les crimes sionistes). Cette configuration de dimensions à la fois traditionnelles et nouvelles de l’antisémitisme, fait partie de l’endoctrinement néo-barbare, à quoi s’ajoutent des moyens sophistiqués et l’action sur les médias et les réseaux sociaux.
Mais si les juifs sont des cibles par nature et par excellence, ils ne sont pas les seuls à être visés. Tout ce qui peut recevoir la caractérisation d’islamophobe doit être également une cible. Ainsi, les représentants des institutions républicaines comme l’armée ou la police, considérés comme des instruments d’institutions islamophobes. Si ces représentants sont musulmans, cela est interprété comme une trahison de l’islam et justifie qu’ils soient exécutés. Il y a enfin la liberté d’expression, ce principe constitutif des régimes démocratiques qui inclut la liberté de blasphémer, laquelle est radicalement inacceptable eu égard au respect absolu dû à la religion et en particulier au prophète que les islamistes requièrent. Les massacres qui ont eu lieu du 7 au 9 janvier 2015 à Paris comportaient ces trois aspects : détruire par le meurtre des caricaturistes de Charlie Hebdo, les tenants de la liberté d’expression au nom du respect absolu dû à la religion, l’assassinat de la policière représentante d’un l’ordre républicain islamophobe, et le massacre des juifs de l’épicerie « Hypercacher » qui, quant à eux, n’ont à faire quoi que ce soit ni à être le représentant de rien d’autre que d’eux-mêmes pour mériter la mort.
Dans tous ces cas, les néo-barbares qu’ils fassent partie d’un réseau organisé ou non, qu’ils soient jihadistes ou non, qu’ils soient passés dans les camps d’entraînement d’Al Quaida, de l’Etat islamique ou non, qu’ils soient autorisés par une organisation ou des autorités religieuses, ou non, s’estiment en droit de tuer. Ces exactions visent à combattre et à terme détruire de l’intérieur, par la violence mais surtout par la peur et la soumission, les institutions démocratique et républicaines.
Étrange hasard que le dernier livre de Michel Houellebecq, Soumission, ait été distribué en librairie le 7 janvier 2015. Mais l’avenir n’est pas tracé d’avance, il sera ce que nous en ferons, et ce que nous en ferons dépendra de la détermination de la résistance aux néo-barbares, non seulement ici, mais aussi là où ils soumettent des populations entières au bout de leurs couteaux, de leurs kalachnikov ou de leurs lance-roquettes.
1. Cf. l’admirable livre d’Abdelwahab Meddeb, Sortir de la malédiction : l’islam entre civilisation et barbarie, Paris, Seuil, 2008.
Yves Charles Zarka est philosophe, professeur à Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité. Il est directeur de la revue Cités (PUF) qui consacre son numéro 61 (à paraître en mars) au thème « Les nouveaux Barbares : terrorisme religieux, politique et culturel » (à paraître en mars). Derniers ouvrages publiés, L’inappropriabilité de la Terre (Armand Colin, 2013), Refonder le cosmopolitisme (PUF, 2014), Philosophie et politique à l’âge classique (Hermann, 2015).
