— Par Robert Lodimus —
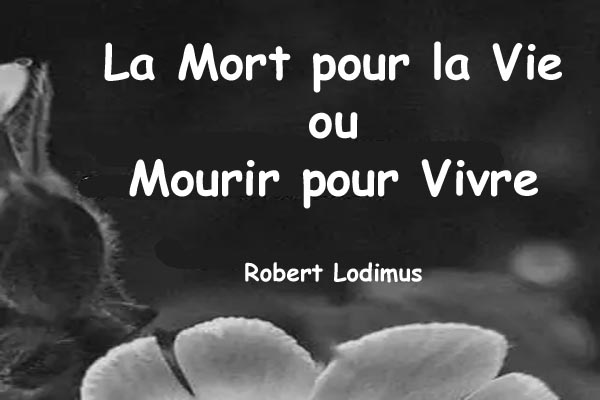 Chapitre VIII
Chapitre VIII
L’EXODE ET L’ENFANCE
La cabane de tante Gisèle ressemblait jadis à une fourmilière. Quatre adultes et sept gosses en bas âge s’empilaient dans la paillote composée de deux chambrettes surplombées de fragiles panneaux de terre. Il s’agissait de son mari Capois, de leurs deux fils, Emilio et Frédéric; de sa sœur Léonie, la cadette et ses trois gosses, Lysius, Dorimond, Marius; Germaine, et de la benjamine avec ses enfants, Selondieu, Laïana et Lucia. Puis, au fil du temps, la pluie des fatalités, pareille à des nuées d’oiseaux migrateurs venus des pays nordiques, avait vidé la baraque de tous ses pensionnaires. Certains, comme Capois, Emilio, Fréderic, Léonie, Germaine, Laïana étaient décédés. D’autres, tels que Marius et Lucia émigrèrent à Cuba; et on n’avait plus entendu parler d’eux. Quant à Lysius et Dorimond, ils avaient jeté l’ancre dans la partie Est de l’île où ils avaient trouvé du travail pour couper la canne à sucre dans l’un des 500 bateys de la République dominicaine.
Le visage d’Acélia avait considérablement blêmi sous la fanchon décolorée. Selondieu, assis sur le tronc d’un arbre mort, presque à l’entrée de la vielle chaumière sans porte qui servait de cuisinette, en face de tante Gisèle entièrement écrasée dans un fauteuil rustique, posa un regard doux et inquiet sur sa femme accroupie à quelques pas de là, et qui roulait le mil dans un tamis de paille de latanier, arrêtant de temps en temps le mouvement de rotation de ses bras pour enlever les petits cailloux gris qui s’étaient mêlés aux grains légèrement jaunis avec son pouce et son index de la main droite. Il poussa un long soupir. Retroussa ses lèvres épaisses à demi cachées sous les poils négligés de sa moustache de bûcheron. C’était vraiment dur pour les individus comme lui, misérables, sans fortune, sans instruction, d’avoir connu la malchance de voir le jour dans ce « pays de non-vie ». Un grand poète et romancier haïtien l’aura compris plus tard, lui aussi : « C’est déjà un grand malheur de naître dans un pays nègre… Encore un plus grand malheur d’être né nègre et haïtien.» Comme qui dirait, l’origine raciale – si elle existait vraiment – pouvait être une source de bénédiction ou de châtiment… Mais seulement, la fatalité, elle siégeait partout, dans les palais comme dans les taudis, au Nord comme au Sud, partout où les êtres humains avaient pris possession de la nature de manière égoïste pour en changer les règles de fonctionnement originel au détriment des « faibles ». Dans ces « zones de non-vie », les désœuvrés mangeaient le pain qu’ils avaient peiné à trouver en pensant déjà à celui qui leur manquait pour demain. Quand on se nourrissait comme on le pouvait – et non comme on le voulait – manger ne fut jamais un plaisir. Seulement le faire pour demeurer accroché à l’arbre de l’existence. Ceux-là qui appartenaient comme Gisèle, Selondieu, Acélia …à la grande catégorie sociale des indigents de la planète n’avaient jamais connu le repos du sommeil paisible et du réveil rassuré, sans la moindre lueur d’inquiétude et le plus petit rayon de panique. D’ailleurs, ils ne dormaient presque pas. Les rares fois qu’ils parvenaient à joindre leurs paupières dilatées par la fatigue extrême, c’était pour aller plonger et se noyer dans un étang de cauchemars agités et bouleversants. Léonie répétait souvent que les chiens des « vieilles chaumières » et ceux des « grandes maisons » n’aboyèrent pas et ne mordirent pas pour les mêmes raisons. Les premiers, toujours acariâtres, « ragèrent » sous les coups répétés de la maltraitance. La famine les avait finalement ensauvagés. D’où le dicton créole : « Chen grangou pa jwe » (Chien affamé ne plaisante pas). Tandis que les derniers le firent pour signaler un danger, sécuriser et protéger leur territoire menacé par la présence d’un intrus. Le monde était toujours divisé entre ceux qui vivaient et ceux qui existaient. Triste, cruelle, déplaisante, regrettable réalité! Selondieu plia ses bras, les ramena sur son ventre et sa poitrine et enveloppa sa nuque avec ses mains larges et rudes de planteur et de laboureur. Quoiqu’il eût essayé de contrôler sa nervosité, on avait senti quand même qu’il se passait quelque chose à l’intérieur. Son sang bouillonna de révolte. Tout compte fait, sa décision était prise. Ils confieront la petite Francesca à tante Gisèle et ils iront traverser la frontière du côté d’Ouanaminthe, comme Dorimond et Lysius. Une fois qu’ils seraient parvenus à Samana, Selondieu était convaincu de trouver du travail sur l’une des plantations de canne qui alimentaient les usines sucrières des multinationales états-uniennes. «Je couperai la canne avec l’énergie d’un galérien», se disait-il.
Le malheureux se perdit complètement dans une spirale d’illusions à la Perrette, « la laitière et le pot au lait » :
« – En un an, pensait encore Selondieu, j’arriverai à économiser assez d’argent pour redonner un toit à « Cécé » et à la fillette. Je ferai repousser des ignames, des légumes, des haricots, et du mil. Je planterai des arbres fruitiers : des manguiers, des cocotiers, des avocatiers, des orangers, afin de garder mes terres toujours fertiles. Je ferai ma part pour protéger la nature, l’héritage du Grand Architecte de l’univers… Francesca ira vendre les denrées agricoles au marché, comme au bon vieux temps. Mes bras besogneux, combien laborieux, ramèneront la fraîcheur, la tranquillité et le sourire au visage de ma bien-aimée. Je redeviendrai un homme, un être vivant, une créature du Bon Dieu. Je reconquerrai mon honneur et ma dignité de paysan. J’aurai des arbres pour héberger les loas de mes ancêtres. Je laisserai à la postérité une habitation qui portera le nom de ma famille. Le paysan sans terre est un vagabond. Je rebâtirai ce que Ménélas a volé et détruit. La nature nous a forgés avec du fer et du ciment. C’est la robustesse de nos bras qui nourrit les aristocrates; c’est notre travail qui leur procure la vie princière et seigneuriale qu’ils mènent dans leurs châteaux, dans leurs villas, dans leurs palais… Alors, je recommencerai à piocher la terre, labourer le sol, pour offrir une vie meilleure, encore meilleure, toujours meilleure aux miens. »
Selondieu pensa un moment :
«– Peut-être que la vie finira un jour par pétiller pour les pauvres comme le champagne dans les verres des bourgeois…! Qui sait? »
Mais ce que Selondieu ignorait : la vie n’était qu’une étonnante et douloureuse plateforme de bêtise humaine et de stupidité incroyable rangée sous la rubrique d’une « dualité incontournable ». À chaque chose, son contraire. Qu’aurait été la richesse sans la pauvreté? Que serait devenu le maître sans le valet ? Dieu sans Satan? Le blanc sans le noir? La lumière sans l’obscurité? La beauté sans la laideur? Le bon sans le méchant? Le ciel, symbole de l’éternité, sans la terre, berceau de l’éphémère? Aussi paradoxal que cela eût pu paraître, ce fut de là que l’existence humaine eût tiré son essence.
Le pain, lorsqu’il se fit rare, devint entre les mains des pauvres, une arme de motivation redoutable pour décapiter l’injustice sociale. « Nous avons faim; donnez-nous du pain! » Des cris stridents qui ébranlèrent dans le temps des monarchies célèbres et puissantes! La Bastille ne résista point. Louis XVI passa sous la guillotine. « Nous avons faim; donnez-nous du pain! » Des foyers de révolution embrasèrent des villes entières afin de dératiser les caves ténébreuses où nichèrent la corruption et l’oppression avec leur cortège d’inégalités criantes.
Dès la fin du 14ème siècle, les terres de Quisqueya commencèrent à enrichir presque tout le continent européen. Des va-nu-pieds, des clochards et des vagabonds, conduits par l’aventurier Christophe Colomb y firent fortune après avoir massacré, assassiné, décimé les autochtones avec la complicité et la bénédiction de l’église catholique romaine. Nuremberg jugea les nazis pour Auschwitz. Mais le génocide de l’Europe en Amérique et en Afrique est occulté de l’histoire universelle. Oublié. Impuni. Classé… Quatre siècles plus tard, à la lumière des idées jacobines, les indigènes chassèrent les usurpateurs et devinrent les nouveaux maîtres des plantations. Ironie du sort, depuis ce temps-là, avec les années, les terres produisirent moins. De moins en moins. Puis, rien. Alors, le sauve qui peut s’installa dans la frénésie de l’exode qui n’aurait été, en fait, que le prolongement de l’esclavage dans une structure moderne, mondialisée. Mais tout cela importait peu pour Selondieu Lachance et Acélia Lamisère. N’aurait-il pas mieux valu pour un individu d’être mort en travaillant que d’avoir vécu sans avoir travaillé un seul jour de toute son existence? Non pas que le spécimen ne l’eût point voulu, mais parce que plutôt les emplois étaient devenus aussi difficiles à trouver que le tombeau de Cléopâtre, aussi rares à localiser que les diamants du Congo ou les émeraudes de l’Inde.
Les derniers rayons du soleil se perdaient derrière les arbres déjà somnolents. Les poules s’apprêtaient déjà à se hisser sur leurs branches enfeuillées, afin de se mettre à l’abri des prédateurs. Alors qu’il coupa le bois pour que sa concubine préparât le souper de petit mil et de « pois congo », Selondieu dévoila son secret à tante Gisèle.
– Tante Gigi, commença-t-il, avez-vous des nouvelles de Dodo?
– La seule fois que j’ai vu votre cousin Dorimond, c’était le jour des funérailles de Léonie.
Tante Gisèle marqua une longue pause, comme si son cœur allait arrêter de battre, comme si l’air lui manquait dans les poumons. Elle avait beaucoup vieilli et elle commençait à se déplacer sous des pas visiblement pesants, et parfois même au ralenti comme les images d’un personnage de cinéma, dont chaque mouvement était décomposé à l’écran, pour permettre aux spectateurs de suivre toutes les étapes de l’action. Pourtant, elle n’était pas tellement âgée que cela. Ce furent les mauvais moments qui l’avaient défigurée à ce point où elle s’était rendue presque méconnaissable aux yeux de son neveu. Les rides entaillaient son visage sexagénaire comme les ciseaux de Michel-Ange saignèrent et travaillèrent le bois et la pierre pour laisser en héritage des merveilles sculpturales à la postérité. Seulement, il faut le dire avec franchise, à soixante-sept ans, Gisèle n’avait absolument rien en elle pour défier la beauté des esprits. Les longues nuits sans sommeil, ajoutées aux rudes journées d’angoisse et d’inquiétude à attendre le retour de Capois et de ses deux garçons disparus depuis dix-huit ans avaient malmené son corps et miné sa santé. Ils étaient partis rejoindre les partisans dans la montagne pour renforcer le mouvement de résistance de Benoît Batraville qui combattait les envahisseurs Yankees du côté de Mirebalais… C’était un 4 décembre de l’année 1919. Après l’assassinat de Charlemagne Péralte, le 31 octobre 1919, son lieutenant, un instituteur qui s’était converti en guérillero, venait de reprendre depuis le 2 décembre le flambeau de la guérilla contre les marines américains. Six mois après, soit le 20 mai 1920, le nouveau chef de la rébellion fut trahi à son tour et mis à mort par les occupants. Le corps de Benoît Batraville, ainsi que ceux de plusieurs de ses camarades reposèrent au cimetière de Mirebalais. Tante Gisèle arriva à se consoler à l’idée que son homme vaillant et ses deux jeunes fils, braves et patriotes, étaient peut-être en train de dormir éternellement aux côtés du grand héros national. Mais lorsqu’elle apprenait que des rebelles étaient libérés de prison en 1934, alors là, elle s’était remise à espérer. « Peut-être, se disait-elle, qu’ils n’avaient pas été exécutés, mais seulement battus, torturés et incarcérés. » Emilio et Frédéric étaient encore des adolescents lorsqu’ils prirent la ferme décision de suivre leur père dans la montagne. Capois, à ce moment-là, répétait à sa femme que c’était « un devoir solennel et impérieux de répondre à l’appel de la patrie menacée. » Pour Benoît Batraville, Il fallait que les partisans recommençassent la lutte. L’arrestation par traîtrise et l’exécution monstrueuse de Péralte ne devaient pas déstabiliser le mouvement jusqu’à éteindre toutes les chandelles de la résistance. Depuis le départ de Capois et des deux gamins, Gisèle vécut seule sur le petit lopin avec ses sœurs qu’elle avait recueillies à la mort tragique de leur père Horace et de leur mère Delfina. Ces derniers se noyèrent en tentant de traverser la mer en furie un soir de grands vents et d’orages violents, alors qu’ils revenaient du marché où ils étaient allés vendre quelques poissons pour se procurer de l’huile, du savon, du sel, du sucre, du kérosène… Germaine succomba à des complications éclamptiques quelques heures après avoir donné naissance au petit Selondieu. Léonie mourut de la tuberculose dans une vieille bâtisse désaffectée de l’hôpital La Providence qui recevait les indigents atteints de maladies contagieuses. Pendant des années, elle avait servi tour à tour comme cuisinière-ménagère chez des familles aisées qui l’avaient fait trimer comme une bête de somme du matin au soir, dans des conditions humiliantes, déplorables et inacceptables. Elle cuisinait, lessivait, reprisait, repassait, astiquait, cirait… Elle se levait tôt… Se couchait tard… Et finalement, Léonie avait craqué sous la fatigue et la sous-alimentation. Parfois, deux heures de sommeil sur une tranche de carton jaune recouverte de quelques morceaux de vêtements en lambeaux, et pour toute ration de nourriture, un peu de maïs ou de petit mil mélangés à une sauce brune de hareng saur, de poulamons ou de petits poissons des chenaux. La providence ne lui avait offert aucun autre moyen d’économiser les quelques piastres qui servaient à nourrir et à vêtir son fils Dorimond. Elle le faisait tant bien que mal, comme elle le pouvait. Il fallait imaginer le souci et l’inquiétude de cette pauvre femme abandonnée par son compagnon dès le troisième mois de sa grossesse et qui était obligée de labourer, de sarcler, d’arroser, d’ensemencer la terre avec sa sœur aînée pour faire pousser et récolter quelques épis de maïs, des légumes, des haricots, des pommes de terre, des patates douces… qui les sauvèrent toutes les deux de la famine. Après la mort de Léonie, malgré son âge, tante Gisèle continua seule la lourde besogne. Elle ne pouvait pas se libérer de la corvée sans fragiliser davantage son état de pauvreté et sa situation de précarité.
Le vent se leva brusquement. Et quelques instants après, de fortes pluies s’abattirent sur la petite cabane perchée sur les flancs de la colline… Tout en mangeant le bol de petit mil que lui avait servi Acélia, tante Gisèle continua de parler de Dorimond à Selondieu.
– Les affaires semblaient aller mal pour lui. Imaginez donc que pour organiser la veillée et acheter le cercueil de la défunte chez boss Fénelon, la famille a été obligée de vendre au notaire Siméon les terres situées à l’entrée de Vilot pour une pitance.
– Ce n’est pas vrai, tante Gisèle! Revenir comme ça, « les mains blanches », après toutes ces années qu’il avait passé « nan Panyòl [10] ».
– Pourtant, c’est la vérité mon garçon… Dorimond était revenu au village après onze ans, sans un peso. Il raconta que les militaires dominicains qui campaient à la frontière des deux pays avaient confisqué ses habits neufs et son portefeuille qui contenait toutes les économies de dix années de travaux forcés et de tribulations de toutes sortes dans les plantations, soit douze gourdes et dix-huit centimes. Ils avaient même menacé de l’envoyer en prison pour séjour illégal sur un territoire étranger. Le caporal lui botta cinq fois les fesses, le sommant de disparaître avant qu’il ne changeât d’idées.
– Ces militaires sont des voleurs. Ce n’est pas la première fois que des compatriotes font face à des problèmes d’escroquerie à la frontière…
– Dorimond a conduit sa mère au cimetière avec les mêmes vêtements qui collaient depuis trois jours sur un corps long et émacié. Il est reparti le soir même de la mise en terre du cadavre sans attendre la levée de la neuvaine. Ah, ma défunte sœur Léonie n’a pas dû être contente de son garçon. Une nuit, je l’ai vue en songe, ma sœur. Elle était triste; elle pleurait abondamment. Elle répétait sans cesse : « Malheur! Malheur! Malheur! Je dis, foutre…! » Je l’ai vue debout au milieu de la tempête… Les vents déracinaient les arbres et emportaient les cabanes. Léonie portait la robe bleue avec laquelle elle était enterrée. Elle chantait une chanson triste et bizarre dont je n’ai jamais oublié les paroles :
« Je vois trente cinq mille colombes
Qui gigotent dans les flaques de sang
Au pays du monstre bâtard
Celui qui vient de chaque côté des barbelées
J’entends les pas affolés
D’un troupeau de bipèdes
Qui fuit dans la nouvelle lune
Pareille à la nuit tourmentée
Des Saints innocents
Et puis je vois
Je vois des corps
Allongés sans vie
Égorgés dans les plaines de Samana
Je vois et revois
La maudite plante
Tresseuse de nos malheurs
Des corps sans âme
Flotter dans les eaux glacées
Couleur du soleil couchant
Je vois des restes d’humains déchiquetés
Accrochés sur les pics des falaises
Qui surplombent la grande rivière
Dont le nom fait frémir les voyageurs
J’entends, Ô j’entends
Tous ces cris de torture
Tous ces pleurs de détresse
Qui traversent les vallées lointaines
Et qui se perdent
Dans un océan de déprime
De mépris et d’abandon
La souffrance bouleverse
Les entrailles de ma terre
Impuissante et débile
Devant les bourreaux
De l’immonde tragédie
Quelle humiliation
Wayo, wayo
Quelle douleur
Wayo, wayo
Pour les enfants
De la liberté
Quel chagrin
Wayo, wayo
Quelle misère
Wayo, wayo
Pour les enfants
De Makandal
Et de Boukman
Quel déshonneur
Wayo, wayo
Quelle honte
Wayo, wayo
Pour les loas de Guinée
Quelle tribulation
Wayo, wayo
Pour les pères de la patrie »
Robert Lodimus
(Prochain extrait : Suite du chapitre VIII)
– C’est un mauvais songe tante Gisèle; il annonce des temps encore plus difficiles…
– J’ai toujours pensé, depuis cette nuit-là, que notre pays allait connaître une grande catastrophe. Beaucoup de gens qui sont partis là-bas, semble-t-il, n’auront pas la chance de revenir. Là où ils se sont installés, ils vivent dans l’illusion, ils éprouvent de la nostalgie et ils ont des cauchemars qui les font souffrir. Dans certains cas, ils savent que le retour est devenu plus compliqué que le départ. On pourrait même dire impossible. Après des années de travail, il y en a, et il s’agit de la majorité d’entre eux, qui sont devenus plus pauvres là-bas qu’ici. Ces hommes et ces femmes ne possèdent absolument rien, sinon qu’une vieille machette pour abattre la canne. L’envie de « retour au pays natal » est persistante. Mais l’acte de retour, en lui-même, paraît irréalisable. Malgré les déceptions.
– Cousin Dorimond vous a-t-il parlé de Lysius?
– Seulement qu’il avait perdu une jambe et qu’il ne pouvait plus marcher comme avant. La plaie qu’il s’était infligée avec sa machette ne voulait pas se refermer et elle commençait à gangréner. L’infirmier dominicain, une espèce de « boucher du bord de mer » la lui a arrachée sans anesthésie. Lysius a vomi son fiel, tellement la douleur le cramponnait au cœur et à l’estomac.
– Lysius, mais qu’est-ce qu’il est devenu aujourd’hui? J’imagine qu’il ne soit plus en mesure de travailler avec son handicap terrible…
– Il faut bien qu’il vive! Les « congos » lui ont forgé des béquilles rudimentaires avec du bois de chêne pendant sa convalescence. C’est grâce à cela qu’il arrive à marcher, à se tenir debout pour couper la canne. Autrement, comment aurait-il fait pour nourrir les six gosses de Lolita. Sa jeune femme Lolita, dit-on, une dominicaine à la peau foncée, d’une générosité infinie et d’une bonté exemplaire; elle a été lâchement violée et battue à mort par un saoulard de son pays. Ce sale gueux, je répète après Dorimond, n’arrêtait pas de la harceler. Il lui reprochait d’avoir sali la race en se souillant avec un vaurien haïtien d’origine campagnarde. Des propos racistes qui ont finalement poussé le voyou à commettre son crime haineux. Le viol s’est déroulé avec rage et brutalité sous les yeux des enfants terrifiés : « Salope, répétait l’assassin, je vais t’apprendre comment on traite les putes de ton espèce … » Et comme si la violer, la déshonorer ne suffisait pas, la créature monstrueuse a découpé la pauvre femme en morceaux à coups de machette. Les six gosses sont restés terrés sous le vieux lit jusqu’au départ du criminel. L’aîné a alerté les voisins qui se sont précipités sur les lieux du drame. C’est après la mort tragique de Lolita que Lysius a eu l’accident qui lui a coûté sa jambe.
– Et le meurtrier, il est encore en prison, je suppose…?
– En prison? Dorimond nous a expliqué que l’individu diabolique a été appréhendé par les militaires dominicains et relâché quelques jours après sans subir son procès. Il continue de boire et de cuver son « tafia » librement. Lysius voulait coûte que coûte venger sa femme, mais à cause des enfants, il a renoncé à son idée. C’est vrai qu’il irait en prison; et il n’y aurait personne pour prendre soin des gosses…
– Cela doit être dur pour lui de vivre avec des souvenirs tellement dramatiques, tellement douloureux…!
– En tout cas, Lysius a bien raison de renoncer à la vengeance. S’il était allé en prison, ses enfants auraient été abandonnés à eux-mêmes. Dorimond a déjà sa croix qu’il porte sur les épaules…
– Ah, tante Gisèle! la vie est une machine qui broie les pauvres… La misère nous force à avaler des boissons amères. Les aînés, reconnus pour leur grande sagesse, répètent souvent : « Dieu baille, mais sépare mal. » Les biens, les richesses de la terre s’en vont du même bord. Ce sont les miettes que les misérables paysans ramassent et distribuent entre eux, les miettes qui sont tombées de la bouche des bourgeois. Souvent, étendu sur le paillasson, je me suis demandé pourquoi eux, ils ont tout, et nous absolument rien? Dès l’aube du jour, on commence à besogner comme un bœuf pour arriver à gagner notre croûte, et encore difficilement… Souvent, trop souvent même, à cause des sécheresses qui ont ravagé les récoltes, on est allés se coucher avec un grain de sel enfoncé sous la langue pour calmer notre estomac affamé. Le pays ne traite pas ses enfants de façon équitable. L’État nous abandonne dans les bas-fonds de la pauvreté sans manifester pour nous le moindre sentiment de pitié et de remords. Nous, les gens du peuple, sommes devenus des feuilles mortes de l’automne qui dérivent dans les vallées au gré du vent. L’État ignore même notre existence. Pas d’hôpitaux dans les mornes pour soigner nos compatriotes malades! Pas d’écoles pour permettre à nos enfants de goûter le pain de l’instruction! Pas de routes pour empêcher que nos denrées pourrissent avant même qu’elles arrivent dans les marchés publics des bourgs et des villes! C’est moi Selondieu qui le dis – si je meurs avant, les fourmis viendront m’apporter la nouvelle – la justice finira par rendre aux paysans sa dignité… Ce n’est pas normal qu’il y ait trois pays dans un seul pays, trois sociétés dans une seule société…! Ce jour viendra, tante Gisèle… Ce jour viendra…!
Selondieu Lachance n’était « ni héros ni martyr. Il était citoyen de la blessure. » Et quelle blessure? Une plaie intense comme la voûte du firmament, une plaie puante comme celle de Philoctète sur l’île de Ténédos et qui refusait de se cicatriser. Combien d’Iphigénie devrait-on laisser Agamemnon sacrifier sur l’autel d’Artémis avant de libérer Aulis de la folie des vents meurtriers…?
Selondieu avait parlé avec la force de son âme. La bataille des pauvres, la sienne, comme celle de Mahmoud Darwich [11], en parlant de la Palestine, est « perdue au présent », il ne le savait peut-être pas. Elle est « d’avenir ». Mais là-bas, le temps importait peu. Selondieu resta ferme, convaincu et confiant. La victoire des « indigents » ne pourra pas toujours être « ce printemps de Mahmoud Darwich reporté de saison en saison», comme l’a écrit l’écrivain marocain Tahar Ben Jelloun [12], dans « Une terre orpheline », un vibrant hommage au poète palestinien mort en exil aux États-Unis.
Selondieu annonça son départ prochain à tante Gisèle. Il lui expliqua pour quelles raisons Acélia et lui voulaient le faire. Ce ne fut pas de gaité de cœur, sans douleur, sans recevoir des coups de poignard dans leur poitrine qu’ils avaient décidé de partir, d’abandonner comme cela ce pays qui les avait vus naître, jouer, courir, grandir pour aller grossir le nombre de « viejos » qui bourriquaient en silence dans les fermes agricoles de l’autre côté de la frontière et qui étaient devenus, sans même s’en rendre compte eux-mêmes, les esclaves des temps modernes.
– Vous êtes sûrs, réellement sûrs que c’est ce qu’il faut faire…?
– Il faut assurer un avenir à la petite… Elle a déjà sept ans. C’est pour elle que nous le faisons… Francesca mérite une vie meilleure que la nôtre. Nous sommes prêts, sa mère et moi, à nous sacrifier pour lui épargner les marques de souffrances que la misère a entaillées sur le corps de chacun de nous depuis la naissance… Ménélas a spolié l’unique parcelle que j’ai héritée de mon défunt père et qui servait à nourrir ma petite famille. Il menace même de me tuer, si toutefois je me rapporte aux autorités de la ville. Et encore, il le sait bien, il n’y a pas de justice pour les paysans illettrés, pour les gens pauvres qui ne parlent pas la « langue » des commissaires du gouvernement, des juges de paix, des avocats, des bourgeois…
– Vous pourriez demeurer ici avec moi, reconstruire votre case, travailler la terre, récolter des denrées…, enfin tout ce que vous voulez… Je suis déjà vieille et fatiguée. Après ma mort, il n’y aura personne pour s’occuper de l’habitation…
– C’est une solution risquée… Le grand don, celui que l’on appelait Thermitus, qui vous a fait travailler durant vingt-neuf ans, oncle Capois et vous, pour vous céder cet emplacement, ne vous a jamais délivré les titres de propriété.
– C’était une bonne personne. Quand Alcindor, le mari de Germaine nous a quittés, M. Thermitus m’a aidée à acheter le cercueil chez « boss » Gracien. Il est décédé lui aussi sans avoir eu le temps, malheureusement, de m’emmener voir le notaire Davilmar pour finaliser et légaliser la transaction verbale.
– Ses héritiers peuvent décider un jour de prendre des « dispositions légales » pour chasser les vôtres. Il ne faut pas faire confiance aux « gens des villes ».
– Édouard, le fils aîné passe souvent me voir. Et même parfois, il m’apporte quelques provisions : du sucre, du sel, de l’huile, des allumettes, du pain, du kola, et un peu d’argent… En ville, on trouve des mauvaises personnes, mais on rencontre aussi des bonnes créatures du Bon Dieu.
Tante Gisèle n’insista pas davantage. Peut-être que son neveu n’avait pas tout à fait tort. Les êtres humains sont pareils aux éléments de la nature. Ils peuvent se déchaîner brusquement et causer des surprises désagréables. Elle promit de s’occuper de la petite Francesca, de la protéger comme la prunelle de ses yeux. Et en l’absence de Selondieu et d’Amélia, c’était bien ce qu’elle avait fait jusqu’au moment du trépas.
Tout compte fait, le couple aurait touché la terre voisine le matin du 30 septembre 1937. Il serait arrivé dans la zone des bateys, comme Joseph et Marie à Bethléem. Acélia était assise de travers sur le dos du petit âne et Selondieu tirait doucement sur les brides de l’animal. Ils allèrent à la rencontre de leur destin tragique sans le moindre soupçon. Pourtant la paysannerie dominicaine était déjà en mode d’ébullition sociale. Le bûcher était dressé. Les sacrificateurs choisis. Les agneaux à égorger, désignés. Le couvercle de la chaudière de haine et de racisme chauffée à blanc sauta le 2 octobre 1937. Le président Trujillo déclencha « l’opération perejil » qui consistait à éliminer tous les Haïtiens qui se trouvaient sur le sol de la République dominicaine, y compris les citoyens dominicains à peau foncée qui avaient été étiquetés et pris comme tels, c’est-à-dire pour des Haïtiens. Les historiens ont rapporté que le 2 octobre 1937, le président dominicain Raphaël Léonidas Trujillo y Molina était l’invité d’honneur de Doña Isabel Mayer, une fonctionnaire de haut rang de son gouvernement. La chercheuse Jose Abigail Cruz Infante a dressé son portrait dans son ouvrage « Hombres y Mujeres de Trujillo ». Ce fut à cette occasion que le dictateur sanguinaire lança son mot d’ordre aux assassins civils et militaires qui allaient exécuter cette tâche funeste. Trujillo accusa les immigrants haïtiens de « voler de la nourriture et du bétail » aux familles dominicaines. Il demanda à son peuple de régler « cette affaire » en se faisant justice lui-même. Au moment où le président dominicain prenait la parole, des centaines d’Haïtiens étaient déjà assassinés par balles ou à coups de machette du côté de Banica. Le Dr. Jean Price-Mars, l’auteur du livre « Ainsi parla l’Oncle » a relaté ces faits dans « La République d’Haïti et la République Dominicaine, Tome 2 :
« Le carnage des Haïtiens, à l’arme blanche, commença dans la ville même. Femmes, vieillards, enfants, hommes valides, tout y passa. Ce fut dans cette nuit tragique un sauve-qui-peut formidable des résidents haïtiens de Dajabon et des environs, blessés ou non, à travers la rivière pour atteindre Ouanaminthe où l’alarme fut donnée. Du 2 au 4 octobre, pendant trente-six heures, la symphonie rouge en nappes lourdes répandit la tristesse des sanglots, des lamentations, des hoquets d’agonie vomis par la multitude haïtienne. »
Et il eût fallu que tout cela fût arrivé deux jours après l’émigration de Selondieu et d’Acélia. Selon les statistiques avancées sur la quantité des victimes, au moins trente cinq mille Haïtiens auraient laissé leurs houseaux dans les « vêpres dominicaines ». Tante Gisèle avait dit à son neveu Selondieu : « Beaucoup de gens émigrent…! Mais bien peu reviennent…! » Ceci demeurait l’expression d’une prémonition brutale, projetée par les relents d’une « vérité choquante », que l’on eût voulue tout à fait « fausse »…! Seulement, comme les animaux capables de fleurer le danger, l’être humain pouvait aussi creuser le futur, pour explorer les surprises, bonnes ou désagréables, qui attendaient l’Humanité engoncée dans son hubris. Ce que Tante Gisèle ignorait, selon toutes les apparences, c’est le fait que chaque individu, indistinctement, a été désigné pour l’ultime arrêt à la gare fatidique. Le poète Jacques Prévert le savait. Comme les démiurges de son rang, il avait prédit l’ « indétournable » :
« Mangez sur l’herbe
Dépêchez-vous
Un jour ou l’autre
L’herbe mangera sur vous »
Selondieu, Acélia, Dorimond, Lysius et beaucoup de compatriotes anonymes, malchanceux, étaient déjà confinés comme de vulgaires assassins dans les oubliettes de l’histoire universelle. S’ils n’existaient pas de leurs vivants – bien entendu, à part pour les membres de leurs familles – donc encore moins – pour ne pas dire pas du tout – après leur mort. Le peuple haïtien n’avait jamais pu digérer l’os agouant de cet affront inqualifiable. Partout, de Jérémie à Ouanaminthe, de Môle-St-Nicolas à Jacmel, de Cap-Haitien à Gonaïves, il y eut des appels répétés de plusieurs concitoyens à la vengeance et des tentatives de recrutement de volontaires pour lancer une attaque armée en règle contre l’État trujilliste vampirique, quitte à s’être fait exterminer eux aussi. Il fallait admette, et ce n’est pas un prétexte, que l’armée indigène n’existait déjà plus. Elle avait été démantelée par les forces de l’occupation américaine. Les derniers chefs avaient été froidement et monstrueusement assassinés. Les unités militaires dominicaines étaient de loin supérieures aux forces armées d’Haïti fondées par les États-Unis d’Amérique, lors de l’occupation étatsunienne du territoire, dans le dessein inavoué de détruire les régiments indigènes reconnus dans l’histoire de ce pays comme « l’Armée de la révolution de 1804 ». Supérieures en nombre, en armements et en compétences : tout cela avait été décidé, fait et soigneusement mis en place dans l’esprit d’augmenter la vulnérabilité du pays par rapport à la République voisine. Le gouvernement de Vincent capitula, sans même essayer ou faire semblant de ramasser les gants que le dictateur Trujillo lui avait jetés en plein visage avec arrogance, effronterie, mépris et cruauté… Par peur déraisonnable, le président Sténio Vincent et les membres de son cabinet revirent même à la baisse la quantité d’individus péris dans la tuerie que les autorités dominicaines baptisèrent par dérision, par ironie « El Corte » (La coupe). Le gouvernement haïtien avait même accepté l’indemnité de 500 000 dollars américains décidée et offerte par Trujillo pour compenser son crime odieux, soit 15 dollars environ par tête d’Haïtiens tués, afin d’éviter les sanctions politiques et économiques des États regroupés au sein de l’Organisation des Nations unies (ONU), qui exigeaient eux-mêmes une enquête et des sanctions plus sévères. Les événements terrifiants, révoltants et outrageants de ce massacre d’octobre 1937 alimentèrent les circuits des conversations dans les foyers. On en parlait à toutes les secondes, à chaque minute, durant toutes les heures, et pendant longtemps. Puis un jour, cela commençait à se faire de moins en moins. Toujours de moins en moins. Et jamais plus. Adieu poule, chèvre et vache pour Selondieu et Acélia…!
« Il y a de grandes flaques de sang sur le monde
Où s’en va-t-il tout ce sang répandu
Est-ce la terre qui le boit ou qui se saoule
…………………………………………….
Et le sang n’arrête pas de couler…
Où s’en va-t-il tout ce sang répandu
le sang des meurtres… le sang des guerres
le sang de la misère
et le sang des hommes torturés dans les prisons
………………………………………….
La terre qui tourne et qui tourne et qui tourne
avec ses grands ruisseaux de sang »
(Prévert, Paroles)
Deux années après cette tragédie, la guerre embrasait le monde. En six ans de conflit armé, plus de soixante millions de militaires et de civils furent emportés par la folie destructrice des hommes. Les usines de fabrication des armes conventionnelles et chimiques avaient englouti la quasi-totalité des économies des nations impliquées dans les hostilités qui étaient répandues presque à l’échelle planétaire. Cette dure réalité engendra une situation de famine dans les pays périphériques et dépendants. Ils ne pouvaient pas exporter leurs produits vivriers, artisanaux et autres à destination des métropoles belligérantes, des transactions qui leur permettaient de rentrer des devises et de s’approvisionner eux-mêmes en produits essentiels sur le marché international : savon de lessive, huile d’olive, farine de blé pour la « boulange ».
Robert Lodimus
(Prochain extrait : La révélation)
