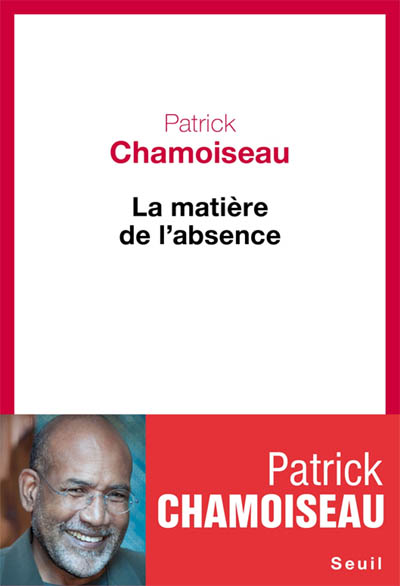 A l’occasion de la parution de dernier livre de Patrick Chamoiseau, « La matière de l’absence », l’Association Tout-monde a organisé une soirée poétique. Gérard Delver, président de l’association, s’est entretenu avec l’écrivain. Quelques extraits…
A l’occasion de la parution de dernier livre de Patrick Chamoiseau, « La matière de l’absence », l’Association Tout-monde a organisé une soirée poétique. Gérard Delver, président de l’association, s’est entretenu avec l’écrivain. Quelques extraits…
Gérard DELVER : Ton dernier ouvrage « La matière de l’absence » me semble ouvrir une nouvelle dimension dans la littérature de nos pays, je veux parler de « l’intime ». Nos littératures étaient souvent identitaires, à visée collective, essayant le plus souvent d’élucider un être-au-monde créole et pour le moins énigmatique, tant et si bien que l’intime que l’on trouvait dans les littératures européennes était très peu présent chez nous. Qu’est-ce qui justifie ta plongée soudaine dans l’intime de la mort d’une mère, de l’émoi d’un deuil ?
Patrick CHAMOISEAU : C’est vrai que le fondement de nos littératures, leur énergie profonde était l’élucidation identitaire. Nous avons de tout temps été confrontés à la nécessité d’explorer cette complexité créole inédite qui nous chahute au plus profond. Ce qui fait que notre manière d’écrire, mais aussi de lire, était souvent marquée du sceau de l’épique, c’est à dire de la construction communautaire : trouver les ressorts de nos peuples composites, les dynamiques de nos nations faites de diversités. Quand nous lisions Fanon, Césaire, Glissant, Schwarz-Bart, c’était avec la soif d’une construction du « nous ». Nous les lisions comme cela. Mais, quand on y regarde bien, l’intime a toujours été là. L’individu dans son extrême équation a toujours été présent chez Césaire, Glissant et tous les autres, seulement nous ne le percevions pas. Il y a des chants d’amour chez Césaire, des tristesses, des angoisses personnelles, des gémissements et des triomphes quasi enfantins. Idem chez Glissant dès « Soleil de la conscience ». Dès lors, notre épique n’était pas uniquement collectif, il n’était pas seulement un épique du « Nous », mais il relevait d’une nouvelle dimension que l’on pourrait appeler à la suite de Glissant « épique de la Relation ». Dans l’épique de la Relation, le « Nous » alimente un « Je », et le «Je » sédimente une construction du « Nous ». Dans les littératures européenne, mon « bobo », mon sida, mon amour-qui-m’a-abandonné, mon-temps-perdu…, le « Je » est solitaire, solaire, introverti. Dans nos pays, le « Je » est expansif et solidaire du « Nous », et ce « Nous » est du coup lui-même très expansif, jusqu’au Tout-monde …
« Dans l’épique de la Relation, le « Nous » alimente un « Je », et le «Je » sédimente une construction du « Nous… »
G.D. : Pourquoi notre « Je » serait-il expansif ?
PC : Parce que ce qui caractérise la mise-en-relation des peuples, des langues, des phénotypes, des imaginaires, ce maelstrom identitaire et composite que nous avons connu, s’est cristallisé sur la base de l’individuation. Le nègre qui survit dans la cale du bateau n’actionne que ses seules ressources ; dans la plantation des petites îles, le nègre marron résiste seul car les villages et les communautés sont impossibles ; les résistances obscures qui se font dans les champs de cannes, auprès du Maître Béké, ne se font pas sur une base communautaire mais sur une base individuelle. Dans nos musiques, par exemple, biguine, salsa, calypso, merengue, la polyrythmie et les improvisations sont reines, la polyrythmie c’est l’ouverture extrême, et l’improvisation c’est l’individu qui exprime sa singularité imprévisible sans base communautaire. Dans les contes créoles, Ti jean horizon ne fait pas peuple, il se fait lui-même, et livre son expérience débrouillarde aux autres qui s’en emparent et mènent comme ils peuvent leurs propres expériences. Et c’est là toute la différence ! Dans les cultures anciennes, ataviques, c’est la communauté qui fournissait à l’individu la trame et la matière de son expression, de sa résistance, de sa plénitude. Mais dans les culture créoles qui sont toujours d’une grande modernité, c’est l’individu qui doit tout seul, par le seul éclat de son intime, de sa créativité, de son élargissement à la planète entière, trouver les solidarités nouvelles qui vont cristalliser un nouveau vivre-ensemble au monde. C’est pourquoi les cultures créoles ne donnent pas des Nations-à-frontières, des murs ou des Patries exclusives des autres, ni même des identités meurtrières ou des langues orgueilleuses, mais elles créent des « lieux multi-trans-culturels», des errances, des contacts, des mises-en-relation, exactement comme dans le jazz où un ensemble de « Je » qui rayonnent comme des autorités donne un « Nous » fluctuant, imprévisible, étendu sur presque la totalité du monde, et « valable pour tous » comme le disait Glissant.
GD : Pour toi, l’intime créole serait la voie d’accès aux nouvelles communautés du Tout-monde ?
PC : Oui, parce que la Relation fait exploser les ciments communautaires et livre l’individu à ses propres fondations, à son auto-organisation. Il doit alors doit s’inventer tout seul ; il doit trouver les bases de son existence au monde et de sa solidarité aux autres sur la seule base de sa créativité. C’est Césaire. C’est Glissant. C’est Fanon. C’est Placoly ou Simone Schwarz-Bart. L’intime ici est vaste, c’est ce qui nous permet de trouver au fond de nous l’élargissement majeur, presque les poussières d’étoiles originelles, les traces du cosmos dans ce que nous sommes, dans la matière de notre vivant. Notre intime ouvre au solidaire pas au communautaire. Le communautaire était fait de certitudes, de sacrés, d’absolus (ma Peau, mon Dieu, mes Ancêtres, ma Langue, mon Histoire, ma Vérité), le solidaire est fait de ce que le Comte Guillaume Pigeard de Gurbert appelle dans son dernier livre « le spectre inaltérable des possibles », une expérience menée à plénitude, sans achèvement, et qui s’offre aux autres, qui crée lien, le liant, et le relié aux autres… (…)
Figure 1M. Gérard Delver, Association Tout-monde.
« Notre intime ouvre au solidaire pas au communautaire. »
GD : Dans « La matière » le point de départ, je dirais le prétexte, c’est la mort de ta mère. La douleur infinie de la mort d’une mère. Pourquoi un tel point de départ ?
PC : La mort de ceux qu’on aime, et encore plus la mort de sa propre mère, reste l’impact majeur pour une conscience individuelle. Quand on a connu une telle mort au plus intime de soi, cela crée un « avant » et un « après ». La mort de ceux qu’on aime va dans la profondeur mais va aussi dans l’étendue. Elle ouvre à toutes sortes de manques, toutes sortes d’absences et en finale à l’absence ultime, originelle, fondamentale, à ce vide béant pour la totalité de notre esprit qu’est le vertige de l’impensable. L’impensable c’est cette part du réel que nous ne pouvons même pas concevoir, et qui nous fixe soudain chaque fois qu’une mort survient…(…)
GD : Dans ton livre, le deuil devient non pas un pathos stérile et indépassable, mais une effervescence créatrice, une sorte d’élargissement à toutes les origines ? C’est un livre sur la mort ou c’est un livre sur la vie ?
PC : La vie est dans la mort, la mort est dans la vie, l’un ouvre infiniment à l’autre comme l’a dit Héraclite. On ne saurait les dissocier. La mort de ceux qu’on aime, la mort de la mère, ouvre non pas à une absence vide mais à une absence pleine, je veux dire que cela déclenche en vous un jaillissement de pensées, de souvenirs, de sensations, cela réactive vos connaissances, cela vous déclenche pour ainsi dire, déclenche infiniment tout ce que vous êtes. La mort de la mère n’arrête pas, elle précipite ! C’est pourquoi il y a toujours un « avant » et un « après » la mort de la mère, c’est la mort qui peut être la mort la plus extrême…
GD : Il pourrait y avoir mort plus extrême que celle de sa mère ?
PC : Pas de règle. Pas de standard. Cela dépend de chaque individu. Pour certains cela peut être une femme, un fils, un ami, un frère, et pour d’autres tout simplement la mère. Il y a pour chacun de nous une mort majeure qui fonctionne comme une initiation à soi-même, une initiation qui n’est pas fournie par les rituels d’une communauté, mais par un exercice de profondeur en soi et d’élargissement de soi. Avant les communautés nous accompagnaient pour résister à l’impact d’une mort majeure, aujourd’hui avec la laïcisation de nos esprits, le recul des petits mystères, les extensions de la connaissance, nous sommes seuls face au traumatisme de la mort de celui ou de celle qu’on aime. Et, alors que nous croyions avoir vaincu tous les mystères ordinaires, une mort majeure réactive le « « grand mystère » de l’inconcevable, de l’impensable… Et là, pani rimèd si’w pasa pran’y, comme le dit si bien Marijosé Alie. C’est ce « prendre » solitaire que j’ai voulu non pas raconter mais « saisir » dans ce livre… (…)
« Il y a pour chacun de nous une mort majeure qui fonctionne comme une initiation à soi-même… »
GD : Dans ton livre, on voit comment la mort de ta mère te rapproche de tes frères et sœurs, et comment dans le même temps, elle t’envoie vers les origines de l’humanité, et vers les origines des nations antillaises. Homo Sapiens face à la mort devient un des plus fascinants créateurs, et l’esclave africain confronté à l’impensable de l’esclavage, doit renaître, seul lui aussi ; en puissant créateur. La mort dans ces deux cas, déclenche une sorte de sur-vie, elle crée une absence où se met à bouillonner toutes les créativités possibles. La matière de l’absence serait la créativité ?
PC : Oui, « l’absence-pleine » est pour moi le déclenchement de toutes les créativités. Sapiens l’a connue face à la mort de lui-même et de l’Autre. Nos ancêtres africains l’ont connue face à la mort symbolique ou l’horreur inconcevable de la cale du bateau négrier et de l’enfer des plantations. « L’absence-stérile » serait le deuil mortifère, indépassable, un pathos asphyxiant, sans effervescence lumineuses, sans jaillissement. C’est d’ailleurs l’attitude que nous avions généralement face à cet impensable de la cale négrière ou de l’esclavage, un pathos indépassable, gémissant, refusant, d’où ne fusait aucune lumière. Pourtant la lumière en a jailli, nous nous sommes refaits humains, refaits individuellement et par là-même collectivement, avec et contre… (…)
GD : Pourquoi la mort d’une mère nous renverrait-elle aux origines de l’humanité, et à celle de nos pays créoles américains ?
PC : La mort de ceux qu’on aime, la mort déterminante, récapitule tous les traumatismes, d’abord les traumatismes fondateurs de l’espèce à laquelle on appartient, ensuite les traumatismes fondateurs de la communauté dont on est issu. Enfin, elle réactive les traumatismes singuliers de l’expérience obscure, active, fluide et changeante, qui a fait de nous ce que nous sommes, individu précipité dans la relation au monde. C’est ce que j’ai découvert en explorant ce moment de la perte déterminante…
« La mort de ceux qu’on aime, la mort déterminante, récapitule tous les traumatismes, d’abord les traumatismes fondateurs de l’espèce à laquelle on appartient, ensuite les traumatismes fondateurs de la communauté dont on est issu… »
GD : Tu dis que c’est un livre d’initiation. En quoi une telle mort peut être un lieu d’initiation ou « d’auto-initiation « comme tu la formulé ?
PC : L’initiation ne peut plus être collective, elle ne peut être que solitaire et individuelle. Dessous la globalisation capitaliste et financière, nous sommes dans la « mondialité » dont parle Glissant et qui n’est pas la « mondialisation ». L’énergie de cette mondialité est la Relation. La Relation fait exploser les communautés et libère l’individu. Chaque individu doit se construire en tant que personne. Pour ce faire, il est tout seul. Seul comme homo sapiens face à la conscience primale de la mort et face à l’impensable de l’univers. Seul comme le captif africain au fond de la cale. Seul comme le conteur créole qui verbalise son humanité dans le deshumain esclavagiste. Seul comme un tanbouyé-marqueur dans la ronde du lewoz. Seul comme Miles Davis et sa trompette dans un quartet de solitaires… Et comme plus rien ne nous est donné par la communauté, nous devons improviser comme le conteur, comme le jazzman, comme les tanbouyés, comme tous les créateurs contemporains, et nous créer nous-mêmes. Par les rituels, surtout ceux qui nous permettait de nous tenir debout en face de la mort, les communautés nous créaient de toutes pièces. Toute sacralisation en absolus et Vérité est une camisole de force. Les rituels nous sculptaient, nous modelaient, nous conformaient aux exigences communautaires. Aujourd’hui, l’individu doit se créer lui-même, et se trouver tout seul sa solidarité aux autres dans la plénitude de cette création. C’est la plus inouïe des initiations, la plus angoissante, et la grandiose des matières de l’absence… (…) En Europe, face aux vagues de migrants, il y a plus de plénitudes individuelles, d’initiatives éthiques de simples individus pour restituer un peu de dignité au migrants, que d’initiatives étatiques. Les Nations capitalistes sont egocentriques, égoïstes, et laissent mourir à leur porte, dans leur mer. Les individus eux, de manière éparse, solitaires, improvisée, intuitive, agissent en Relation…. (…)
« Aujourd’hui, l’individu doit se créer lui-même, et se trouver tout seul sa solidarité aux autres dans la plénitude de cette création… »
GD : Dans ton livre, il y a trois parties : Impact, éjectats, cratère ? Pourquoi un choix aussi énigmatique ?
PC : J’ai toujours été fasciné par les astres que l’on voit dans l’obscur impensable du cosmos. Leur peau, grise ou noire, apparaît martelée de milliers d’impacts de choses qui aujourd’hui ont totalement disparues, des choses perdues dans la nuit des temps. Leur peau présente des creusements, silencieux, innombrables, avec autour l’ourlet de ce qui a été éjecté, mis en exergue, par l’impact, et qu’on appelle les éjectats. De l’impact ne subsiste que le creux ourlé, le vide incurvé, l’absence ! Cela m’a donné la structuration du livre. D’abord, l’impact de la mort de ma mère sur ma conscience, un instant que j’explore à fond de manière poétique. Ensuite, mon errance toujours poétique dans les éjectats, les souvenirs, les objets, les photos, tout ce qu’elle nous a laissé, et qui devient un scintillant trésor, comme autant de petits soleils d’absences qui me ramènent à l’esprit toutes les absences qui me constituent, mais qui constituent aussi nos humanités, et nos réalités créoles. Enfin, au bout de cette trajectoire, je considère ce qui reste de tout cela, le creux, le cratère ultime, le vertige créateur de l’impensable que plus rien ne saurait occulter…
GD : Le mot absence apparait au début, disparaît pendant tout le livre, pour ressurgir à la fin ? Toute la narration l’explore sans la nommer, c’était le seul moyen ?
PC : Dire l’absence sans la dire tout en la disant, c’est ce que Glissant adorait chez Faulkner. Mais c’est aussi la structure des grands compas direct haïtiens comme « New York city » de Tabou combo ou « Patience » de Robert Martineau… La célébration muette…
GD : Maintenant que tu es en face de l’impensable que va-t-il se passer ? On peut encore écrire en face de l’impensable ?
PC : On ne peut vraiment écrire, créer, penser, philosopher, que positionné-là. Tout le reste est amusement ou pauvreté… (…)
Propos recueillis par Gérard Delver.
Association Tout-Monde.
Juillet 2016.
