— par Michel Herland —
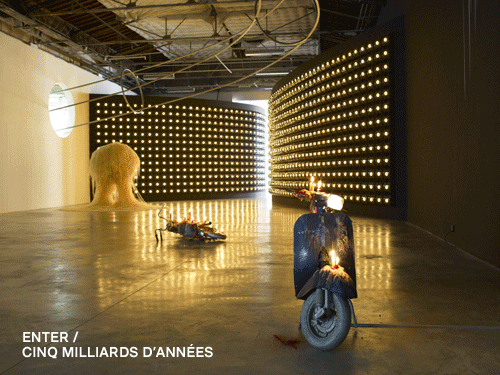
Le débat sur l’art contemporain fait déjà rage et l’on devrait sans doute se retenir d’y intervenir lorsqu’on ne possède pas les patentes et certifications reconnues dans un univers où l’on se retranche d’autant plus volontiers derrière l’élitisme esthétique que l’on est forcément conscient du regard goguenard de la majorité du public. Il y a des moments, néanmoins, où critiquer devient un devoir civique. Et l’exposition actuellement en cours au palais de Tokyo (à Paris, jusqu’au 14 janvier) est une telle caricature de ce que peut produire l’art ( ?) contemporain que l’on ne saurait passer outre au devoir d’indignation.
Pour les lecteurs qui ne seraient pas familiers avec cette forme d’expression artistique, il faut préciser qu’on n’attend pas des artistes contemporains qu’ils proposent du « beau ». Ou bien le beau en question ne peut être que le sous-produit, généralement non désiré, de la démarche de l’artiste. L’art contemporain se doit d’être troublant ; il s’agit de choquer (et bien souvent de choquer « le bourgeois »). Cet art prend le plus souvent la forme d’ « installations » : on confie à l’artiste une pièce ou une partie de pièce dans le musée, espace dans lequel il a la liberté de disposer dans l’ordre ou le désordre qui lui conviennent le mieux une série d’objets, parfois fabriqués pour la circonstance, parfois simplement rassemblés là et c’est alors de leur juxtaposition que doit naître la surprise, le trouble, puisque ce sont là les ressorts principaux de cette sorte d’art. Parfois l’installation se réduit à un objet unique. Tout le monde connaît l’urinoir exposé par Duchamp, sorte d’œuvre inaugurale de la modernité dans l’art, au sens où beaucoup la conçoivent encore aujourd’hui. On notera que, depuis Duchamp, le scato (ou le pisso)-logique est resté une source d’inspiration essentielle. L’auteur de ces lignes garde en mémoire une installation présentée à la biennale de Sydney en juillet 2004 : la reproduction d’une salle de classe de l’école maternelle avec ses petits bureaux et ses petites chaises colorées, et pour couronner – si l’on ose dire – le tout, pour ajouter la touche d’art indispensable pour convaincre les commissaires de l’exposition, bien en évidence au milieu de chaque bureau, une crotte en plastique disposée sur une petite assiette.
On conçoit que, si l’artiste qui propose une telle œuvre se situe dans une « esthétique » bien particulière, son œuvre n’est pas nécessairement « nulle » : que le spectateur soit étonné, dérangé, voire simplement dégoûté et le but recherché sera déjà atteint. Une telle démarche qui repose principalement sur la surprise du spectateur trouve néanmoins assez vite ses limites. Les « concepts » nouveaux susceptibles de faire mouche ne sont pas en nombre infini. D’où l’impression de répétition et de déjà vu que l’on éprouve bien souvent dans les expositions d’art contemporain.
Pour les connaisseurs un peu avertis, le fait de se retrouver devant un « à la manière de » n’est d’ailleurs pas obligatoirement désagréable. Ce peut être l’occasion de rafraîchir sa culture dans le domaine, d’effectuer des comparaisons, de repérer le détail qui fait la différence. Dans l’exposition en cours au palais de Tokyo, l’œuvre la plus contemplée – celle devant laquelle les visiteurs ont envie de s’arrêter – est un petit bonhomme de Kristof Kintera qui n’est pas sans évoquer ceux de Maurizio Catelan. Ici, il s’agit d’un garçon de 6-7 ans, vêtu comme les gamins d’aujourd’hui, avec son baggy, son sweat à capuche et ses tennis. Immobile contre un mur, on ne voit pas son visage et l’on peut croire tout d’abord qu’il s’agit d’un enfant véritable en train de bouder et l’on peut même se prendre à chercher du regard ses parents parmi les autres visiteurs du musée. Néanmoins on comprend vite, à voir avec quelle attention certains des visiteurs déjà présents le contemplent, qu’il ne s’agit pas d’un garçonnet en chair et en os mais d’une « œuvre » et qu’il va se passer quelque chose. De fait, au bout de quelques minutes, la poupée se met à se cogner la tête contre le mur contre lequel on l’a disposée. Après quoi elle reprend sa position figée. L’enfant est mignon ; il se cogne la tête avec une telle force que la violence est désamorcée et le spectateur est plutôt porté à sourire qu’à s’effrayer. Est-ce en raison du caractère paradoxal de notre réaction ? Toujours est-il que cette œuvre là « marche », qu’elle est « effective ».
Reste… le reste de l’exposition intitulée « 5.000.000.000 d’années ». Non seulement la sélection ne justifie en aucune manière ce titre (à l’exception du chimpanzé naturalisé de Toni Martelli, vêtu d’un t-shirt blanc sur lequel est inscrit « Gone ») mais encore, et hélas, les œuvres retenues sont le plus souvent d’une écrasante nullité. Un seau noir comme abandonné sur une marche et titré (oh surprise !) « bucket » ; une barre métallique verticale qui sert de support à une barre horizontale avec une ampoule clignotante à chaque extrémité, dont on nous prie de croire qu’il s’agit d’un « Light Space Modulator » dont les « séquences lumineuses (seraient) inspirées du film L’Exorciste 2 » ; un cercle blanc projeté par un spot sur un mur ; l’image vidéo d’un Gianni Motti vu de dos parcourant d’un pas ferme le tunnel long de 27 km de l’accélérateur du CERN à Genève ; etc.
Tant de prétention associée à une telle impuissance créatrice ne peuvent que laisser les visiteurs troublés mais il s’agit là d’un trouble très différent de celui que l’art contemporain était censé faire naître en nous. Les œuvres nous laissent totalement insensibles. Notre inquiétude est à la mesure de notre incompréhension du projet de cette exposition. Qui a pu vouloir une telle accumulation d’objets sans message et sans âme ? A quelle fin ? Voulait-on simplement nous provoquer ? Etait-ce du second degré ? Rien dans les documents qui accompagnent l’exposition ne permet de le déduire, mais sait-on jamais ce qui peut se passer dans la tête d’un commissaire ? Quoi qu’il en soit, nous avons le droit de faire savoir que nous n’apprécions pas ce canular, qu’il existe – malgré tout – des œuvres fortes dans la création contemporaine, et que le palais de Tokyo n’a pas été rénové à grand frais (et tout particulièrement à nos frais de contribuables) pour montrer ce qui se fait de plus nul dans le domaine.
