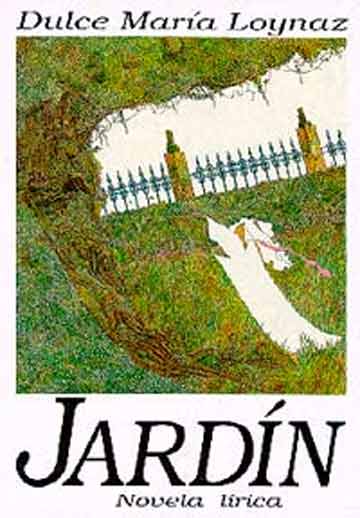 Avec la lucidité provocatrice qui la caractérisait, Dulce Maria Loynaz n´a pas hésité à affirmer que Jardín était un livre hors de propos, bien que la détermination de la date ait été très précise – année, mois, jour et heure -. Ainsi résultait, certainement, l´idée de construire en 1935, l´étape de l’expansion de l´avant-garde, obsédée par le rapide passage des jours et le sauvetage de la portée de la nation, de structurer un roman arrêté en lui, non pas dans le temps et dans un endroit.
Avec la lucidité provocatrice qui la caractérisait, Dulce Maria Loynaz n´a pas hésité à affirmer que Jardín était un livre hors de propos, bien que la détermination de la date ait été très précise – année, mois, jour et heure -. Ainsi résultait, certainement, l´idée de construire en 1935, l´étape de l’expansion de l´avant-garde, obsédée par le rapide passage des jours et le sauvetage de la portée de la nation, de structurer un roman arrêté en lui, non pas dans le temps et dans un endroit.
Comme une plante parasite, le texte se développe autour de La Belle au bois dormant, un conte infantile, inquiétant comme tant d´autres par sa nature perturbatrice. Etranger à une géographie précise, son contexte est celui de l´éternité entre la mer et la côte inhospitalière, la fertilité corrompue des arbres et des herbages, l´horloge arrêtée pour toujours dans le passage des saisons. Le fil conducteur de la saga, Bárbara, au visage flou et à la silhouette imprécise, tire son nom, si cubain en apparence, de son étymologie grecque. En effet, c´est une étrangère, un insaisissable fantôme parmi les fantômes, des figures et des paysages plats, esquissés en superficie, similaires à photos triées selon une chronologie conventionnelle.
Texte écrit sur d´autres textes, sa réalité tangible et son époque se trouvent dans une littérature ayant une forte saveur de fin de siècle. L’abondant chromatisme, ses ors, ses roses, ses gris évoquent une zone moderniste et le serein de ceux qui se sont appelés les décadentistes en France arrive aux parfums chargés du jardin où les pluies précipitent la putréfaction des eaux et des plantes. Une étude statistique révèlera, surtout dans la première partie du roman, la répétition obsessionnelle de l´adjectif sombre.
Le temps et l’endroit indéterminé du « Il était une fois » des contes de fées, préside le récit de Dulce Maria Loynaz, mais l’écrivaine transgresse les essences du modèle référé de façon explicite. Bárbara rencontre le prince enchanté au bord de la mer, après avoir franchi, suite à une inexplicable impulsion interne, la barrière entourant son jardin. La mélodie de la prose se modifie. À peine identifiable par ses moustaches, que nous pouvons imaginer raides ou de kaiser, il l’a conduit à travers l´histoire dans un monde d´images colorées fixes. La modification proposée est exprimée par des touches très courtes. La mention de la jurisprudence évoque l´existence de l´État et de l´argent, l´instrument qui achète tout, y compris les femmes, dans la société contemporaine, alors que l´électricité défini la ville moderne – New York ou Paris. Le cycle naturel des saisons cède la place à la mention des soirées, des théâtres, des façons de se vêtir et de se coiffer, et à une première guerre mondiale reconnaissable par les défilés militaires et la récente indépendance féminine grâce à l´uniforme d´infirmière. La touche de la belle époque ne vient pas de la littérature, mais des revues illustrées qui ont acquis un grand essor lors de ces années-là. Bárbara, cependant, n´a pas beaucoup changé. Elle est encore engourdie dans un rêve agréable. Toujours silencieuse, elle avait prononcé, à partir de ce que l’on pourrait considérer une île/jardin, un mot clé, demain, bien que les faits démontrent que l´avant et l´après sont illusoires. Devant l´éternité insondable, l´avenir de l´histoire manque de sens. Même Dieu se tait. Les êtres humains sont réduits à d’abstraits masques sans nom.
Semblable à l´élan qui l’a fait sortir de son jardin, se manifeste la volonté de retour au point de départ. Elle va entrer dans le domaine d´Eleusis. Le jardin est devenu une jungle sur des marais putrides avec des émanations pestilentielles et visqueuses. Son guide, d’une voix monotone et au regard éteint évoque l’adolescent découvert sur une photo sans date, déchiré entre la passion et la mort. Car l´amour ne constitue pas une réalité corporelle tangible. Comme cela était prévisible, Bárbara disparaît, écrasée par le dépouillement de son ancienne résidence. Avec un rythme accéléré, une ville moderne de fer et de béton commence à être construite à sa place, faite par des travailleurs sans visage. Un autre profil de machiniste de cette image presque concluante surprend chez une écrivaine qui, comme Dulce Maria Loynaz, prétendait presque avec pragmatisme se placer de dos au mouvement artistique de son temps.
Comme un rideau qui ouvre et ferme une représentation de théâtre, Jardín commence et se termine par la répétition d´une même image. Derrière la barrière, Bárbara observe le transit rapide de voitures/jouets, peintes de couleurs vives. Ensuite, quand elle a cessé d’être, un défilé identique se voit au-delà du travail des constructeurs. C’est le reflet d´un espace de liberté, un palais d´une vie insouciante et joyeuse repoussé par l’obscur pouvoir émanant du jardin, la représentation d´un destin qui ne laisse aucune place pour une échappatoire possible. Une écriture notariale – l´auteur a pratiqué le droit – qui ratifie, sans lamentations les sensibleries, l´absence de sens, l´insignifiance de la vie, des projets, des rêves et des aspirations humaines. Un athéisme émouvant, papable chez celle qui a maintenu une obédience au rite catholique. Peut-être qu’une lecture complice de Jardín permettra d’aventurer un regard oblique vers l´intimité d´une famille singulière convertie en légende.
Il est bien connu qu’Alejo Carpentier s’est inspiré de Loynaz pour décrire, dans Le siècle des lumières, le vécu à l’envers, en marge des horaires et des conventions de Carlos, d’Esteban et de Sofia. Encore plus précis, El clan disperso, son roman inachevé raconte l´histoire des épisodes, pris sans doute de ses souvenirs personnels, en relation avec des dîners dans la périphérie de la ville, avec des nappes brodées sur l´herbe, le service d’un major d’homme et une vaisselle d’argent éclairée par des candélabres. Dans le groupe hétérogène se trouve la future avant-garde des musiciens, des peintres et des écrivains, alors des pauvres inconnus. Amateur d’automobile, Carlos Manuel appréciait les grandes vitesses lors des raids nocturnes. Les importantes ressources économiques permettaient aux jeunes aristocrates, aux artistes talentueuses, faire de commandes en Europe des nouveautés musicales et littéraires les plus rénovatrices. Les particules révélaient leurs mystères sur le piano de Carlos Manuel. Dulce Maria a dû être le vilain petit canard dans ce brillant conglomérat. Au moins, on le comprend ainsi par le comportement condescendant assumé par Federico García Lorca, qu’elle n´a jamais oubliée.
À un moment donné, les liens avec l´avant-garde sont coupés. La politisation croissante des minoristas a imposé d’autres combats et les chemins on bifurqués. Dulce María a construit son propre jardin peu à peu. Mariée avec le chroniqueur social Pablo Álvarez de Cañas, consciente de l´énorme distance intellectuelle qui les sépare, elle partage – comme Bárbara – les soirées et les dîners des ambassadeurs.
Le 21 juin 1935, à sept heures moins le quart du soir, Dulce Maria Loynaz arrête les horloges. Elle avait achevé la rédaction du Jardín et elle tourne le dos, définitivement, à n’importe quelle approximation de la modernité. Comme Bárbara, elle reste comme une voyageuse du temps et hors de celui-ci, dans une existence prêtée, entre les silhouettes planes, semblables aux jeux de cartes français. On ne pouvait pas imaginer que le jardin envahirait sa résidence quand les tressaillements de la ville lointaine ont dispersé son univers de fiction. Toujours altière, elle continua à vivre entourée d´objets, de livres et de documents qui préservaient l´atmosphère d´une autre époque. Certaines fissures dans la zone frontalière de son masque peuvent laisser percevoir ce qui est dit, ce qui est proposé et ce qui est caché entre la voix et le silence. Elle ne demande pas de faveur. Courtoise et fière, avec un esprit de classe profondément enraciné, elle a reçu les honneurs qui lui ont été accordés : le Prix National de Littérature à Cuba et le Prix Cervantes en Espagne.

