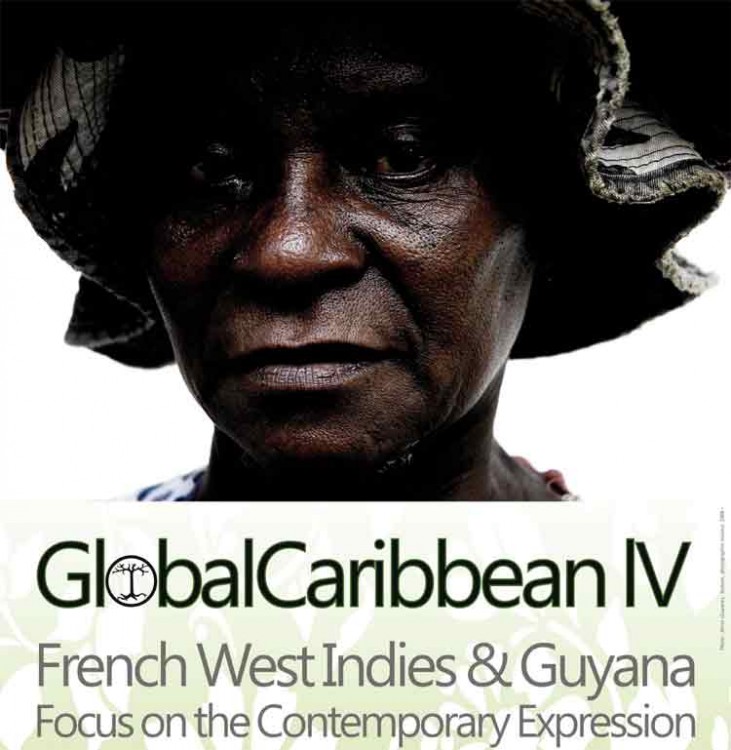Les pratiques artistiques officielles qui se développèrent aux Antilles et en Guyane françaises furent durablement marquées par l’influence de leur métropole. Pendant une longue période, les artistes venaient pour l’essentiel d’ailleurs. Ce n’est que vers la fin de la première moitié du XXe siècle , et malgré quelques réussites antérieures notables , que les artistes locaux s’emparèrent véritablement des arts conventionnels.
Dans la logique de l’assimilation, doctrine qui n’accordait de valeur qu’aux formes et expressions issues de l’académisme parisien, les premiers formateurs des artistes antillo-guyanais furent pour la plupart des Français. Ainsi, à l’ouverture à Fort-de-France (Martinique) en 1943 de l’école des Arts Appliqués, l’essentiel des enseignants venait de France. Par la suite, les artistes qui acquirent une formation académique, l’obtinrent dans des écoles françaises où ils furent influencés par les canons qui y régnaient.
Dans le cadre étroit de cette logique de reproduction, une volonté de nativisation de l’art en Martinique, Guadeloupe, Guyane doit toutefois être signalée. Elle passait principalement par une localisation des thèmes : l’insoumission à l’ordre colonial chez le plasticien martiniquais Khokho René-Corail, ou les paysages chez le peintre martiniquais Marcel Mystille. A mentionner aussi, l’étonnant parcours du peintre guadeloupéen Guillaume Guillon Lethière (auteur du fameux Serment des ancêtres, représentant les grands révolutionnaires haïtiens), qui bien avant l’appropriation de l’art pictural par les siens, connut dans la France des XVIIIe et XIXe siècles un extraordinaire succès.
Les pratiques artistiques populaires échappaient cependant à l’assimilation. Elles relevaient, par leur forme et par leurs thèmes, de la créolisation, phénomène d’hybridation et de réinterprétation systématique, où tout élément adopté fait l’objet d’une adaptation. On peut noter à ce niveau l’usage consistant à coller sur les parois intérieures des cases créoles des pages de journaux provenant d’ailleurs. Photographies et textes agrémentaient alors l’espace et opacifaient les fentes éventuelles des murs de planches ou de bois clissé. Les feuilles imprimées étaient associées dans un ordre
créatif et l’ensemble constituait un « signe diacritique »,pour reprendre un mot de l’anthropologue Richard
Price.
Dans le registre de l’expression populaire créole se distingue la figure d’Edmond Evrard Suffrin, artiste illuminé, prophète du » Dogme de Cham », interprétation nègre de la geste biblique. A compter des années 1950, Suffrin disposa autour de sa maison (Lamentin, Martinique) une véritable installation avant la lettre, faite de divers objets symboliques, dont des tôles d’automobile récupérées où il inscrivait en lettres noires, dans un français » marronné », subversif, les principes de la religion qu’il avait créée; messages qu’il affichait encore dans les défilés carnavalesques. Ce « délire de théâtralisation » fut, comme le souligne l’écrivain Edouard Glissant, » une fixité infaillible à articuler une voix ». Et aussi une œuvre d’art.
Les productions artistiques populaires les plus originales se situent en Guyane, autour des arts des Marrons. Développés au Surinam et en Guyane par les fugitifs des plantations esclavagistes et leurs descendants, pratiqués dans ces milieux dès le plus jeune âge, ces arts d’inspiration panafricaine créolisée sont marqués par l’adaptation à la forêt, au fleuve et, de plus en plus, à l’urbanité. Popularisées sous l’appellation générique d’art Tembé, leurs réalisations donnent à voir des motifs profanes: figures géométriques, polygones, entrelacs. Ces sculptures sur bois en bas-relief,
éventuellement ajourées, ces gravures, ces textiles, ces peintures ornent traditionnellement les portes des habitations, les meubles, les objets usuels, les proues des pirogues, les pagaies. Les arts des Marrons constituent aujourd’hui les manifestations les plus saillantes de la création guyanaise. Leur insertion dans le tissu commercial va croissant, impulsée par des plasticiens comme Franky Amete.
Les tendances actuelles de l’art aux Antilles et en Guyane oscillent entre création très personnelle et valorisation de références collectives locales. Dans le premier cas, l’innovation porte, par exemple, sur le médium utilisé, comme dans les installations du plasticien martiniquais Ernest Breleur, lesquelles mettent en scène des films radiographiques et participent d’une réflexion universelle sur le corps et sa douleur. Dans le second cas, les renvois à des contenus culturels locaux sont très divers. Ils concernent, notamment, la symbolique amérindienne, dont des éléments sont
intégrés dans l’œuvre du guadeloupéen Rico Roberto, ou encore les tapissages des cases de jadis, qui inspirent la martiniquaise Geneviève Moures, laquelle utilise des photos tirées de journaux pour les couleurs de ses collages. Dans un registre similaire, le plasticien martiniquais Christian Bertin traite de la Blesse, douleur interne, reliquat diffus de l’expérience esclavagiste. Et les fondateurs de l’école Négro-Caraibe, les martiniquais Louis Laouchez et Serge Hélénon, font ressurgir dans leurs créations l’Afrique occultée. D’une façon générale, nombre d’artistes s’attachent à des recherches identitaires. Le travail du guadeloupéen Michel Rovelas, peintre et auteur d’oeuvres monumentales,
fut longtemps emblématique de cet investissement-là, avant qu’il ne se mette à explorer d’autres voies.
La réouverture en 1984 à Fort de-France d’une école d’art à l’adresse des Antillo-Guyanais, le développement d’une o!re de cours par des municipalités (cours de René Louise au Service municipal d’action culturelle de Fort-de-France, ou de Michel Rovelas au Lamentin, en Guadeloupe), la tenue d’expositions soutenues par des institutions publiques et privées (Fondation Clément, etc.), tout cela a contribué ces dernières années à un foisonnement d’artistes dans ces régions. Cette effervescence se heurte néanmoins aux limites du marché de l’art en Martinique, Guadeloupe, Guyane et à la difficulté d’intégrer le circuit français, où la méconnaissance des créateurs en question se nourrit d’une vision exotique de ces derniers. Se fait alors jour dans les milieux artistiques des Antilles et de la Guyane françaises, un désir de prendre un autre large, celui de l’Amérique du nord. D’aucuns, comme la plasticienne martiniquaise Chantal Charron, tentent d’y diffuser leurs œuvres tout en demeurant au pays. D’autres, comme le martiniquais Marc Latamie ou le guadeloupéen Thierry Alet, s’installent là-bas. Dans un univers étatsunien très concurrentiel, l’aventure est incertaine. Mais elle reste possible. La trajectoire du martiniquais Henri Marie-Rose en atteste. Né en 1922 au François (sud de l’île), formé à la peinture dans les années 1940 par l’orientaliste français Joseph de la Nézière (un des » éveilleurs » des Martiniquais à l’art pictural), élève de l’école des Arts Appliqués de Fort-de-France, il se fixa, après des séjours en Afrique du nord et en France, à San-Francisco où il vécut 58 ans, avant d’y décéder en 2010. Peu connu dans son île, il acquit en Californie, et singulièrement dans sa ville d’adoption, une renommée appréciable, obtint des prix pour ses sculptures et peintures, enseigna à la California School of Fine Arts, vécut confortablement de son art.
Gerry L’Etang
Ethnologue