Où il sera parlé d’oppression, de résistance, de femmes debout et de liberté conquise !

–– Par Janine Bailly ––
Comme chaque année, le Festival TNB – théâtre, danse, cinéma, musique, performance – est venu illuminer, sur une période de dix jours, un mois de novembre breton partagé entre tempêtes intrusives et surgissements brefs de soleil. Difficile de faire ses choix, difficile de ne pas ressentir quelque frustration tant le programme s’est une fois encore avéré riche, divers, souvent surprenant, et réparti dans la ville, en des lieux autres que les trois salles du Théâtre National de Bretagne. Par bonheur, il est des médias qui vont s’aventurant hors du territoire parisien. Ainsi du magazine Les Inrockuptibles, dont le Cahier complémentaire fut fort utile à guider le spectateur dans ce labyrinthe de spectacles, de textes connus ou à connaître, de comédiennes / comédiens et metteurs / metteuses en scène célèbres ou à découvrir. Un éventail large ouvert, de la proposition la plus ésotérique – dans Grand Palais, de Julien Gaillard et Frédéric Vossier, l’improbable rencontre du peintre Francis Bacon et de son amant George Dyer – au spectacle le plus intimiste, le plus simple en apparence, celui que donne, seule en scène, Yasmine Yahiathène dans La Fracture.
Parce que le temps des femmes doit advenir, ici comme dans la vraie vie ; que le théâtre, s’il ne se contente pas d’être un reflet documentaire mais bien une création, a le droit d’entrer en résonance avec le réel ; et parce que, si un spectacle ne change pas le monde, il aide à en prendre conscience, je parlerai d’abord d’une pièce particulièrement actuelle et vibrante, Les Forteresses, du dramaturge, comédien et metteur en scène Gurshad Shaheman.
Quand nous entrons salle Gabily, sorte de grand hangar hors les murs, dans une zone péri-urbaine un rien désolée, lieu davantage accordé au sujet que le confortable et très citadin TNB, nous pouvons, à condition toutefois d’être en tête d’une longue file d’attente, choisir de prendre place non sur les gradins mais sur de larges divans couverts de tapis persans, et qui dessinent deux côtés en vis à vis de l’espace de jeu. Les deux autres côtés du carré portent chacun une longue table, lieux de saynètes sans paroles venant illustrer le propos des trois comédiennes porteuses du texte, assises, elles, au milieu du public, sur de petites estrades. Un dispositif scénographique qui, d’emblée, nous place au cœur du spectacle, dans une proximité voulue, créant entre elles et nous une connivence bientôt sensible, et qu’atteste le silence où se tiendra, trois heures durant, comme pour s’ouvrir aux paroles et les recueillir en son sein, la salle tout entière.
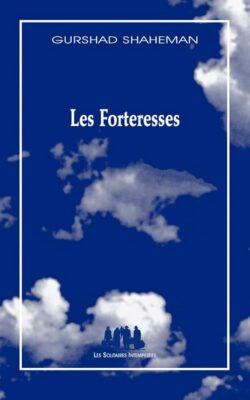 Sont également présentes, mais sur le plateau, resplendissantes de vie, la mère et les tantes de Gurshad Shaheman, trois femmes iraniennes, trois femmes fortes que la vie, les hommes et l’histoire ont malmenées, mais qui ont su tenir la bride haute à leur destin. Qui, droites et debout, luttant contre l’adversité et les méchants tours d’une existence tumultueuse, jamais ne se sont avouées vaincues, toujours se sont relevées : « Les trois femmes sont nées au début des années soixante, à Mianeh, une petite ville des montagnes de l’Azerbaïdjan iranien. Elles ont fait des études, traversé une révolution, vécu huit ans de guerre… ». Gurshad est là, lui aussi, acteur avec elles de séquences mimées symbolisant la vie en Iran ; chanteur interprète de romances en cette langue azérie, aujourd’hui interdite par le pouvoir islamique ; destinataire encore, en tant que fils, des histoires ici entendues, et qui lui furent un jour contées. Et ce sont les trois actrices précédemment évoquées qui prennent en charge, et en langue française, les récits de vie de ces trois femmes, de ces trois sœurs à la fois si proches et pourtant lointaines, séparées dans l’espace, l’une en France, l’autre en Allemagne, et la dernière, en dépit de toutes les vicissitudes, restée à Téhéran. Trois destins singuliers, parfois opposés, mais pareillement marqués par les violences : celles faites par les hommes aux femmes de leur pays, que ce soit dans le domaine public ou dans le domaine intime du couple. Celles des révolutions avortées, détournées, volées au peuple qui les a faites. Celles des guerres meurtrières. Violences encore qui, dans les ténèbres des prisons – qu’elles aient été du Shah ou soient des Ayatollahs – torturent les corps et les âmes, au mépris de toute humanité. Violences enfin, et non des moindres, du voile imposé, et de la religion.
Sont également présentes, mais sur le plateau, resplendissantes de vie, la mère et les tantes de Gurshad Shaheman, trois femmes iraniennes, trois femmes fortes que la vie, les hommes et l’histoire ont malmenées, mais qui ont su tenir la bride haute à leur destin. Qui, droites et debout, luttant contre l’adversité et les méchants tours d’une existence tumultueuse, jamais ne se sont avouées vaincues, toujours se sont relevées : « Les trois femmes sont nées au début des années soixante, à Mianeh, une petite ville des montagnes de l’Azerbaïdjan iranien. Elles ont fait des études, traversé une révolution, vécu huit ans de guerre… ». Gurshad est là, lui aussi, acteur avec elles de séquences mimées symbolisant la vie en Iran ; chanteur interprète de romances en cette langue azérie, aujourd’hui interdite par le pouvoir islamique ; destinataire encore, en tant que fils, des histoires ici entendues, et qui lui furent un jour contées. Et ce sont les trois actrices précédemment évoquées qui prennent en charge, et en langue française, les récits de vie de ces trois femmes, de ces trois sœurs à la fois si proches et pourtant lointaines, séparées dans l’espace, l’une en France, l’autre en Allemagne, et la dernière, en dépit de toutes les vicissitudes, restée à Téhéran. Trois destins singuliers, parfois opposés, mais pareillement marqués par les violences : celles faites par les hommes aux femmes de leur pays, que ce soit dans le domaine public ou dans le domaine intime du couple. Celles des révolutions avortées, détournées, volées au peuple qui les a faites. Celles des guerres meurtrières. Violences encore qui, dans les ténèbres des prisons – qu’elles aient été du Shah ou soient des Ayatollahs – torturent les corps et les âmes, au mépris de toute humanité. Violences enfin, et non des moindres, du voile imposé, et de la religion.
Le texte se tisse de ces trois histoires qui se déroulent, par la parole se recomposant, entrelacées. Se construit de ces choses vécues qui alternent non pas de façon chronologique mais au gré des réminiscences, au rythme de la pensée qui chemine, le souvenir de l’une entraînant le souvenir de l’autre. Car il existe des points d’ancrage, qui permettent de passer comme naturellement, et de façon fluide, d’un récit à l’autre ; des thèmes communs en quelque sorte : la famille, que domine la figure tutélaire d’une grand-mère, les temps heureux de l’enfance, les études possibles ou interdites, l’engagement politique, les manifestations de rues et les arrestations arbitraires, les espoirs et les désillusions, les mariages consentis ou imposés, les séparations ou divorces, la guerre contre l’Irak, l’omniprésence de la police et les prisons, l’exil et la découverte en Europe d’un racisme latent… et toujours, la force que l’on convoque pour assurer la survie et le bonheur de ses enfants.
Qui n’aurait pas pris connaissance du petit livret distribué à l’entrée en salle découvrirait, au moment de l’épilogue, que chaque comédienne était dépositaire de la vie d’une autre, de celle-ci qui après avoir dansé, chanté, servi en silence le thé ou pétri habilement le pain, viendrait s’appuyer sur son épaule et dire en quelques phrases, dans sa langue maternelle, ce qui pour elle resterait, indélébile, gravé dans la mémoire vive. Guilda Chahverdi, Mina Kavani, Shady Nafar n’étaient là que pour prêter leurs voix à Jeyran, Hominaz, Shady.
Un théâtre primordial, de paroles et de gestes aussi, ancestraux, ceux-là que retrouvent et rejouent avec joie pour nous les trois sœurs, sur le plateau. De son spectacle, de ces femmes auxquelles les comédiennes donnent “les mots pour le dire”, Gurshad Shaheman écrit que « leurs voix se succèdent et se complètent, dressant trois paysages intimes enchevêtrés où chacune fait le bilan de sa vie à l’approche du crépuscule ».
P.S : pour des raisons évidentes, il nous fut demandé de ne prendre aucune photographie.
Rennes, le 26 novembre 2023
