Sous la direction de Marie-Albane de Suremain & Éric Mesnard
 L’histoire des traites, des esclavages, des abolitions et de leurs héritages est trop souvent mal connue ou invisibilisée. La demande sociale est pourtant forte et de grandes enquêtes scientifiques nourrissent une recherche internationale qui éclaire les questions d’aujourd’hui, autour de la construction des identités politiques et des discriminations. Cependant, beaucoup reste à faire car les avancées de l’histoire scolaire ne sont jamais acquises.
L’histoire des traites, des esclavages, des abolitions et de leurs héritages est trop souvent mal connue ou invisibilisée. La demande sociale est pourtant forte et de grandes enquêtes scientifiques nourrissent une recherche internationale qui éclaire les questions d’aujourd’hui, autour de la construction des identités politiques et des discriminations. Cependant, beaucoup reste à faire car les avancées de l’histoire scolaire ne sont jamais acquises.
Cet ouvrage offre un tour d’horizon international exceptionnel sur les programmes scolaires et les pratiques pédagogiques de l’école élémentaire au lycée en mettant en connexion l’Afrique, les Amériques et l’Europe. De nombreux retours d’expérience et des propositions pédagogiques pluridisciplinaires enracinées dans la recherche sont présentées. Ce livre s’adresse aux spécialistes de l’école ainsi qu’à un large public, intéressé par le croisement des regards sur les représentations de l’esclavage dans les sociétés actuelles et leurs dynamiques.
Marie-Albane de Suremain est maître de conférences en histoire à l’UPEC – INSPE de l’académie de Créteil et membre du Centre d’études en sciences sociales sur les Mondes africains, américains et asiatiques (UMR 245), Université de Paris. Ses publications portent
sur l’histoire des savoirs et de la colonisation. Éric Mesnard est formateur à l’UPEC – INSPE de l’académie de Créteil. Il travaille depuis de nombreuses années sur l’histoire des Antilles, de l’esclavage colonial et sur leur enseignement. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur la question.
ISBN : 978-2-8111-2806-7
Prix : 28 €
PRÉFACE
Du commerce triangulaire au crime contre l’humanité : l’ enseignement du fait esclavagiste en France
Il y a presque vingt ans, un ministre de l’Éducation nationale et de la Culture, Jack Lang, avait demandé, comme il est souvent d’usage en arrivant rue de Grenelle, qu’une commission établisse de nouveaux programmes pour l’école primaire. Il avait pensé qu’un historien devait la présider et avait confié la tâche à Philippe Joutard, un des pionniers de l’histoire des mentalités qui avait écrit sa thèse sur la place de l’ épopée des camisards1, ces protestants réfractaires à l’ endoctrinement catholique voulu par Louis XIV après la révocation de l’ édit de Nantes, dans la mémoire cévenole. Le ministre ne savait peut-être pas que le Code noir avait été écrit peu de temps après cette loi et que son article premier concernait non les esclaves mais les juifs et les sectateurs de la « religion prétendue réformée ». Philippe le savait et, lorsque la commission se pencha sur le « Grand Siècle », il ne manqua pas d’y introduire l’un de ses ressorts principaux : la traite des êtres humains et l’ économie de plantation2.
Il m’avait proposé de l’aider dans cette tâche difficile qu’est l’écriture de nouveaux programmes scolaires. Elle conduit invariablement à d’innombrables débats contradictoires dans la presse et dans l’ opinion publique.
À l’ époque, j’ étais inspecteur général au ministère et il n’ était pas inutile, pour la commission, d’avoir quelqu’un qui « borde » du côté de cette vénérable institution – plutôt conservatrice – mais aussi des syndicats de l’ enseignement, très attachés au contenu des programmes dont ils allaient devoir se charger et dont on pensait, a priori, qu’ils détestaient surtout les changements.
Je pouvais faire l’un et l’autre. En fait la principale résistance ne vint pas d’où je l’attendais. Les syndicats s’enthousiasmèrent pour ces nouveaux textes et, plus particulièrement, pour ceux d’histoire. Il n’ en fut pas de même à l’inspection générale. Je me souviens encore de ce collègue m’apostrophant, sans rire et sans se rendre compte de ce qu’il disait, d’un péremptoire : « Il va encore falloir se flageller ! ». Aimant sincèrement la République pour tout ce qu’elle avait fait et avait encore à faire, il étendait sa reconnaissance à l’Ancien Régime qui ne pouvait, lui non plus, avoir failli. Certes, c’était un an à peine après le vote de la loi Taubira et il n’allait pas de soi d’enseigner que l’ esclavage avait été l’un des aspects essentiels de l’enrichissement des empires depuis la découverte des Amériques. On ne cherchait pas encore trop à savoir d’où était venu l’argent qui avait permis la floraison d’une architecture somptuaire dans les grandes villes de l’Atlantique ou à Paris.
Pour comprendre les réticences explicites ou implicites qui s’ opposaient à ce qui apparaissait alors comme une « nouveauté », il faut se rappeler que l’enseignement de l’histoire en France était et reste encore l’une des conséquences majeures de la longue Révolution dont François Furet disait qu’elle ne se termine qu’avec la IIIe République et la réconciliation de la Nation autour d’un récit de son enfantement. Comparer les livres d’histoire de la Restauration ou de la monarchie de Juillet (celui de Madame de Saint-Ouen, l’un des best-sellers du jeune Louis Hachette, par exemple) avec ceux qui naissent à la fin du Second Empire (Duruy) et s’épanouissent sous la République (Lavisse) donne la clé. Les premiers établissaient la succession des règnes depuis le mythique roi Faramond qui aurait engendré la « France » en la libérant du joug romain et en l’attachant à l’Église catholique.
La continuité de ses successeurs – garantie par la loi salique dont il aurait été l’inventeur – assurait la continuité de la nation. Avec Victor Duruy et surtout Ernest Lavisse, le peuple des Gaulois, et non plus celui des chefs francs, devenait acteur et ses descendants créaient la France3.
Dans un remarquable petit livre sur les manuels d’histoire de l’ école primaire écrit à l’ époque où il y avait encore des écoles normales – nostalgie ! –, deux professeurs, Claude Billard et Pierre Guibbert4, avaient remarqué que le récit de la construction de la Nation tel qu’il avait été conçu par Lavisse et tel qu’il était toujours enseigné dans les années 1960-1970 était une sorte de roman de formation. Chaque étape devenait une leçon que le peuple turbulent devait apprendre pour avancer dans la voie du progrès : les soubresauts de l’histoire n’ étaient que les crises successives d’une longue enfance confrontée à une éducation toujours victorieuse. Si le peuple était la puissance vitale de la nation, son histoire se confondait avec celle des apprentissages successifs qui structuraient sa dynamique dans la charpente toujours plus rationnelle de l’État, dont la République était la forme adulte.
On comprend, dès lors, que tout ne pouvait pas faire histoire enseignable.
Parmi la longue succession de ces « progrès », l’école devait sélectionner ceux qui, véritablement, donnaient sens à sa mission : faire du vif argent de l’enfance une rationalité adulte susceptible de devenir un agent de ce même progrès. Si, dans ce récit, le serf devenait paysan, et le paysan, ouvrier, avant que son fils ne devienne… instituteur, que pouvait devenir celui que l’ on désignait comme un esclave ? Si l’on regardait du côté de la seconde et définitive abolition, elle pouvait magnifier une République (la seconde) et l’un de ses ministres, Schoelcher, mais certainement pas ceux qui étaient censés avoir bénéficié de leurs largesses.
Pour les élèves des collèges ou des lycées, les livres scolaires – et le Malet-Isaac5 de mon enfance tout particulièrement – avaient trouvé une solution : le commerce triangulaire. Les auteurs enseignaient que les bateaux qui rapportaient vers la France les précieux produits tropicaux des Amériques (sucre, café, chocolat, coton, etc.) pouvaient rationaliser leurs trajets. Au lieu de partir à vide pour se rendre aux Amériques, ils augmentaient leur profit en chargeant à Nantes ou à Bordeaux les rouleaux de fausses indiennes fabriquées en Europe, en les échangeant en Afrique contre des captives et des captifs, et en vendant ces derniers aux planteurs dont il ne leur restait plus qu’à remporter le sucre, quasiment sans bourse délier. Avec le commerce triangulaire, le mercantilisme colonial connaissait son apogée, le Grand Siècle pouvait construire ses palais, et ceux que l’on désignait comme des esclaves n’avaient jamais autant été des marchandises. Des hommes et des femmes razziés dans leurs pays dont plus de la moitié allaient mourir avant même d’atteindre le lieu où ils deviendraient des machines à produire pendant que leur humanité serait définitivement déniée, ne pouvaient entrer dans le discours de l’histoire enseignée. Quelle conclusion en aurait-on tiré ? On avait besoin du commerce triangulaire pour rendre compte de cet apogée de l’Ancien Régime qui nous laissa tant de signes de grandeur, et que l’hubris de Louis XIV et l’inconséquence de ses successeurs allaient conduire à la crise révolutionnaire.
On n’avait pas besoin des « esclaves » pour nourrir le récit national.
Certes, il y eut de grands chamboulements dans l’enseignement de l’histoire. Ce fut le cas, après le succès de ce qui un temps s’appela la « nouvelle histoire » à l’université, lorsque l’ école et le collège envisagèrent d’abandonner la succession chronologique des chapitres au profit de l’étude de grands thèmes. Ou encore, lorsqu’on introduisit au même moment la « méthode » historique dans la salle de classe (essentiellement l’analyse de documents sélectionnés). Ni l’une ni l’autre de ces nouveautés ne firent un peu plus entrer les esclaves et leurs descendants dans le discours scolaire. On pouvait vouloir faire des élèves de « petits historiens » sans modifier le récit historique proprement dit. Le recentrage sur une histoire très contemporaine et globale dans les plus grandes classes (porté par les historiens de Sciences Po) ne changea rien à la donne, bien au contraire. Et, récemment encore, lorsqu’on mettait le temps des Révolutions au programme de l’agrégation pour englober dans un même regard l’Europe et les Amériques, on n’y incluait pas pour autant la Révolution haïtienne qui était encore considérée comme un épisode malheureux de l’histoire coloniale de la France. Après tout, Robespierre n’ était-il pas censé avoir dit « Périssent les colonies plutôt qu’un principe » ?
En fait, pour que l’on parle avec les élèves de toutes les classes des hommes et des femmes qui avaient été mis en esclavage ou étaient nés considérés comme tels, il fallait au moins disposer de deux choses : un but éducatif et des matériaux adéquats venus des recherches des historiens.
Le but éducatif s’est construit autour d’un nouveau concept juridique apparu dans le sillage des procès de Nuremberg à l’issue de la Seconde Guerre mondiale : le crime contre l’humanité et son imprescriptibilité. Dans un pays comme la France qui n’a jamais véritablement accordé un rôle central à la formation juridique du citoyen, préférant laisser les professeurs d’histoire « et d’éducation civique » s’en débrouiller en insérant dans le récit national l’accès à l’état de droit et les constitutions successives qui en découlent, ce déplacement ne va pas de soi. Il recentre la réflexion sur les victimes plutôt que sur leurs bourreaux actifs ou passifs. La Libération et ses lois sociales, les Trente Glorieuses et le bonheur de la consommation effrénée, la construction de l’Europe et les mains enlacées de François Mitterrand et de Helmut Kohl, ne peuvent plus être des conséquences heureuses de la pathologisation de la révolution industrielle que furent la colonisation de l’Afrique et de l’Asie, les deux guerres mondiales du xx>e siècle et la Shoah6. Il reste les victimes, et le droit nous enseigne que leur anéantissement n’a pas de prix. Dans le cas de la Shoah, il n’y eut guère que Jean-Marie Le Pen et ses partisans pour dénoncer l’attitude « victimaire » que l’introduction de cette vision dans l’ éducation entraînerait. Il y voyait, bien sûr, une sournoise entreprise visant à émasculer dès l’ école les futurs vrais Français.
Il n’en fut pas de même, lorsque, avec l’intelligence obstinée qu’on lui connaît, Christiane Taubira parvint à faire inscrire le fait esclavagiste et ses conséquences dans la liste des crimes contre l’humanité. Je suis prêt à prendre le pari que les parlementaires qui ont voté la loi en 2001 ont pensé avoir offert un hochet bon marché à une représentante de l’Outre-mer et à ses électeurs. Que savaient-ils de cette institution sinon ce que leur en avait appris l’ école : un malheureux « détail » du temps où la France était grande ?
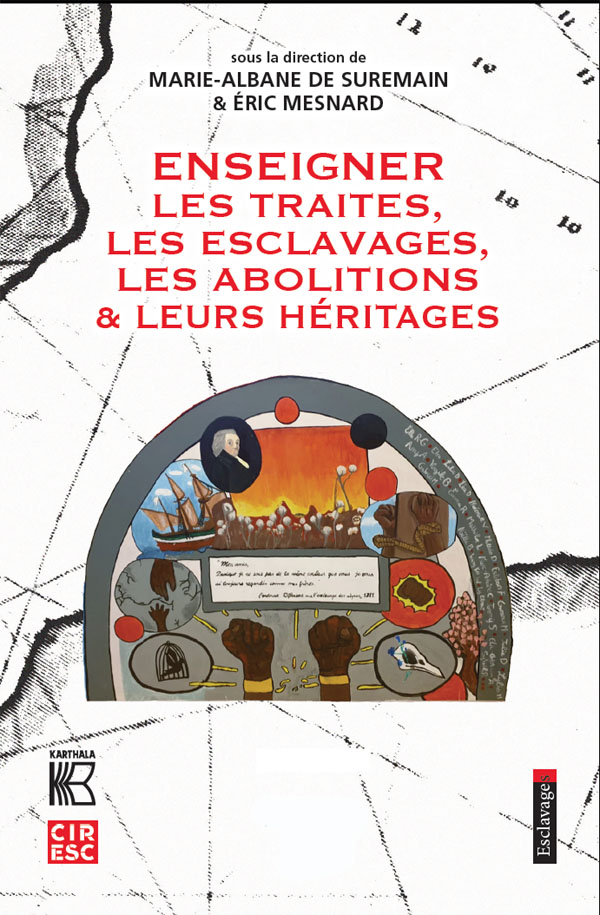 Qu’en avaient à faire les Français de l’Hexagone et leurs enfants ? N’ étaient-ce pas surtout des « indépendantistes » qui se battaient en Guadeloupe, Guyane, Martinique ou à La Réunion pour que l’ on enseigne dans les classes ce que le passé des colonies françaises, devenues départements, avait été ? Certes, quelques-uns d’ entre eux qui avaient rejoint la France métropolitaine tentaient d’y introduire aussi le débat, mais leurs voix étaient peu audibles et souvent dispersées. De plus, elles contribuaient à nourrir la suspicion que cet enseignement divisait au lieu d’unir, qu’il jouait contre l’universalité de la République7.
Qu’en avaient à faire les Français de l’Hexagone et leurs enfants ? N’ étaient-ce pas surtout des « indépendantistes » qui se battaient en Guadeloupe, Guyane, Martinique ou à La Réunion pour que l’ on enseigne dans les classes ce que le passé des colonies françaises, devenues départements, avait été ? Certes, quelques-uns d’ entre eux qui avaient rejoint la France métropolitaine tentaient d’y introduire aussi le débat, mais leurs voix étaient peu audibles et souvent dispersées. De plus, elles contribuaient à nourrir la suspicion que cet enseignement divisait au lieu d’unir, qu’il jouait contre l’universalité de la République7.
C’ est que, dans le cas de la loi Taubira et contrairement à la loi Gayssot8, la relation entre l’ enseignement de l’ esclavage et l’ éducation à l’universalisme républicain ne reconnaissant ni race ni religion n’allait pas de soi. En effet, si aux États-Unis ou au Brésil – qui furent les territoires de colonies esclavagistes –, ce lien était immédiat, ce n’ était pas principalement le fait esclavagiste qui avait nourri le racisme du deuxième XXe siècle en France métropolitaine mais la seconde colonisation, notamment en Afrique du Nord, et la diaspora après la guerre d’Algérie. Ne se trompait-on pas de combat ? La réalité de l’ esclavage apparaissait au pire comme un problème importé pour nuire à la République, au mieux comme un accès d’ exotisme.
Que pouvait « enseigner » l’histoire du crime contre l’humanité qu’avait été l’ esclavage ?
Comme souvent dans l’ école, c’est en tâtonnant pour répondre à l’injonction de la loi, en inventant des dispositifs didactiques, en révisant des manuels scolaires, en se confrontant à ses élèves que le but s’est progressivement dégagé. Ce livre en témoigne, si le commerce triangulaire pouvait s’insérer parfaitement dans le récit national, il n’en était pas de même lorsque ce que l’ on voulait faire comprendre aux élèves, « pour en faire des citoyens éclairés », était que les hommes et les femmes devenus des esclaves avaient été les victimes d’un crime imprescriptible, c’ est-à-dire d’un crime qui ne peut être oublié. Un crime dont les auteurs ne pouvaient plus être jugés mais qui, pour autant, ne pouvait être effacé. Un crime dont notre histoire était définitivement chargée.
Peut-être est-ce parce que j’ai surtout vu cet enseignement se mettre en place dans les écoles primaires et les collèges, mais il me semble que ce qui l’a d’emblée caractérisé est qu’il ne peut s’inscrire uniquement dans une vision historienne. La fiction – c’ est-à-dire la littérature et les arts – en a certainement été le premier outil et un outil nécessaire. Il y a plusieurs raisons à cela.
La première est que, au moment où a été votée la loi Taubira, les écrivains avaient, bien mieux que les historiens jusque-là, fait vivre l’imprescriptibilité du crime en donnant une existence fictionnelle mais incarnée à ceux qui en avaient été les victimes. La littérature de langue française née sur les terres autrefois coloniales et esclavagistes avait su faire de la question de l’esclavage et de ses conséquences l’une de ses thématiques majeures. Et quelles œuvres n’a-t-elle pas produites ? C’est par la fiction, souvent par la poésie, que notre passé esclavagiste a repris chair, qu’il s’ est incarné en des figures et des phrases elles aussi imprescriptibles. Laissons seulement résonner, parmi tant d’autres, la voix d’Aimé Césaire : « tête trophée membres lacérés / dard assassin beau sang giclé […] l’ oiseau aux plumes jadis plus belles que le passé / exige le compte de ses plumes dispersées9 ». Les mots de ces écrivaines et de ces écrivains n’avaient pas attendu une tardive loi pour s’imposer à nous10. Ils parlent sans filtre aux enfants ou aux adolescents, à ceux d’hier comme à ceux d’aujourd’hui.
La seconde raison expliquant les difficultés à mettre en œuvre l’injonction de la loi Taubira était que les historiens professionnels étaient loin d’avoir fait, en France, le travail qui aurait dû être le leur en dépit de quelques voix qui clamaient dans le désert, souvent d’ailleurs, des marges de l’université11.
Il est vrai que la prégnance des concours de l’enseignement secondaire est si forte dans l’ enseignement dispensé par les universités françaises que les programmes scolaires en vigueur définissent les savoirs dont on a besoin et, donc, les postes à pourvoir et, en conséquence, les bonnes « recherches », c’est-à-dire celles qui peuvent conduire rapidement à un emploi. L’histoire des esclavages restait si marginale dans les programmes scolaires, y compris dans ceux qui avaient été écrits après 2001, qu’elle ne justifiait pas un champ d’ études formalisé dans les cursus universitaires. Sans les travaux qui en auraient découlé, comment écrire de nouveaux manuels ? Comment inventer de nouvelles pédagogies ? Comment appliquer ces programmes ? Cercle vicieux…
En fait, si l’on n’ignorait plus entièrement les charpentes économiques et politiques de l’institution esclavagiste, l’histoire des femmes et des hommes dont on avait fait des esclaves restait à faire en France pour que l’école puisse s’ emparer des personnes et non plus des chiffres, de violences et non plus de normes juridiques, bref pour qu’elle s’ empare du « crime ». Les deux tournants majeurs de l’histoire des esclavages qui avaient été pris successivement dans les années 1970, puis dans les deux dernières décennies aux États-Unis et au Brésil ont enfin été considérés en France. Le premier relisait les archives non du point de vue des administrations qui les avaient écrites mais du point de vue de celles et ceux dont elles encadraient les existences fragiles.
Il découvrait derrière l’organisation de l’asservissement les multiples formes de capacité d’agir (agency) de ceux qu’on avait voulu priver de libre arbitre. Le crime n’ était plus imposé à des êtres passifs, il suscitait d’innombrables formes de rébellion dont la révolte n’ était qu’un aspect parmi bien d’autres12.
Le second – en réaction contre le premier – replaçait la plantation dans l’expansion capitaliste occidentale pour mieux décrire la violence qui lui était inhérente et l’incarner dans les pratiques de ceux qui l’avaient instaurée13.
Même si les tenants des deux approches s’opposent historiographiquement, ils se complètent parfaitement dans une perspective didactique et, cernant le crime de plus près, le rendent plus palpable. Ce faisant, ils offrent aux professeurs des écoles, des collèges et des lycées les matériaux qui rendent possible un enseignement du fait esclavagiste.
Dans le contexte états-unien, ce transfert de savoirs mais aussi de méthodes n’est pas nouveau. Dès 1915, l’Association for the Study of African American Life and History (ASALH) avait compris qu’en face de la ségrégation, du KKK et des assassinats d’innocents par des foules se considérant comme blanches (lynchings), chercheurs et maîtres d’ école noirs partageaient le même combat au sein de leur communauté14. Plus près de nous, la fondation Gilder Lehrman Institute of American History, créée en 1994 et devenue l’une des plus importantes institutions de formation continue des enseignants aux États-Unis, met à disposition des écoles et des high-schools de toutes les communautés les matériaux les plus récents produits par les universités, notamment ceux provenant des deux grands tournants évoqués ci-dessus.
Au Brésil, c’est avec le retour de la démocratie, à la fin des années 1980, que la mémoire du passé esclavagiste est devenue une cause nationale dont l’enseignement n’était plus remis en cause. Avec les réformes scolaires du président Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), l’université s’ est pleinement investie dans la production des savoirs et des matériaux susceptibles de soutenir de véritables démarches pédagogiques15. Depuis, beaucoup d’ enseignants-chercheurs, et parmi les plus notables, n’ ont jamais cessé de mettre eux-mêmes la main à la pâte en écrivant directement pour les enfants ou en organisant à leur intention des recueils d’archives. Toutefois, avec le président Lula (2003-2010), le transfert est devenu rétroaction. En effet, en faisant de l’histoire générale de l’Afrique un enseignement obligatoire dans les écoles brésiliennes16, il a incité les universités à développer leurs départements africanistes, modifiant profondément la vision de l’ esclavage qui était la leur.
Lorsque la loi Taubira fut publiée, en 2001, nous étions loin de disposer des mêmes matériaux et des mêmes instruments en France. La recherche fondamentale, elle-même, restait très en retard non seulement par rapport au Brésil ou aux États-Unis, mais aussi par rapport à d’autres métropoles esclavagistes européennes comme le Royaume-Uni ou les Pays-Bas. Les travaux menés par les universités des départements dits d’outre-mer étaient toujours considérés comme des apports à l’histoire locale. Seule la Révolution haïtienne avait bénéficié d’un timide sursaut à l’occasion des fêtes du bicentenaire de la Révolution française à la fin des années 1980 et dans la décennie suivante. La collection dans laquelle paraît ce livre et le laboratoire du CNRS qui la porte montrent dans quelle direction il fallait aller : internationaliser la recherche française et encourager les étudiants de master et de doctorat à produire les savoirs dont on avait besoin, dans des perspectives sans cesse relancées par les liens avec les chercheurs les plus concernés, en Europe et dans les Amériques bien sûr mais aussi en Afrique ; créer les supports pour la publication de ces recherches (collection, revue) ; mettre en place des bases de données d’instruments pour la recherche mais aussi l’enseignement ; enfin et peut-être surtout construire les ponts nécessaires avec l’école>.
Ce livre en témoigne, construire des savoirs assurés est absolument nécessaire mais certainement pas suffisant. Il y en a tant qui se succèdent dans la journée d’un élève de l’ école primaire, du collège ou du lycée : une tranche de géométrie, une de sciences de la vie, une de langue vivante avant celle d’histoire qui pour l’ occasion portera – pourquoi pas ? – sur l’ esclavage… Cette fois, il faut que l’attention change de registre, que l’ évidence de l’importance radicale du sujet l’ emporte sur la litanie des apprentissages certes importants mais ordinaires. Il y eut crime, et il est imprescriptible… Et l’évocation de celui-ci, comme de quelques-uns des autres qui jalonnent nos mémoires d’un passé commun, doit « éduquer » nos élèves tout en exigeant de nous, enseignants, un peu plus que ce qui fait notre labeur quotidien de passeurs de savoirs.
Mon collègue qui n’aimait pas se flageller et qui détestait ce qu’il croyait être un « discours victimaire » n’avait pas compris qu’il ne nous appartient pas, nous adultes, de dire aux nouvelles générations dont nous avons accepté de diriger l’éducation que leur futur sera éclatant parce que nous avons tout fait pour qu’il le soit, parce que nous considérons les crimes du passé comme des errements intempestifs qui peuvent être oubliés. Il nous appartient seulement d’assumer sans trembler ce passé que nous avons construit, comme celui dont nous avons hérité. L’assumer, c’ est-à-dire le mettre devant les yeux de ceux que nous éduquons avec des mots sincères, des savoirs établis, et des émotions qui relient entre elles nos communes humanités, depuis la nuit des temps.
Jean Hébrard
EHESS / Mondes Américains et Johns Hopkins University
1. Philippe Joutard, La Légende des camisards : une sensibilité au passé, Paris, Gallimard, 1977.
2. « Horaires et programmes d’ enseignement de l’ école primaire », Bulletin officiel du ministère de l’Éducation nationale et du ministère de la Recherche, n>o 1, 14 février 2002.
3. Madame L. de Saint-Ouën, Histoire de France depuis l’ établissement des Francs dans les Gaules jusqu’à nos jours, Nancy, Auguste Vitard, 1832 (cédé la même année à Louis Hachette) ; Victor Duruy, Abrégé de l’histoire de France, Paris, Louis Hachette, 1850 (c’ est cet abrégé en 3 vol. qui a été transformé par la maison Hachette en manuels scolaires pour tous les niveaux de l’ enseignement) ; Ernest Lavisse, Leçons préparatoires d’histoire de France, Paris, Armand Colin, 1876 (cet ouvrage sera décliné pour toutes les classes avec différents titres chez le même éditeur jusqu’ en 1957).
4. Claude Billard & Pierre Guibbert, Histoire mythologique des Français, Paris, Galilée, 1976.
5. Albert Malet & Jules Isaac, Cours d’histoire, Paris, Hachette, 1902-1961.
6. Je suis là l’hypothèse générale d’Hannah Arendt dans The Origins of Totalitarianism, New York, Schocken, 1951 [trad. fr. Les Origines du totalitarisme, Paris, Le Seuil, 1972].
7. L’ épisode de la plainte contre Olivier Pétré-Grenouilleau, un temps déposée en 2005 par l’un de ces militants, non pour son livre Traites négrières, essai d’histoire globale (Paris, Gallimard, 2004) – par ailleurs fort contestable dans son projet de noyer la traite atlantique dans une histoire générale de la servitude –, mais pour ses prises de position dans la presse à propos d’une possible ou impossible hiérarchie des crimes contre l’humanité, a profondément divisé les historiens. Beaucoup n’ ont pas vu que si, dans notre métier nous ne devons rendre des comptes qu’à notre communauté scientifique, dans notre participation au débat public nous redevenons des citoyens dont les opinions, même éclairées, n’ échappent plus aux évaluations éthiques ou même morales qu’une démocratie encourage.
8. Loi du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe dont l’article 9 fait du négationnisme des crimes contre l’humanité un délit.
9. Aimé Césaire, « Beau sang giclé », Ferrements, Paris, Éditions du Seuil, 1960.
10. On peut même penser, à lire Christiane Taubira, que c’ est dans la littérature qu’ elle a puisé la force de sa conviction politique.
11. Je pense ici particulièrement à Yves Bénot et Marcel Dorigny qui, lors de la commémoration du bicentenaire de la Révolution française, avaient créé un groupe de chercheurs au sein de l’Institut d’histoire de la Révolution française (IHRF) pour faire avancer les travaux jusque-là délaissés sur l’ espace colonial à l’ ère des Révolutions, mais qui n’ ont pu continuer à travailler sereinement dans ce cadre après le départ de Michel Vovelle de la direction à l’IHRF. En 1993, ils se sont décidés à mettre en place une association indépendante : l’Association pour l’ étude de la colonisation européenne (1750-1850). Parmi les fondateurs, outre Bénot et Dorigny, on trouvait Francis Arzalier, Bernard Gainot, Florence Gauthier, Jean-Claude Halpern, Ann Thomson, Dominique Taffin et Éric Mesnard. L’association instaura un séminaire mensuel, toujours actif. À relire aujourd’hui les résumés des communications qui y ont été présentées (Résumés des communications présentées lors des séminaires mensuels, 1995-juin 2018, avec un « Bref aperçu historique de ses origines et de ses objectifs » par Marcel Dorigny, Paris, APECE, 2018), on se rend compte qu’aucun des ténors ou des nouveaux venus au sein du champ de recherche sur les esclavages et les traites en France ne manque à l’appel. Les colloques de l’APECE, souvent tenus en collaboration avec l’université Paris-VIII, ont été tout aussi décisifs, notamment celui de 2002 qui permit, à l’ occasion de l’anniversaire du rétablissement de l’ esclavage dans les colonies françaises et certainement pour la première fois, un dialogue nourri entre chercheurs haïtiens, nord-américains et européens.
12. C’ est Stuart Schwartz (« Resistance and Accommodation in Eighteenth-Century Brazil: The Slaves’ View of Slavery », Hispanic American Historical Review, n>o 57/1, 1977) qui a fait le lien entre l’historiographie états-unienne et celle qui se développe au Brésil dans les années 1980 en proposant le doublet « résistance-accommodation », notamment lorsque Silvia Hunold Lara choisit cette optique pour étudier dans sa thèse les archives judiciaires d’une région de production sucrière au Brésil (Campos de violência. Escravos e senhores na capitania do Rio de Janeiro, 1750-1808, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1988).
13. Deux livres de Walter Johnson aux États-Unis et deux tout aussi importants de Sidney Chalhoub au Brésil sont un bon exemple de cette transition. Johnson, qui avait publié en 1999 Soul by Soul: Life Inside the Antebellum Slave Market (Cambridge, MS, Harvard University Press) que tous les partisans du premier tournant avaient salué comme un « tour de force », avait ensuite écrit un article au vitriol contre l’agency (« On Agency », Journal of Social History, vol. 37, n>o 1, 2003, p. 113-124), avant de publier un ouvrage complètement inscrit dans l’historiographie du « nouveau capitalisme » : River of Dark Dreams: Slavery and Empire in the Cotton Kingdom (Cambridge, MA, Harvard University Press, 2013). Sidney Chalhoub avait été formé à l’Université fédérale Fluminense (UFF) puis à l’université de l’État de São Paulo à Campinas (Unicamp) avec la génération qui avait mis l’agency au coeur de ses recherches (en témoigne son magnifique Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na Corte, São Paulo, Companhia das letras, 1990). Il prend le tournant en 2012 avec A Força da Escravidão: ilegalidade e costume no Brasil oitocentista (São Paulo, Companhia das Letras).
14. Sous l’impulsion de son président, l’historien Carter G. Woodson, l’association qui se dénomma d’abord « Association for the Study of Negro Life and History », créa l’année suivante le Journal of Negro History qui devint rapidement le plus important vecteur de l’histoire de l’ esclavage et du post-esclavage aux États-Unis, puis, dans la foulée, en 1926, déclara que la deuxième semaine de février serait dorénavant la Negro History Week dans tout le pays, moment toujours aussi vibrant aujourd’hui et étendu à un mois entier sous le nom de Black History Month.
15. Brasil, Secretaria de Educação Fundamental, Parâmetros Curriculares Nacionais (1ª a 4ª séries), Brasília, MEC/SEF, 1997 et Parâmetros Curriculares Nacionais (5ª a 8ª séries), Brasília, MEC/ SEF, 1998.
16. Loi n>o 10.639 de 2003 rendant obligatoire l’ enseignement de l’histoire et de la culture afro-brésilienne et africaine dans toutes les écoles, qu’ elles soient publiques ou privées.
17. Ce programme est le noyau central de l’agenda du CIRESC créé en 2006 à l’initiative de Myriam Cottias. C’ est grâce à ce laboratoire et aux chercheurs réunis dans ce projet que l’histoire des esclavages et des traites a été détachée de son ancrage français initial (l’histoire des Révolutions) pour s’inscrire dans la dynamique internationale (notamment venue des États-Unis et du Brésil), mais aussi pour y ajouter une nouvelle dimension en incluant les recherches haïtiennes, africaines (notamment au Sénégal) et les spécialistes des traites méditerranéennes. Dans le domaine qui nous intéresse plus particulièrement ici, des relations entre construction des savoirs et éducation, un autre pas important a été fait lors de la mise en place d’un concours annuel à destination des écoles, des collèges et des lycées, intitulé « La flamme de l’ égalité », sur le thème de l’ esclavage, des traites et de leurs conséquences, alors que M. Cottias était la présidente du Comité pour la mémoire et l’histoire de l’ esclavage, aujourd’hui Fondation pour la mémoire de l’ esclavage.
