— par Janine Bailly —
À Tropiques-Atrium : « M’appelle Mohamed Ali »
Au théâtre Aimé Césaire : « Ô vous frères humains »
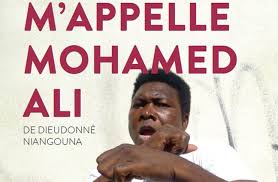 Aujourd’hui, entrée dans cet âge où l’on peut sur soi et ses chemins de vie se retourner, il me semble juste de dire que tout acte théâtral, qui m’a fait grandir et comprendre le monde comme il va, était un acte engagé, non pas essentiellement au sens politique du terme, mais engagé toujours auprès des hommes, engagé car inscrit dans une dynamique de progrès et de cheminement vers une société plus juste, plus tolérante et plus belle. Les deux derniers spectacles, vus à Fort-de-France, en dépit de certaines faiblesses m’ont confortée dans cette idée— utopique ? — que le théâtre est vital, et que par les arts on pourrait bien tenter de sauver le monde !
Aujourd’hui, entrée dans cet âge où l’on peut sur soi et ses chemins de vie se retourner, il me semble juste de dire que tout acte théâtral, qui m’a fait grandir et comprendre le monde comme il va, était un acte engagé, non pas essentiellement au sens politique du terme, mais engagé toujours auprès des hommes, engagé car inscrit dans une dynamique de progrès et de cheminement vers une société plus juste, plus tolérante et plus belle. Les deux derniers spectacles, vus à Fort-de-France, en dépit de certaines faiblesses m’ont confortée dans cette idée— utopique ? — que le théâtre est vital, et que par les arts on pourrait bien tenter de sauver le monde !
« M’appelle Mohamed Ali » est un monologue écrit, avant et pendant le spectacle, car au texte initial s’adjoignent des propos liés au lieu et à l’actualité. Un monologue écrit-improvisé-joué, qui se voudrait dialogue, mais qui est plutôt une sorte de longue conversation à sens unique proposée à la salle. Si Etienne Minoungou est en entrée de jeu assis au premier rang du public, s’il serre la main à une voisine ravie de l’aubaine, et qui opinera tout au long du spectacle, s’il interpelle cet homme, au hasard, pour s’enquérir de son bien-être, brisant allègrement et avec une démagogie par trop évidente le quatrième mur, la pertinence et la force de ce qu’il donne et veut signifier se trouvent ailleurs. Ailleurs sur la scène qu’il investit de son corps dansant, devenu sosie du boxeur auquel par ses gestes et ses mots il rend hommage. Ailleurs dans le rappel de ce que fut Mohamed Ali, autrefois Cassius Clay, qui selon le dramaturge Dieudonné Niangouna « a retourné le combat pour en faire un moment de spectacle », boxeur à deux reprises dans la vie “mis au tapis” mais toujours se relevant pour affirmer la dignité de l’homme noir. Dans cette connaissance que le combat est toujours à mener, hors du ring et sans jamais baisser la garde quand perdurent le racisme, l’injustice et les inégalités. Dans la valorisation de ce combat pour être reconnu, pour affirmer son identité singulière, pour gagner ou conforter les droits civiques de ses frères.
 La force de Minoungou, en dépit de l’humour et de la légèreté qu’il sait garder, c’est encore de se montrer, selon la théorie d’Antonin Artaud, acteur qui brûle les planches comme un sacrifié son bûcher, au service de ce « théâtre qui nous réveille : nerfs et cœur ». Ne déclare-t-il pas : « Je ne joue pas, je saigne, j’enseigne, je fais saigner », unissant dans un même mouvement et le ring et la scène ? Car de son propre aveu, par ce texte Dieudonné Niangouna entend aussi nous dire que pour être homme de théâtre en son pays, il lui faut lutter et vaincre bien des adversités.
La force de Minoungou, en dépit de l’humour et de la légèreté qu’il sait garder, c’est encore de se montrer, selon la théorie d’Antonin Artaud, acteur qui brûle les planches comme un sacrifié son bûcher, au service de ce « théâtre qui nous réveille : nerfs et cœur ». Ne déclare-t-il pas : « Je ne joue pas, je saigne, j’enseigne, je fais saigner », unissant dans un même mouvement et le ring et la scène ? Car de son propre aveu, par ce texte Dieudonné Niangouna entend aussi nous dire que pour être homme de théâtre en son pays, il lui faut lutter et vaincre bien des adversités.
Le sport transcendé, le sport comme arme, ring de Niangouna aujourd’hui, pelouse de Gérard Gelas autrefois, quand il fit, dans son Théâtre du Chêne Noir d’Avignon, interpréter son texte Ode à Canto — entendez au footballeur Éric Cantona —, et que son personnage au ballon « rebondissant sur l’actualité » déclarait en ces termes sa révolte : « Les bombardements reprennent. Un petit Comorien se fait brûler par les colleurs d’affiches de l’af-front national ». Canto The king, Mohamed Ali The Greatest !
— — —
« Ô vous frères humains », mis en scène à Avignon en 2014 au théâtre des Halles par Alain Timar, est l’adaptation du livre testamentaire de Albert Cohen, qui par ce titre en forme d’apostrophe déjà nous invitait à l’écoute et au partage. Une apostrophe qui éveille en nous quelque réminiscence poétique, convoquant le souvenir des jours anciens où l’on s’émut à la Ballade des Pendus, « épitaphe » écrite pour lui-même par ce coquin de Villon, éternel étudiant rebelle, et qui eût pu se voir en son temps voué au gibet. Même crudité, égale précision dans la description du corps, ici qui va mourir, là déjà mort, mais toujours destiné à devenir poussière d’os. Même désir de faire en sorte qu’ici le spectateur, là le lecteur, se sente concerné. Même appel à notre fraternité supposée. Chez l’un : « Car si pitié de nous pauvres avez… », chez l’autre « Ayez pitié de vos frères en la mort ».
 Du récit de ce traumatisme vécu par l’enfant juif méchamment agressé, à l’évocation des camps de concentration, le traumatisme ancien étant aussi nommé « camp miniature… camp de l’âme seulement », le texte d’Albert Cohen nous met face à notre cruauté, face au versant noir de notre humanité comme au dérisoire de nos ambitions terrestres. Plus que ces moments où la diction et la position du corps jouent à l’enfant, je retiendrai la puissance de cette voix lancée vers nous pour égrener en crescendo la sombre litanie des armes inventées par l’homme, la raillerie de cette autre qui fustige le masculin comme le féminin en des portraits sans concession de « singes savants ». De la scénographie, je retiendrai ces deux pans tapissés qui s’ouvrent et se referment en pages de livre géant. Ces intermèdes où, sans paroles, sur une musique, de foire, de cirque ou d’orphéon municipal, qui se voulant allègre ne réussit qu’à être grinçante, sans paroles les trois acteurs, qui démultiplient un narrateur en recherche d’identité, exécutent en valse lente de drôles de pas, automates dansants, sautillants ou agités de gestes saccadés, comme parfois marionnettes dont on tirerait les fils. Du texte me reviendra ce leitmotiv, qui incite non pas au pardon naïf mais à une sorte de réconciliation ultime, puisque tous sommes guettés par la même échéance, et que « ne pas haïr importe plus que l’illusoire amour du prochain ». Ou encore cette affirmation qu’il ne sert à rien de faire à l’église ses dévotions, hypocrites si au sortir du lieu saint on reprend son fardeau d’antisémitisme, ou plus encore de haine envers l’étranger, quel qu’il soit : « Ah ! Comme ils aiment peu et comme ils se contentent de peu, les aimants du prochain ! ».
Du récit de ce traumatisme vécu par l’enfant juif méchamment agressé, à l’évocation des camps de concentration, le traumatisme ancien étant aussi nommé « camp miniature… camp de l’âme seulement », le texte d’Albert Cohen nous met face à notre cruauté, face au versant noir de notre humanité comme au dérisoire de nos ambitions terrestres. Plus que ces moments où la diction et la position du corps jouent à l’enfant, je retiendrai la puissance de cette voix lancée vers nous pour égrener en crescendo la sombre litanie des armes inventées par l’homme, la raillerie de cette autre qui fustige le masculin comme le féminin en des portraits sans concession de « singes savants ». De la scénographie, je retiendrai ces deux pans tapissés qui s’ouvrent et se referment en pages de livre géant. Ces intermèdes où, sans paroles, sur une musique, de foire, de cirque ou d’orphéon municipal, qui se voulant allègre ne réussit qu’à être grinçante, sans paroles les trois acteurs, qui démultiplient un narrateur en recherche d’identité, exécutent en valse lente de drôles de pas, automates dansants, sautillants ou agités de gestes saccadés, comme parfois marionnettes dont on tirerait les fils. Du texte me reviendra ce leitmotiv, qui incite non pas au pardon naïf mais à une sorte de réconciliation ultime, puisque tous sommes guettés par la même échéance, et que « ne pas haïr importe plus que l’illusoire amour du prochain ». Ou encore cette affirmation qu’il ne sert à rien de faire à l’église ses dévotions, hypocrites si au sortir du lieu saint on reprend son fardeau d’antisémitisme, ou plus encore de haine envers l’étranger, quel qu’il soit : « Ah ! Comme ils aiment peu et comme ils se contentent de peu, les aimants du prochain ! ».
Ne conviendrait-il pas de conclure par deux voix, celle de Romain Gary qui, dans un tout autre contexte — le roman Clair de Femme, paru en 1977 — écrivait : « Je ne te demande pas de m’aimer ; je te parle de fraternité, je te demande d’être à mes côtés dans la profanation du malheur. Il n’est pas de plus haute célébration humaine». Et bien sûr celle d’Albert Cohen : « Si ce livre pouvait changer un seul “haïsseur”, mon frère en la mort, je n’aurais pas écrit en vain ».
D’un cas particulier étendre le propos jusqu’à l’universalisme, tel est bien le pont qui m’a permis de lier l’une à l’autre ces deux représentations, utiles et salutaires en ces temps du plus grand péril !.
PS : Notons qu’à Paris, au mahJ (Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme) se tient et se tiendra jusqu’en mai une très belle exposition des dessins de Luz qui, profondément marqué par la tuerie perpétrée sur ses amis et collègues au siège de Charlie Hebdo, a publié une adaptation en bande dessinée du livre d’Albert Cohen, en forme de catharsis, et pour stigmatiser la haine, selon lui responsable aussi des attentats.
Janine Bailly, Fort-de-France, le 23 avril 2017
