— Par Mireille Bandou Kermarrec —
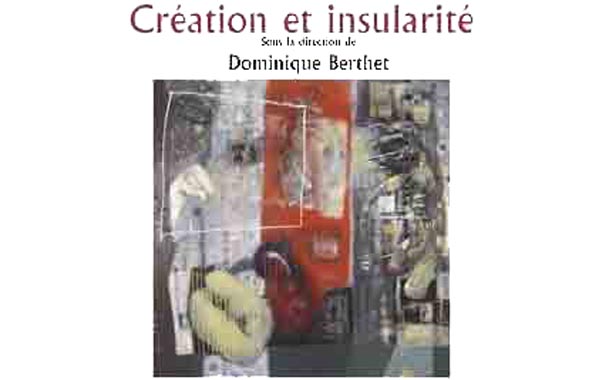 L’ouvrage « Création et insularité » est la restitution du colloque qui s’est tenu en Guadeloupe en novembre 2014 sur le thème « Créations insulaires ». Notons que « créations insulaires » est au pluriel. Un titre qui a fait réagir de nombreux artistes, le qualificatif insulaire indexant leurs créations dans une catégorie à part de l’art contemporain. Le titre « Création et insularité », retenu pour ce volume, est au singulier. La liaison « et » qui n’est pas anodine, ouvrirait une réflexion plus large sur la corrélation entre les deux termes. Le terme création englobant différentes disciplines artistiques et diverses formes d’art, notamment les formes d’art développées dans la Caraïbe. Insularité renvoyant à l’île, lieu où l’artiste est censé vivre et créer.
L’ouvrage « Création et insularité » est la restitution du colloque qui s’est tenu en Guadeloupe en novembre 2014 sur le thème « Créations insulaires ». Notons que « créations insulaires » est au pluriel. Un titre qui a fait réagir de nombreux artistes, le qualificatif insulaire indexant leurs créations dans une catégorie à part de l’art contemporain. Le titre « Création et insularité », retenu pour ce volume, est au singulier. La liaison « et » qui n’est pas anodine, ouvrirait une réflexion plus large sur la corrélation entre les deux termes. Le terme création englobant différentes disciplines artistiques et diverses formes d’art, notamment les formes d’art développées dans la Caraïbe. Insularité renvoyant à l’île, lieu où l’artiste est censé vivre et créer.
Mais de quelle île s’agit-il ? L’île géographique, définie par ses paysages, ses contraintes, ses limites, l’île déserte ou habitée ? L’île paradisiaque et fantasmée des dépliants touristiques ? Ou bien, les îles imaginaires du cinéma et de la littérature ?
L’artiste aurait-il une façon de penser et de créer qui serait différente selon qu’il habiterait sur une île ou sur un continent ? Y aurait-il alors un déterminisme du lieu ?
L’artiste est immanquablement influencé par le lieu de vie, les paysages, l’histoire, l’identité, la politique, l’environnement culturel. Mais, si l’œuvre de l’artiste insulaire porte l’empreinte de son insularité ne porte-t-elle pas également celle de sa présence au monde ? Comment l’artiste insulaire questionne-t-il alors dans son œuvre son rapport au monde ? Voilà quelques-uns des questionnements qui sont posés dans ce livre.
La notion d’insularité concerne une pluralité d’îles. S’il est question dans cet ouvrage de la Martinique, de la Guadeloupe ou d’autres îles de la Caraïbe, il est aussi question de la Corse, des Comores, de l’île de la Cité à Paris et même des îles mythiques et oniriques de la littérature et du cinéma. Toutes ces îles où, tel le Crusoé de Patrick Chamoiseau, les artistes ont laissé et laissent encore leur empreinte. C’est donc une approche très large de l’insularité avec, comme le souligne Dominique Berthet dans l’Avant-propos, « différentes notions qui traversent ces textes comme l’utopie, la créolisation, la mondialisation, le mythe, le fantasme, le voyage, la relation au lieu et à l’autre, l’isolement ou au contraire le lien » (p. 11-12).
L’ouvrage est construit en deux parties : 1- « L’île entre fantasmes, clichés et réalité » et 2- « Arts et insularité »
La première partie, « L’île entre fantasmes, clichés et réalité », regroupe huit textes des auteurs suivants : Marc Jimenez, « L’écart des îles » ; Dominique Chateau, « “Robinson finit par avoir fait son île” : sur quelques représentations (audio)visuelles du fantasme insulaire » ; Hélène Sirven, « Esthétiques insulaires d’îles en archipels (II) » ; Lise Brossard, « Mythopoièse de l’insularité » ; Valérie Arrault, « Place vendôme, une île parisienne » ; Sophie Ravion d’Ingianni, « La carte comme l’enjeu d’une altérité insulaire » ; Bruno Péquignot, « Peindre à l’île. Réflexions sociologiques sur la notion de création insulaire » ; Scarlett Jésus, « Réflexions à propos d’un musée d’art en Guadeloupe ».
Ces huit textes sont des réflexions théoriques, philosophiques, sociologiques, sur la notion complexe de l’insularité. Par une approche d’œuvres visuelles et littéraires, ces auteurs analysent la représentation que l’on a des îles depuis les siècles derniers jusqu’à aujourd’hui. Vision onirique, fantasmée, politique, culturelle, jusqu’à celle des îles prises dans les tourments du changement climatique et de la mondialisation. Des considérations qui conditionnent sans doute le regard porté sur les créations des artistes insulaires.
Sans minimiser les différentes analyses menées sur le sujet dans cette première partie, j’ai retenu seulement quelques réflexions tirées des textes de Marc Jimenez, Dominique Chateau, Bruno Péquignot et Scarlett Jésus.
Marc Jimenez et Dominique Chateau parlent « d’écarts ». Dans « L’écart des îles », Marc Jimenez écrit « L’écart qui faisait d’une île une île est en train de rétrécir » (p. 18). Il établit des différences entre insularité, insularisme et îléité. L’insularité serait une notion essentiellement topographique, géographique, qui outre l’île pourrait aussi désigner un ghetto ou tout lieu isolé. C’est bien l’idée développée aussi par Valérie Arrault dans son texte, « Place vendôme, une île parisienne ». L’insularisme serait politique, revendicatif. L’îléité serait le seul concept faisant de l’île, tantôt un havre de paix, tantôt un îlot de résistance à l’expansionnisme continental. La mondialisation menaçant l’existence même de l’insularité, de l’îléité et donc de la création.
Dominique Chateau s’intéresse « aux écarts que le fantasme creuse entre la réalité insulaire multiple et complexe, et toutes sortes d’idéologies de l’île représentées dans les productions culturelles […]. Le fantasme de l’île représente idéologiquement, dit-il, l’envers de ce qu’est l’île réelle […] » (p. 19). Il développe son propos sur la proxémique, c’est-à-dire les « interactions de l’être humain avec l’espace qui constitue son environnement habituel ou occasionnel […]. La proxémique de l’île concerne l’interaction de son espace propre avec le corps, le regard ; c’est, par exemple, la perception corporelle des limites du lieu-île […] » (p. 30).
Bruno Péquignot, emprunte un jeu de mots « Peindre à l’île » au journal Libération à propos d’un article sur une rétrospective de la peinture cubaine à Montréal en 2008.
Il s’intéresse à cette métaphore pour ce qu’elle dit sur la création artistique et les conditions matérielles, voire idéologiques, propres aux îles de la Caraïbe. Si on peut “peindre à l’île”, comme on peint à l’huile ou à l’eau, c’est aussi qu’on peut peindre, comme le disent certains artistes, « avec le cœur, avec les tripes, avec la mémoire, avec la souffrance du groupe ou du peuple auxquels ils appartiennent » (p. 93). Les conditions matérielles déterminant le plus souvent les choix esthétiques faits par l’artiste. La réflexion porte aussi sur la politique culturelle dans nos îles, sur le marché de l’art et la représentativité, quasi inexistante, de l’artiste insulaire sur ce marché de l’art mondial.
Scarlett Jésus, développe une réflexion sur la nécessité d’un musée d’art en Guadeloupe. Idée de musée autant décriée que désirée par les artistes. Elle évoque, le musée Edgard Clerc au Moule, limité à l’archéologie amérindienne, les anciens musées Schœlcher et St John Perse à Pointe-à-Pitre, lourdement impactés par le poids colonial, mais ayant fait l’impasse sur l’histoire de l’esclavage et celle des arts et traditions en Guadeloupe. Cependant la manifestation « Carte blanche », instaurée par l’ancien conservateur du musée Schœlcher, ouvrait un dialogue entre les œuvres des artistes d’ici aujourd’hui et les collections du passé, venues d’ailleurs, présentes dans ce musée. Scarlett Jésus s’interroge aussi sur le devenir du Mémorial ACTe. Les plasticiens trouveront-ils un véritable espace d’exposition de leurs créations ou le monument se cantonnera-t-il dans un rôle uniquement commémoratif ? Le récent Musée des Beaux-Arts de Saint-François n’est pas mentionné, puisqu’il n’a ouvert ses portes qu’en 2017. Le texte interroge « la fonction, sociale et politique, que remplit le musée et l’art en général » (p. 114). Mais musée des « Beaux-arts » ou musée « d’art contemporain », la question se pose sur la forme la mieux adaptée aujourd’hui à l’émergence d’une identité caribéenne.
La deuxième partie : « Arts et insularité » regroupe les textes suivants : Richard Conte : « Le ravissement d’être abeille. Une extase aux Comores » ; Dominique Berthet : « Michel Rovelas, une approche de l’insularité » ; Jocelyn Akwaba-Matignon : « Les chercheurs de l’existence » ; Richard-Viktor Sainsily Cayol : « Territoires insulaires, terroirs subversifs ? » ; Léna Blou : « La création insulaire, un art elliptique » ; Sentier : « Singularité et insularité ».
Mis à part le texte de Dominique Berthet sur la peinture de Michel Rovelas, les autres textes sont des témoignages de cinq artistes, dont trois sont des Guadeloupéens qui vivent et travaillent en Guadeloupe. Comment ces artistes interrogent-ils dans leur démarche leur insularité et leur présence au monde ?
Rendre compte du témoignage d’un artiste sur son propre travail est un exercice délicat. Trop en dire ou pas assez dénature toujours un peu leurs écrits. Surtout quand certains de ces textes sont un cri, voire même un cri viscéral.
Je pense en premier lieu au texte de la chorégraphe, Léna Blou, « La création insulaire, un art elliptique », qui résonne comme un cri et un plaidoyer fort. La chorégraphe s’interroge « sur les méandres et le cœur même de l’acte de création lorsque l’on vit et habite sur une île » (p. 187). Parler de « création insulaire » l’interpelle et la dérange. Y aurait-il des artistes insulaires et des artistes continentaux, demande-t-elle ? Peut-on au XXIe siècle, à l’heure de la mondialisation et de la globalisation approcher les êtres selon qu’ils sont îliens ou continentaux ? « Il est temps de rompre cette absurdité de la pensée occidentale où l’esthétique du beau ne peut provenir des petits territoires ; […] il est temps de reconnaître que même si ces espaces sont petits, ils font partie du monde et peuvent participer activement à l’évolution et au progrès de la pensée » (p. 196). Des interrogations sans équivoque sur la représentation et la place du travail de l’artiste insulaire dans l’art contemporain mondial.
Ensuite, il y a le texte de Richard-Viktor Sainsily Cayol qui s’intitule « Territoires insulaires, terroirs subversifs ? ». Ce témoignage est un cri fort de dénonciation des clichés négatifs véhiculés sur l’Afrique. Clichés qui pendant longtemps ont tenu certains artistes éloignés de l’Afrique et dans une méconnaissance quasi totale de ce qui s’y faisait en art contemporain. Richard-Viktor Sainsily parle de sa rencontre émouvante et viscérale avec la terre d’Afrique et de l’influence de cette rencontre sur son identité propre, son parcours artistique et son exigeant travail de création. Un parcours jalonné par des expositions à la Biennale de Dakar, en République dominicaine, à la Fondation Clément en Martinique. Un travail qu’il qualifie d’engagement dans le dépassement de soi. « Mon insularité, écrit-il, prend tout son sens […]. L’engagement se dope de valeurs verticales spécifiques, propres au lieu, à l’histoire et à l’actualité […]. L’insularité, outre les forces vitales de l’histoire qui la charge, ne serait-elle pas favorable à la constitution d’un terroir subversif ? » (p. 185). Un témoignage, à l’égal de celui de la chorégraphe Léna Blou, qui revendique la pleine place de l’artiste insulaire dans le concert du monde.
Jocelyn Akwaba Matignon fait le chemin inverse pour sa quête d’identité. Il s’éloignera très tôt de son insularité pour parcourir l’Afrique, la France et ensuite se réinstaller dans son île. Non pas pour s’enfermer, mais pour continuer sa démarche identitaire. Jocelyn Akwaba se définit comme un « chercheur de l’existence, un marcheur de l’inconnu » (p. 153). Après avoir travaillé sur l’esprit de la terre dans les forêts de France, puis sur la notion du masque au Burkina Faso, il s’intéresse à la troisième partie de son identité : la pensée caraïbe, amérindienne et Maya. Il étudie la symbolique de la roue de médecine amérindienne et la cosmogonie maya. Son texte fait le catalogue détaillé de la cosmogonie et de tous les symboles mayas qui figurent dans ses toiles. L’artiste est un sage qui par sa réflexion se veut bien présent au monde.
Le dernier texte que j’ai retenu pour cette note de lecture est celui de Dominique Berthet sur le travail de Michel Rovelas : « Michel Rovelas, une approche de l’insularité ».
Comment rendre compte en quelques mots de la vaste analyse que fait Dominique Berthet du travail de Michel Rovelas, pionner de l’art et figure incontournable de l’art contemporain en Guadeloupe. Quels aspects faut-il en souligner ?
Je retiendrai les notions de mythologie, de mémoire et de fragmentation qui parcourent l’œuvre de Michel Rovelas et dont il est question dans le texte. Dominique Berthet appuie son propos sur les toiles de l’exposition présentée en 2013 à l’Archipel à Basse-Terre : Mythologies créoles : les anciens toujours existants et bien vivants. Des peintures, écrit-il, qui « s’inscrivent dans une histoire et un espace spécifiques […]. Elles sont des traces. Elles répondent au manque d’images concernant une mémoire jugée absente ou dévoyée » (p. 140). Les notions de mythologie et de mémoire sont largement évoquées dans ce texte. Dominique Berthet souligne que Michel Rovelas mène une réflexion constante sur l’art et sur sa création artistique. Qu’il s’entoure régulièrement d’amis pour débattre, entre autres, de l’avancée de son travail, mais aussi de la société guadeloupéenne dans laquelle perdure un rapport dominant-dominé qu’il a toujours dénoncé. Ce rapport dominant-dominé qui a conduit à l’acculturation et à l’assimilation n’a pas permis de se constituer une mémoire. Comment alors recréer cette mémoire effacée ? Comment un peuple peut-il exister sans mythe fondateur ? Michel Rovelas regrette que le mythe soit inexistant dans la société créole et il n’aura de cesse de décrier ce qu’il nomme une « mythologie de l’illusion », car « au fil des générations ont été enseignées, la copie, l’obéissance, et non la création » (p. 144). L’artiste va s’attacher à combler ce manque en réinventant par son art une mythologie caribéenne fondée sur la souffrance et la violence qui ont présidé à la naissance de la société créole. Le Minotaure prendra une place importante dans son œuvre. Et comme une société violente engendre la violence, il fera du Minotaure « une figure double, l’autre et soi, le dominant et le dominé, le bourreau et la victime » (p. 146). La troisième notion est celle de fragmentation. Les peintures de Rovelas, souligne Dominique Berthet, interrogent le cadrage, le corps et le fragment. « Les fragments de corps, de motifs ou d’espaces se combinent […] entre assemblage et rupture, entre dialogue et isolement » (p. 149). Ces peintures évoquent un monde en dislocation dont parle souvent l’artiste. Et c’est là que la notion de fragmentation rejoint la notion d’insularité. Le fragment, précise Dominique Berthet, « est une métaphore de l’île », il peut aussi être envisagé « comme une métaphore du monde créole » (p. 151) à l’image du morcellement géologique de l’arc antillais. Et de conclure son texte par une métaphore, « ces corps peints fragmentés ou entiers peuvent être aussi considérés comme des îles » (p. 151). Une idée qu’il emprunte, dit-il, à la romancière mauricienne Shenaz Patel, qu’il cite « tout être est une île, ceint par l’omniprésente barrière de corail de ses doutes, ses contradictions, ses certitudes, cerné par l’horizon, désiré autant que craint, des autres » (p. 151). L’idée de l’individu-île, dit Dominique Berthet, renvoie à notre condition et à notre solitude.
Je voudrais terminer la présentation de ces actes du colloque de 2014 par les mots de la chorégraphe, Léna Blou : « La thématique de la création insulaire me révèle l’insularité de l’autre […], toute création semble intrinsèquement procéder de l’insularité […], une insularité dans l’insularité universelle de la création » (p. 196-197).
Mireille Bandou Kermarrec
Septembre 2021
