— Par Janine Bailly —
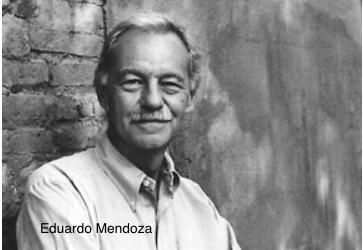 L’Association pour la Promotion de l’Hispanisme en Martinique nous invitait, ce mercredi 25 mars, sur le campus de Schœlcher, à découvrir la place occupée par la Guerre Civile d’Espagne (1936-1939) dans les arts : littérature et peinture. En cette semaine consacrée aux interventions sur l’île d’Edwy Plenel, il ne fut pas facile de se réserver une plage de temps libre pour répondre à l’invitation, mais ce qui nous fut offert valait largement l’effort consenti !
L’Association pour la Promotion de l’Hispanisme en Martinique nous invitait, ce mercredi 25 mars, sur le campus de Schœlcher, à découvrir la place occupée par la Guerre Civile d’Espagne (1936-1939) dans les arts : littérature et peinture. En cette semaine consacrée aux interventions sur l’île d’Edwy Plenel, il ne fut pas facile de se réserver une plage de temps libre pour répondre à l’invitation, mais ce qui nous fut offert valait largement l’effort consenti !
Tout d’abord, la communication de Solange Bussy, intitulée « Traitement de la mémoire de la guerre civile dans la fiction romanesque », et s’appuyant sur deux œuvres éloignées dans le temps, « Primera memoria, Première mémoire » de Ana Maria Matute (1959) et « El Año del diluvio, L’Année du Déluge » de Eduardo Mendoza (1992), nous montra comment la violence mortifère et paroxystique de cette guerre a nourri, et continue à nourrir l’imagination des romanciers. Pour rendre compte de ce déchaînement de violence, pour montrer la permanence de la division fratricide de l’Espagne après la guerre, le mythe biblique d’Abel et Caïn est convoqué. À cette permanence, Mendoza ajoutera celle de l’inégalité et de l’injustice sociale.
Si ces romans résonnent des échos de la guerre, qu’en est-il de la jeune génération ? À cette question venue du public, il sera répondu que la jeune génération espagnole pose le problème de la répression franquiste et de la réparation, car la nation ne peut pas bien se porter si elle ne connaît pas les vraies raisons de ce conflit, si elle reste hantée par ses fantômes.
L’analyse savante, la lecture en espagnol d’extraits significatifs puis leur généreuse traduction en français permettent bien d’appréhender les deux romans, mais il faut reconnaître que la communication est un peu difficile à suivre pour qui n’ a pas de ces auteurs une connaissance préalable.
Vint ensuite l’intervention de Dominique Berthet, « Picasso et la guerre », communication illustrée, après quelques malheureux déboires techniques que l’on sut prendre avec humour, par des reproductions d’œuvres souvent célèbres comme par d’autres moins connues. Il nous fut dit comment Picasso est indissociable de l’histoire de son siècle, comment il fut fidèle au Parti Communiste Français, depuis son adhésion en septembre 1944 jusqu’à sa disparition, et ce malgré ce que l’on pourrait nommer des amours houleuses ! Ainsi, la toile Guernica fut-elle jugée par les Staliniens comme « œuvre de provocation, inutile », voire néfaste au prolétariat !  Elle fut même incomprise par les Républicains espagnols, auxquels elle s’adressait. Picasso y exprime son émotion en noir et blanc, il garde, pour rendre compte de l’événement, son propre mode de représentation qui n’est pas de l’ordre de la peinture illustrative. Il s’agit bien d’une œuvre d’histoire, mais éloignée du spectaculaire et de l’anecdotique.
Elle fut même incomprise par les Républicains espagnols, auxquels elle s’adressait. Picasso y exprime son émotion en noir et blanc, il garde, pour rendre compte de l’événement, son propre mode de représentation qui n’est pas de l’ordre de la peinture illustrative. Il s’agit bien d’une œuvre d’histoire, mais éloignée du spectaculaire et de l’anecdotique.
Dominique Berthet axe son discours sur l’idée que Picasso a en quelque sorte déchaîné les passions, chaque exposition soulevant foule d’admirateurs et de détracteurs au nombre desquels on a compté certains étudiants des Beaux-Arts : on lui reprochait la destruction des valeurs traditionnelles, on allait jusqu’à l’accuser de supercherie ! « Le Charnier », hommage aux millions de disparus de la Seconde Guerre Mondiale, œuvre engagée mais sans recours au réalisme, fut qualifiée d’opportuniste, peu compréhensible et inachevée. La toile « Massacre en Corée », faite pour des raisons humanitaires, fut mal accueillie, boudée par des militants communistes déboussolés. Pourtant, s’il s’était refusé à produire un « tract pictural », l’engagement de Picasso n’en était pas moins présent, et ses détracteurs eux-mêmes savaient qu’il était utile.
À l’inverse, Picasso devint pour ses admirateurs, pour les intellectuels et les artistes, le symbole de la liberté retrouvée, de l’opposition aux fascismes, il tint le rôle de « militant-vedette ». Bien qu’il n’ait pas peint la guerre, il dira qu’il avait conscience d’avoir toujours, par sa peinture, agit en révolutionnaire. Comme il fut suggéré en ouverture, le titre plus exact de la conférence eût été « Picasso et les guerres ».
À l’intervention du poète Aragon, qui découvre, dans les cartons du peintre, la lithographie d’un oiseau qu’il baptise « colombe », et dont on fera le symbole du Mouvement de la Paix, Picasso reçoit un accueil chaleureux. Les forces progressistes en Europe s’engagent dans ce mouvement considérable, Picasso devenant alors « le peintre de la paix », et recevant en 1955, en partage avec Pablo Neruda, poète chilien, Nâzım Hikmet, poète turc et Paul Robeson, écrivain américain, le Prix International de la Paix .
Ainsi, l’homme engagé resta fidèle au Parti sans jamais se soumettre, fidèle à lui-même et à ses convictions, indépendant et sincère dans son insoumission comme dans son engagement. En ce qui concerne la conception que Picasso avait de son art, Dominique Berthet rappelle la célèbre phrase : « La peinture n’est pas faite pour décorer les appartements, c’est un instrument de guerre offensif et défensif contre l’ennemi ». Une belle anecdote nous est aussi contée : Hemingway, arrivé à Paris en 1945, laisse à la concierge un paquet-cadeau à remettre à Picasso, absent de son atelier des Grands-Augustins. Que contient cette caisse ? Des grenades, accompagnées de ce mot : « En hommage au grand dynamiteur de la peinture moderne… »
Petit clin d’œil final, les quelques photos facétieuses où l’on voit que Picasso savait aussi rire, faire rire et se divertir !
Comme il est dommage qu’une telle soirée, si riche d’enseignement et d’émotion, soit restée un peu trop confidentielle à mon goût !
