— par Roland Sabra —

Marie-Claude Pietragalla
Semaine 1
« Une Tentation d’Eve » qui s’éternise
Les ressources financières du CMAC-ATRIUM étant ce qu’elles sont il était difficile de programmer les authentiques ballets contemporains de la Compagnie Marie-Claude Pietragalla qui mobilisent de nombreux artistes. Heureusement la chorégraphe propose aussi des pièces intimistes au nombre desquelles on trouve « Ivresse » créée une première fois en 2001, reprise en 2005 avec en accompagnement musical le groupe de musique tsigane Arbat. « Ivresse » nous était donc proposé en première partie, sans orchestre certes mais avec une bande son.
La chorégraphe et son compagnon Julien Derouault, seul danseur en scène, ont un goût prononcé pour l’éclectisme artistique. Mêler danse et image d’animation ou arts martiaux ( Marco Polo), danse et cirque ( Sakountala) par exemple est un axe de travail qui caractérise l’intelligence créatrice de la Compagnie. On retrouve jusque dans la façon de danser ce souci d’explorer des rives étrangères. Julien Derouault en donne une illustration splendide avec un déhanché à la limite du déséquilibre qui fait irrésistiblement penser à des scènes de Bruce Lee. On est dans le tutoiement des genres qui semble se vouloir un théâtre du corps faisant la narration d’une tragédie de la chair en proie à la déchéance sous alcool dans « Ivresse » ou sous le flot du temps qui passe dans « La tentation d’Eve ». Autant la première partie est ramassée, courte et intense autant la seconde partie où la chorégraphe est seule en scène à paru longue, inégale et un peu décevante. Vouloir faire l’historique dansé de vingt siècles d’oppression féminine en en restituant les particularismes dans les codes sociaux historiquement datés de chaque époque est une gageure que ne relève pas tout à fait Marie-Claude Piertragalla. Des scènes sont longues, inutiles comme celle d’une reine version drag-queen, ou faussement émouvantes comme celle qui évoque la chanteuse Barbara. Paradoxalement une des plus belles scènes est celle de la marionnette créée par Johaha Hilaire. Paradoxe car Pietragalla ne danse pratiquement pendant cet épisode. Superflu aussi le moment devant la coiffeuse pour évoquer le vieillissement, de même celui de la cadre surmenée devant son ordinateur. Mais il y eu de vrais instants de magie quand par exemple avec un masque elle incarne successivement et magistralement une jeune femme, une femme âgée et la beauté féminine statufiée. D’une façon générale c’est quand elle se débarrasse des accessoires avec lesquels elle entre en scène et donc quand elle danse sans artifice que les moments sont les plus forts les plus intenses. Marie-Claude Pietragalla est une danseuse de caractère qui ne transige pas, qui ne fait pas de concession. Elle n’hésite pas à dénoncer le « maternalisme » en malmenant d’une façon décidée un baigneur en celluloïd mais elle évoque aussi avec une infinie émotion la naissance avec la marionnette précédemment évoquée. Pietragalla est une femme de combat qui n’élude pas les contradictions mais qui les affronte parce qu’elles sont pour elles le cœur même de la vie. Voilà ce qui rend attachant son travail au-delà d’indéniables qualités techniques.
Les lumières de Sylvie Lefray participent pleinement à la construction d’un espace scénographique d’une grande beauté. La deuxième partie était donc un peu longue, méritait d’être plus resserrée, ce qui aurait peut-être permis d’assister à plus de danse et c’est somme toute ce qui manquait.
« Instemps » d’ennui
La longueur et l’ennui, voilà les marques essentielles de « Instemps de vie » proposé par la Compagnie des Xastres ( quelle idée!). Les chorégraphes Jean-Félix Zaïre et Céline Le Corre ont tenté d’évoquer la notion de temps sans vraiment y parvenir. Entre boursoufflure et amateurisme le spectacle hésite, comme lors de long épisode pendant lequel les danseurs qui ne dansent pas, arpentent la scène en se croisant et se recroisant sans cesse, premier exercice de style que l’on apprend aux élèves de la section théâtre au lycée! On ne félicitera pas non plus Sylvie Lecomte, la costumière, qui n’a rien trouvé de mieux que de déguiser les danseuses avec des sortes de barboteuses bouffantes à la hauteur de hanches, de couleur rouge-ocre en première partie et blanche en seconde partie, qui enlaidissent les quatre femmes sur scène. Mais peut-être que les chorégraphes voulaient illustrer le balancier de l’horloge ( le temps qui passe…) en transformant ces danseuses en culbutos? Le summum du kitch est atteint lorsque descendent des cintres, une couronne de fleurs et deux flacons géants de goutte-à-goutte médical. Si vous ne comprenez pas le symbolisme de la chose on ne vous expliquera pas. Même Valéry Pétris, à la création des lumières et que l’on a connu plus inventif, a semblé s’ennuyer. Mais peut-être était-ce l’objectif recherché que de rappeler au spectateur que le temps pouvait sembler très long puisque c’était la thématique du propos.
Haïti qui danse
La veille Jean-René Delsoin d’ Haïti présentait « La nuit des tambours ». La première partie » Tambour-Passion », créée en 2007 est sans aucun doute la plus réussie, la plus vivante mais aussi la plus classique avec peu d’émotions mais une belle plastique et beaucoup de professionnalisme. « Trilogie, un rituel en l’honneur de ancêtres et des divinités » est un peu gâché par un détail technique : le papier collé sur la scène pour la protéger des projections de peintures se déchire sous les pas des danseurs et fait craindre la chute involontaire. « Men Rara » débute en fanfare et se termine en confusion. Mais qu’il était bon de voir Haïti danser!
Roland Sabra
Fort-de-France le 11/04/10
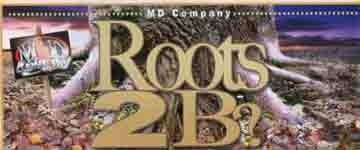
MD Company de Davide Molome
Semaine 2
Et vint ( enfin) la danse…
« Tribut » de Patrick Servius
Il y a des ralentis qui ennuient, il en est d’autres qui donnent le temps de s’installer dans un climat. Tribut du chorégraphe Patrick Servius est de cette dernière catégorie. Quatre femmes sur scène reliées par un fil rouge, au propre comme au figuré, attachées à leur identité sexuelle par ce lien qui les détermine, qui les assujettit et dont chacune aspire à se défaire dans un jeu d’élans à peine ébauchés vers d’autres identités multiples et tout aussitôt avortés. Mais il y a aussi l’amour, la sororité, la complicité, le bonheur du même, la joie du mi-dire immédiatement saisi, et tant d’autres choses qui échappent aux hommes et qui fascinent Servius. Il y a aussi ces voix étrangères et familières, qui chantent, qui tentent de se faire entendre, qui disent la douleur et qui rient, qui jouent de la cacophonie comme toujours reprises par la musique du groupe.
Il y a dans le travail de Servius une très belle occupation de l’espace balayé par une alternance de déplacements et d’immobilisation toujours signifiante. La lenteur du spectacle si elle a pu désorienter certains permet en réalité de s’installer dans la problématique développée sur le plateau. On pourra néanmoins regretter que Servius semble parfois confondre ralenti et absence de mouvement. Les corps sont somme toute peu sollicités. Du travail des danseuses on relèvera celui de Patricia Guannel, pour qui la chorégraphie a été écrite.
Le plus remarquable dans ce spectacle est de loin le travail des lumières, admirable en tout point. Bizarrement le nom du créateur n’apparait pas sur le prospectus, seul figure le nom du régisseur des lumières c’est à dire le nom de celui qui exécute la partition.
Roots 2 B? le sang neuf!
Soirée vivifiante avec cette troupe de Hip hop d’origine martiniquaise qui a démontré magistralement que cette forme de danse était tout à fait en mesure de construire un ballet. La variété des figures est époustouflante. Entrées en scène façon » « Moon walker », ralenti sur la pointe des pieds, « poppin », contractions brusques et successives des différentes parties du corps avec deux passages obligés, le tétris qui comme le jeu du même nom consiste a créer des figures à angle droit et le « robot » avec ses gestes saccadés, smurf, séries de vagues ondulantes de la tête aux pieds ou l’inverse etc. La soirée a montré que le hip-hop possédait une véritable grammaire des corps avec une syntaxe, des éléments signifiants, des morphèmes, si l’on peut dire, d’une très grande richesse. L’intelligence du chorégraphe David Milome, se manifeste principalement sur deux registres. Premièrement il respecte la règle de l’insertion de numéros individuels dans des morceaux collectifs conformément à l’esprit de la danse, ce qui permet à chacun de jouer à la fois collectif et « perso’. Deuxièmement il instaure une parfaite égalité hommes-femmes, tout au moins sur le plan numérique, dans un genre qui à l’origine n’ accordait que peu de place à » la moitié du ciel ». Issu de la rue, , le hip-hop transforme le négatif de la violence des bagarres et le mal-être existentiel et social en œuvre d’art. Alors que jusque là on pouvait sur l’ensemble de la Biennale avoir le sentiment d’un essoufflement, avec une certaine immobilité des corps, une raréfaction de la gestuelle, la troupe « MD Company » a fait la démonstration d’une vitalité, d’une capacité d’innovation et d’un sens du spectacle dont elle n’a en aucune façon à rougir face à ses ainés, qui pour le coup ont dû se sentir le poids des ans.
« Septet » de Merce Cunningham
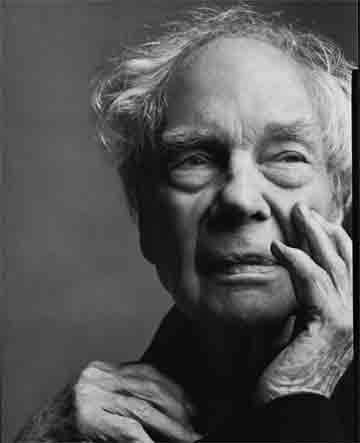 L’ouverture de la dernière semaine de la Biennale de Danse à Fort-de-France s’est faite en rendant hommage à Merce Cunningham, le chorégraphe américain décédé il y a moins d’un an à New York L’œuvre de Merce Cunningham est caractérisée par l’innovation, l’expérimentation, la spectacularisation et le refus du compromis. Il n’a cessé d’associer à son travail celui d’autres artistes ((le musicien et compositeur John Cage, le plasticien Bob Rauschenberg, le pianiste David Tudor, les peintres Elaine et Willem De Kooning…) tout en laissant une grande part de hasard dans les associations ainsi réalisées, de sorte que chaque œuvre se présente sous l’aspect d’un évènement unique. Son travail s’est aussi libéré de contraintes qu’elles soient narratives, expressives ou gestuelles. Le lien entre le mouvement du danseur et les autres danseurs ou même la musique est parfois dissocié. « Septet » présentée à Fort-de-France est une pièce des origines ( 1953) si elle ne contient pas toutes les audaces du chorégraphe elle en laisse deviner quelques unes. Le rapport de la danse à la musique ( Eric Satie) est encore conventionnel avec quelques échappées parfois déroutantes pour un public non averti quand par exemple la danse bouge contre la musique. La scène d’ouverture est figurée par trois danseuses en demi-pointes dans une posture très classique, tout aussitôt fracassée par un solo superbement rendu, suivent alors une série de duos, de quatuors qui conduisent à la formation d’une diagonale de couples célébrant des étreintes fugaces car aussitôt brisées. Une longue chaîne se forme et se trouve elle aussi bien vite rompue. Seul émerge un couple n’a plus qu’a se retirer, en marche arrière, comme à regret vers le hors scène.. La jeunesse des danseurs sied parfaitement à ce travail. Leur timidité, apparente, dans la façon de se serer la main, de se regarder par dessus l’épaule a une fonction apaisante elle même rehaussée par la couleur pastel des costumes. Eros joie et chagrin; telle semble être la trilogie incontournable et universelle qui nous gouverne, suggère Cunningham. Cette réalité ne se regarde pas de face. L’occupation de l’espace scénique implique un décentrement du regard. Un regard oblique.
L’ouverture de la dernière semaine de la Biennale de Danse à Fort-de-France s’est faite en rendant hommage à Merce Cunningham, le chorégraphe américain décédé il y a moins d’un an à New York L’œuvre de Merce Cunningham est caractérisée par l’innovation, l’expérimentation, la spectacularisation et le refus du compromis. Il n’a cessé d’associer à son travail celui d’autres artistes ((le musicien et compositeur John Cage, le plasticien Bob Rauschenberg, le pianiste David Tudor, les peintres Elaine et Willem De Kooning…) tout en laissant une grande part de hasard dans les associations ainsi réalisées, de sorte que chaque œuvre se présente sous l’aspect d’un évènement unique. Son travail s’est aussi libéré de contraintes qu’elles soient narratives, expressives ou gestuelles. Le lien entre le mouvement du danseur et les autres danseurs ou même la musique est parfois dissocié. « Septet » présentée à Fort-de-France est une pièce des origines ( 1953) si elle ne contient pas toutes les audaces du chorégraphe elle en laisse deviner quelques unes. Le rapport de la danse à la musique ( Eric Satie) est encore conventionnel avec quelques échappées parfois déroutantes pour un public non averti quand par exemple la danse bouge contre la musique. La scène d’ouverture est figurée par trois danseuses en demi-pointes dans une posture très classique, tout aussitôt fracassée par un solo superbement rendu, suivent alors une série de duos, de quatuors qui conduisent à la formation d’une diagonale de couples célébrant des étreintes fugaces car aussitôt brisées. Une longue chaîne se forme et se trouve elle aussi bien vite rompue. Seul émerge un couple n’a plus qu’a se retirer, en marche arrière, comme à regret vers le hors scène.. La jeunesse des danseurs sied parfaitement à ce travail. Leur timidité, apparente, dans la façon de se serer la main, de se regarder par dessus l’épaule a une fonction apaisante elle même rehaussée par la couleur pastel des costumes. Eros joie et chagrin; telle semble être la trilogie incontournable et universelle qui nous gouverne, suggère Cunningham. Cette réalité ne se regarde pas de face. L’occupation de l’espace scénique implique un décentrement du regard. Un regard oblique.
« Sunset Fratell » de Jean-Claude Gallotta

Le moment le plus émouvant de cette soirée réussie a été sans aucun doute le duo » Sunset Fratell » crée en 2006 par le chorégraphe d’origine grenobloise Jean-Claude Gallotta. Danseur et chorégraphe tardif, il découvre la danse classique à l’age de vingt ans après des études en arts plastiques. Un séjour étatsunien, auprès de Merce Cunningham, va lui permettre de forger son style.et de créer sa compagnie qu’il nomme curieusement Groupe Émile-Dubois en hommage au Facteur Cheval (1836-1924) ! L’argument de Sunset Fratell relève du tragique. Deux frères se rendent à l’aéroport en scooter pour y accueillir deux visiteuses africaines. La route va se terminer au kilomètre 23, dans un accident mortel. L’harmonie, l’entente, la complicité, la communion sont suggérée par des mouvements similaires des deux danseurs, avec ce style caractéristique fait de petits mouvements saccadés, de vacillements, de bras tendus, vers le vide vers le manque, vers l’autre qui se dérobent. La désorganisation maîtrisée des corps renvoie à la désorganisation des liens quand Eros, toujours lui, subvertit la relation et fait ressurgir l’irréductible, l’inaliénable individualité. Plus que les performances techniques Gallotta semble privilégier la singularité du danseur dans une œuvre exécutée à deux dans l’enfermement d’un cercle d’ombres et de lumières dessiné sur le sol. La lutte, l’affrontement, la rivalité ne laissent que des vaincus que la camarde enveloppe et engloutit dans sa nuit en fond de scène.
« L’entrouvert » de Christine Bastin
» D chaussées » de Mourad Merzouki

Ces deux pièces mobilisent la totalité de la troupe ou presque. Les effets spectaculaires sont donc assurés pour le plus grand bonheur de la salle. Et c’est vrai qu’elles sont plaisantes à voir. « L’entrouvert » est une dérive poétique dans un monde primitif où la vie émerge à grand peine dans des fluctuations semi aquatiques, semi aériennes d’éléments à la recherche de leur complémentarité, de leur jonction. Elan vital vers la survie qui ne sera réussie que pour un couple dans une scène d’union superbement rendue, les autres échouant. Déperdition d’énergie, de désirs dans une lutte ou ne survivent que les plus chanceux. L’esthétique est belle mais on a le temps de se le dire.

« D chaussées » a été créée par Mourad Merzouki pour le junior ballet du CNSMD (Conservatoire national supérieur de musique et de danse.) Mourad Merzouki est un chantre de l’éclectisme. Rien ne l’intéresse davantage que la confrontation de disciplines venues d’horizons différents. Sa formation l’atteste. il fréquente dés l’âge de sept ans une école de cirque près de Lyon, et parallèlement un cours de karaté et un autre de boxe. A l’âge de quinze ans il découvre le hip hop. Il a trouvé sa vocation. Son point de vue esthétique est traversé par cette formation hétérogène et décalée. On ne s’étonnera donc pas de retrouver une touche de distanciation, d’humour pour tout dire, dans son travail. Voilà ce qu’il dit de « D chaussées » « C’est un ballet sur le thème des pieds nus », dit Mourad. « Nous, gens du hip-hop, nous dansons toujours en baskets. Ainsi chaussés, les élèves du CNSMD s’avéraient maladroits. Je me suis donc mis au travail nus pieds et j’ai découvert cette partie du corps que je n’avais jusqu’ici jamais utilisée. » Beaucoup d’humour donc mais aussi de prouesses techniques et une grande inventivité comme ce découpage de la scène en deux lieux de pratiques étrangères qui finiront par se rencontrer. Comme le dira une spectatrice en sortant : « Ca fait du bien de voir un spectacle de qualité, drôle; bref qui ne soit pas pleurnichard« .
Une vie, Frida Kalho de Alfred Alerte
 Un minable spectacle de fin de kermesse dominicale et paroissiale. Alfred Alerte, enfant du pays, a tenté de relever le défi qui consiste à représenter la vie de Frida Kalho, brisée physiquement dans un accident de tramway. Elle restera handicapée et se consacrera à la peinture. Tout a mal commencé. on voit d’abord déambuler le long du rideau de fond de scène Alfred Alerte en personne, une fois, deux fois, trois fois, et même une quatrième fois. il marche sans esquisser le moindre pas de danse. on s’apercevra plus tard qu’il ne fallait pas le regretter. Aucune justification à cette longue tribulation de droite à gauche et de gauche à droite. Arrive Lucie Anceau, en Frida Kalho en bonne santé et en robe de mariée. Peut-être va-t-elle danser se dit-on? Et bien non ce sera pour plus tard, croit-on encore naïvement. Arrive l’accident dans un bruit de verre pilé, de tôles froissées, tout à fait improbables, mais se dit-on bonne pâte c’est symbolique, c’est dû aux contingences de la re-présentation d’un évènement forcément hors champ, et là Frida esquisse, esquisse est le mot juste car cela n’ira jamais plus loin, quelques pas et s’effondre longtemps après la tragédie.
Un minable spectacle de fin de kermesse dominicale et paroissiale. Alfred Alerte, enfant du pays, a tenté de relever le défi qui consiste à représenter la vie de Frida Kalho, brisée physiquement dans un accident de tramway. Elle restera handicapée et se consacrera à la peinture. Tout a mal commencé. on voit d’abord déambuler le long du rideau de fond de scène Alfred Alerte en personne, une fois, deux fois, trois fois, et même une quatrième fois. il marche sans esquisser le moindre pas de danse. on s’apercevra plus tard qu’il ne fallait pas le regretter. Aucune justification à cette longue tribulation de droite à gauche et de gauche à droite. Arrive Lucie Anceau, en Frida Kalho en bonne santé et en robe de mariée. Peut-être va-t-elle danser se dit-on? Et bien non ce sera pour plus tard, croit-on encore naïvement. Arrive l’accident dans un bruit de verre pilé, de tôles froissées, tout à fait improbables, mais se dit-on bonne pâte c’est symbolique, c’est dû aux contingences de la re-présentation d’un évènement forcément hors champ, et là Frida esquisse, esquisse est le mot juste car cela n’ira jamais plus loin, quelques pas et s’effondre longtemps après la tragédie.
Survient alors Alfred Alerte en Diego Rivera le mari de Frida, il tente de relever le corps désarticulé de Frida. Cruauté de la mémoire : tout d’un coup reviennent à l’esprit les performances des jeunes danseurs du CNSMD et celles de la troupe de David Milome qui en matière de désarticulation en savent un bout. Le pire est à venir quand Alerte et Anceau entament « La cumparsita » un tango argentin d’ Astor Piazzola. Rappelons tout de même que Frida était mexicaine. Bon ce n’est qu’un détail, après tout peut-être aimait-elle le tango? Alfred Alerte raide comme un piquet, aussi souple qu’un verre de lampe exécute, on peut l’écrire, un simulacre de danse sans aucune sensualité, sans conviction, avec une Frida estropiée, forcément estropiée qu’il finit par laisser tomber; avant de poursuivre seul sur un air traditionnel La Yumba, rythme originellement à deux temps (Yum/Ba)qui servait à donner la mesure. Ou peut-être était-ce La Yumba qui était jouée en premier. On ne sait plus car on s’est caché la tête pour ne pas voir ça. On se disait que le club de tango du quartier de Bellevue avec ses amateurs et ses amoureux de cette superbe danse danse faisait mille fois mieux. Les danseurs, c’est un abus de langage de les désigner ainsi, auraient pu prendre quelques cours de tango acrobatique, ne serait -ce que pour éventuellement s’abstenir de singer cet art après en avoir découvert toutes les difficultés. Pour les subtilités de cette compétence ce n’était pas le lieu où les évoquer.
Frida finit par se mettre à la peinture et on la voit ravagée par la douleur faire semblant de réaliser un tableau avec un pinceau de peintre du bâtiment à la main. Arrivé à ce stade on n’est plus à ce genre de détail. Arrive alors le clou grandguignolesque de la soirée. Clin d’œil aux fêtes des morts mexicaines de novembre arrive alors Alfred Alerte revêtu du collant noir sur lequel est dessiné un squelette. Pour qui n’aurait pas compris il s’agit le la camarde, qui rôde autour de Frida et qui finit par l’emporter. Ouf!
Ce soir là le public a touché le fond. La gageure bien sûr était de représenter une handicapée motrice sur un plateau de danse. Si Frida avait été tétraplégique, Alerte la posait sur un grabat et le tour était joué. On a presque regretté qu’il n’en ait été pas ainsi. Il faut quand même remarquer que rien n’obligeait Alfred Alerte à représenter la vie de Frida Kalho. Personne ne lui a mis un révolver sur la tempe. En choisissant de mettre en avant la structure narrative du récit, au risque de réduire la danse à une illustration sans grâce, il a évacué tout ce qu’il pouvait y avoir d’allégorique dans cette vie de luttes contre les injustices du destin, injustices qu’elle a combattues aussi sur le terrain social et politique en étant militante communiste. Quid de cette dimension dans l’enflure présentée par Alfred Alerte?. Ce spectacle grossier, prétentieux, boursoufflé et ennuyeux au possible, dont on se demande comment il a pu être subventionné, n’a pas fait honneur à la Martinique.
Fenêtre sur mon bigidi et moi de Lénablou
 La chorégraphe guadeloupéenne Lénablou a inventé une technique corporelle de danse à partir du Gwo’ Ka basée sur une déclinaison corporelle du temps et du contretemps. Aux sept rythmes du Gwo’Ka ( le Woulè, le Padjembèl, le Kaladja, le Toumblak, le Graj, le Léwòz etc.) doivent correspondre sept types de danses. Au trois façons traditionnelles de prendre appui au sol avec les pieds, à plat, demi-pointes et pointes elle ajoute et développe l’appui sur les talons, l’en-dehors et l’en-dedans du pied. Le passage ente ces nouveaux types d’appui se fait très rapidement de manière saccadée. C’est la partie inférieure du corps qui est la plus sollicitée, le haut en position ouverte ou fermée est mobilisé en contretemps, ce qu’on appelle « le bigidi ». Le danseur mis en difficulté doit avoir recours à l’improvisation à certains moments. Ce style fait aujourd’hui école et des danseurs venus d’horizons culturels différents (Europe, Japon, Etats-Unis…) s’approprient sans états d’âme le Techni’ka en bons « techniciens du corps » qu’ils sont.
La chorégraphe guadeloupéenne Lénablou a inventé une technique corporelle de danse à partir du Gwo’ Ka basée sur une déclinaison corporelle du temps et du contretemps. Aux sept rythmes du Gwo’Ka ( le Woulè, le Padjembèl, le Kaladja, le Toumblak, le Graj, le Léwòz etc.) doivent correspondre sept types de danses. Au trois façons traditionnelles de prendre appui au sol avec les pieds, à plat, demi-pointes et pointes elle ajoute et développe l’appui sur les talons, l’en-dehors et l’en-dedans du pied. Le passage ente ces nouveaux types d’appui se fait très rapidement de manière saccadée. C’est la partie inférieure du corps qui est la plus sollicitée, le haut en position ouverte ou fermée est mobilisé en contretemps, ce qu’on appelle « le bigidi ». Le danseur mis en difficulté doit avoir recours à l’improvisation à certains moments. Ce style fait aujourd’hui école et des danseurs venus d’horizons culturels différents (Europe, Japon, Etats-Unis…) s’approprient sans états d’âme le Techni’ka en bons « techniciens du corps » qu’ils sont.
Le travail présenté, dans le cadre de la Biennale de Fort-de-France est une création de 2008 et il était interprété, comme à l’origine, par la danseuse Stella Moutou. Il n’est pas sûr que l’argument, rapports conflictuels et néanmoins complémentaires entre insularité et continentalité, enfermement et ouverture du corps qu’il soit individuel ou social, ait été restitué avec une grande limpidité. Le côté répétitif de la prestation transpire dans le parcours d’un chemin de lumière carré de couleur froide dessiné sur le sol qui nous présente la danseuse de dos de coté, de face et puis de nouveau de coté. Même gestuelle présentée sous différents angles de vue. L’issue, si issue il y a sera représentée au sol par un cercle de lumière chaude au bord duquel elle dansera longtemps avant que n’apparaisse en clôture une porte de nouveau de couleur froide vers un ailleurs en fond de scène. Chaud, froid, chaud, contretemps, temps, contretemps. Le travail est intéressant en ce qu’il permet de faire valoir un type de danse original, ancré dans une culture autre que la culture « occidentale » et qu’il fait découvrir des techniques corporelles qui bousculent notre façon de voir. Mais il y avait quelques longueurs.
En ouverture de la soirée « Yonndé » de la même chorégraphe met en scène deux danseurs dans une pièce brève ( 10 mn) et qui déclinera les thèmes de l’Un et du Deux. Quand le dualisme se décline en bipolarité… Deux danseurs inégaux mais plaisants à voir danser.
Conclusion subjective
Une biennale marquée du sceau de la diversité tant sur le plan des cultures que sur celui de la qualité. il y eut du très bon et du très mauvais. Il y eut aussi des longueurs, trois semaines peut-être est-ce un peu long? Peut-être faudrait ramener la durée à deux semaines? Les livrets qui accompagnaient les représentations ont semblé un peu courts, peu explicatifs, peu pédagogiques pour un public non initié aux subtilités de la chorégraphie en général. ils empruntaient trop souvent au style elliptique voire ésotérique quand ils ne versaient pas dans la grandiloquence. Certaines écoles, certains styles auraient pu faire l’objet d’une présentation plus détaillée.
Cela étant dit, il faut relever que Manuel Césaire est en passe de réussir sur le terrain de la danse ce qu’il échoue à réaliser dans le domaine du théâtre. Il était plaisant de voir dans la salle des chorégraphes de diverses compagnies assister au travail de leurs confrères et consœurs. La ligne programmatrice du CMAC-ATRIUM est, on le sait, une ligne de confrontation entre cultures, d’ici et d’ailleurs, dans un perpétuel dialogue en dehors de tout rapport de domination. C’est dans ces allées-venues entre l’en-dedans et l’en-dehors, dans un travail réciproque d’acculturation. Milome, Lénablou, Guannel, parmi d’autres, ont montré qu’un travail d’appropriation et d’invention, enraciné dans la culture caribéenne était tout à fait possible. Un peu comme la Biguine qui n’aurait jamais été sans l’appropriation par les musiciens martiniquais des instruments venus d’Europe. C’est sans doute cette écoute réciproque entre artistes chorégraphiques venus d’horizons différents qui nourrit une veine créatrice pleine de promesse. Qu’il n’en soit pas ainsi dans le domaine du théâtre tient plus aux egos démesurés que l’on y rencontre qu’à un manque de volonté de la direction du CMAC-Atrium ou des autres et trop rares instances de programmation. Peut-être faudrait-il imposer aux metteurs en scènes antillais leur présence à toutes les soirées des festivals auxquels ils postulent comme condition sine qua non de leur participation?
Roland Sabra, Fort-de-France le 27/04/10
