—Par Selim Lander —

Dans le OFF : « Un théâtre sans parole, vous dites, mais c’est du mime, alors ? » Eh bien non, aujourd’hui, c’est devenu beaucoup plus compliqué que cela. Il est vrai que les grands mimes de jadis savaient, et que certains clowns d’aujourd’hui savent encore raconter des histoires merveilleuses avec des mimiques, des gestes, et rien d’autre. Mais de nos jours le théâtre sans parole tend à s’étoffer – au sens premier, il y a beaucoup d’« étoffe », beaucoup de costumes à enfiler successivement, et plus généralement au sens où le spectacle réclame de nombreux accessoires machines, jouets (c’est pourquoi on parle également d’un théâtre d’objets).
La compagnie « Dos à deux » est co-dirigée par André Curti et Artur Ribeiro (qui font également partie des interprètes, ici au nombre de quatre). Leur dernier spectacle, Frères de sang, raconte la vie de trois frères, trois triplés et celle de leur mère chérie, avec laquelle, semble-t-il, ils ont toujours vécu. Evidemment, ce n’est pas raconté dans le bon ordre. Sauf que la mère meurt bien à la fin. L’histoire est toute simple, ce qui s’impose quand on est privé des mots, mais ce qui n’empêche nullement de faire passer beaucoup de choses, la rivalité entre les frères pour gagner la première place dans le cœur de la mère, la mort prématuré de l’un deux, qui était le souffre-douleur, la joie, la peine.
Ce qui fait tout l’intérêt d’une telle histoire simple c’est bien sûr la manière de la raconter. Au début la lumière tombe sur deux garçons ; ils sont debout sur un plateau qui se met à tourner ; progressivement ils se rapprochent, avant de se précipiter dans les bras l’un de l’autre. Cette image reviendra à la fin : c’est celle des deux frères, les seuls survivants après la mort du troisième frère puis celle de la mère. Entretemps, nous aurons découvert les accessoires et appris qu’il n’y a pas de plateau mais une simple planche sur un socle central que l’on peut faire tourner ou faire monter d’un côté puis de l’autre comme une balançoire. Pas de moteur, c’est le troisième comédien, le troisième frère, caché dans l’ombre qui, en l’occurrence, imprimait à la planche son mouvement de rotation. Deux de ces appareils sont sur la scène. Au début, sur le second, se trouve allongé le cadavre du frère mort (en fait une poupée grandeur nature), auquel on fera sa toilette avant de l’habiller pour la sépulture. La mère, déjà âgée à ce moment-là, est figurée elle aussi par une poupée grandeur nature, femme tronc qui semble sortir du ventre de la jeune femme – quatrième et dernière comédienne de la troupe – dont seul le visage masqué apparaît en retrait, ses bras se confondant avec ceux de la poupée. Tout au début, elle est dissimulée dans une sorte de placard, derrière une penderie remplie de vêtements qui lui serviront par la suite, lorsqu’elle reprendra forme humaine.
On ne fera pas la liste ici des innombrables accessoires ni de tous les tableaux qui composent le spectacle. Un seulement : bébés et petits garçons. Profitant d’une sortie de leur mère, les trois frères jouent à leur naissance. L’un deux, qui a revêtu une robe de la mère, se retrouve subitement (sans que nous ayons compris comment, la lumière privilégiant ce que l’on entend nous montrer) avec, accrochés à sa ceinture, trois boudins sur lesquels sont dessinés des bébés. Il est occupé à mimer l’accouchement, c’est-à-dire qu’il est en train de se débarrasser des boudins, lorsque la mère revient. Confusion : les trois frères se dépêchent de faire disparaître les images des bébés, lesquelles sont en fait des housses d’oreiller, des oreillers dont ils s’emparent avant de filer se coucher. On n’aperçoit plus que les sommets des cranes posés sur les trois oreillers, bien alignés sur une balançoire maintenant horizontale et parallèle au public. Les enfants dorment, ou font semblant, quand leur maman vient donner le dernier baiser de bonne nuit. Juste après vient un moment de grâce singulier : la bataille de polochons ! Une lumière bleutée s’allume dans chaque oreiller et, dans le noir où la scène se trouve plongée, c’est un ballet aérien, fantasmagorique qui soudain se développe…
La force de Frères de sang tient à plusieurs facteurs, l’imagination, le rythme, la modestie qui se voit par exemple à la simplicité des accessoires (certes nombreux) mais aussi au comportement des comédiens qui ne donnent jamais l’impression de vouloir se donner en spectacle, comme s’ils ne jouaient pas, comme s’ils habitaient en toute simplicité leur petit univers factice, de balançoires, de chaise roulante, de poupées de chiens qui gémissent ou aboient, etc. Notons encore, pour finir, que la musique et la lumière ont également leur part dans le succès de ces Frères de sang (muets).
Cette année, le IN met en lumière deux « artistes invités ». À côté de Stanislas Nordey, un Congolais : Dieudonné Niangouna. Par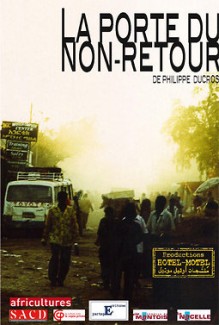 l’intermédiaire de ce dernier la thématique africaine se trouve donc fortement présente. Nous avons déjà parlé d’Exhibit B, cette remarquable suite de tableaux vivants abritée à l’église des Célestins. À l’École d’art, on peut voir La Porte du non-retour, une exposition de photos assez exceptionnelle du Québécois Philippe Ducros. Des photos principalement prises au Congo (RDC), des photos volées et quelques photos posées, de la couleur grand format, avec un vrai travail sur le cadrage et la profondeur de champ. Bref du bon travail de photo-reportage qui pourrait se suffire à lui-même, combinant scènes pittoresques et beaux portraits. Mais il ne faut pas se méprendre sur le sens des mots. Le pittoresque est celui de la misère quotidienne, le beau celui qui transparaît à travers la condition humaine la plus cruelle. Tout cela apparaît d’emblée, pourtant Philippe Ducros n’a pas eu tort de renforcer son propos par un texte enregistré, dont il est l’auteur, qu’il fait dire par un comédien et une comédienne. Chaque visiteur est donc muni d’un audio-guide et peut choisir d’ajouter à la visite le commentaire de tel ou tel groupe de photos. Le texte est bien écrit, bien dit, prenant. Philippe Ducros a déjà effectué plusieurs voyages vers des destinations comme celles-ci : mégalopole poussiéreuse et misérable (Kinshasa), camp de réfugiés somaliens ; Il dit – et on a envie de le croire sincère – la tentation du « non-retour ». Découvrant Kinshasa, la foule qui déferle des bidonvilles pour gagner les quelques sous indispensables à la subsistance quotidienne, les camions-taxis où s’entassent des travailleurs épuisés, les nuages de fumée toxique, les étals chargés d’une si maigre marchandise, l’hôtel borgne qui apparaît malgré tout comme un refuge au milieu de cette apocalypse, il s’écrit – ce ne sont pas exactement ses mots – « c’est ça vivre » ! Pour une bonne moitié de l’humanité, c’est cela, en effet, un combat incessant pour simplement survivre. Mais là encore, il ne faut pas se méprendre : cette survie n’est pas dénuée de fierté, on la montre en arborant le boubou dans le tissu à la mode, une perruque, ou une belle chemise. Dans la précarité, dans la survie, l’humanité résiste. Elle résiste encore dans les coins les plus disgraciés de la planète, les camps ou s’entassent les réfugiés par milliers. Il faut écouter le témoignage (dit par la comédienne) de cette femme violée par un groupe armée, alors qu’elle s’était un peu éloignée du camp pour ramasser du bois de chauffe. C’est poignant et d’une dignité admirable. Alors oui, on veut bien croire Philippe Ducros quand il avoue sa culpabilité à l’idée de retourner dans le monde si facile, ou si factice, si artificiel en tout cas, qui est le nôtre.
l’intermédiaire de ce dernier la thématique africaine se trouve donc fortement présente. Nous avons déjà parlé d’Exhibit B, cette remarquable suite de tableaux vivants abritée à l’église des Célestins. À l’École d’art, on peut voir La Porte du non-retour, une exposition de photos assez exceptionnelle du Québécois Philippe Ducros. Des photos principalement prises au Congo (RDC), des photos volées et quelques photos posées, de la couleur grand format, avec un vrai travail sur le cadrage et la profondeur de champ. Bref du bon travail de photo-reportage qui pourrait se suffire à lui-même, combinant scènes pittoresques et beaux portraits. Mais il ne faut pas se méprendre sur le sens des mots. Le pittoresque est celui de la misère quotidienne, le beau celui qui transparaît à travers la condition humaine la plus cruelle. Tout cela apparaît d’emblée, pourtant Philippe Ducros n’a pas eu tort de renforcer son propos par un texte enregistré, dont il est l’auteur, qu’il fait dire par un comédien et une comédienne. Chaque visiteur est donc muni d’un audio-guide et peut choisir d’ajouter à la visite le commentaire de tel ou tel groupe de photos. Le texte est bien écrit, bien dit, prenant. Philippe Ducros a déjà effectué plusieurs voyages vers des destinations comme celles-ci : mégalopole poussiéreuse et misérable (Kinshasa), camp de réfugiés somaliens ; Il dit – et on a envie de le croire sincère – la tentation du « non-retour ». Découvrant Kinshasa, la foule qui déferle des bidonvilles pour gagner les quelques sous indispensables à la subsistance quotidienne, les camions-taxis où s’entassent des travailleurs épuisés, les nuages de fumée toxique, les étals chargés d’une si maigre marchandise, l’hôtel borgne qui apparaît malgré tout comme un refuge au milieu de cette apocalypse, il s’écrit – ce ne sont pas exactement ses mots – « c’est ça vivre » ! Pour une bonne moitié de l’humanité, c’est cela, en effet, un combat incessant pour simplement survivre. Mais là encore, il ne faut pas se méprendre : cette survie n’est pas dénuée de fierté, on la montre en arborant le boubou dans le tissu à la mode, une perruque, ou une belle chemise. Dans la précarité, dans la survie, l’humanité résiste. Elle résiste encore dans les coins les plus disgraciés de la planète, les camps ou s’entassent les réfugiés par milliers. Il faut écouter le témoignage (dit par la comédienne) de cette femme violée par un groupe armée, alors qu’elle s’était un peu éloignée du camp pour ramasser du bois de chauffe. C’est poignant et d’une dignité admirable. Alors oui, on veut bien croire Philippe Ducros quand il avoue sa culpabilité à l’idée de retourner dans le monde si facile, ou si factice, si artificiel en tout cas, qui est le nôtre.
