— Par Alexis Buisson —
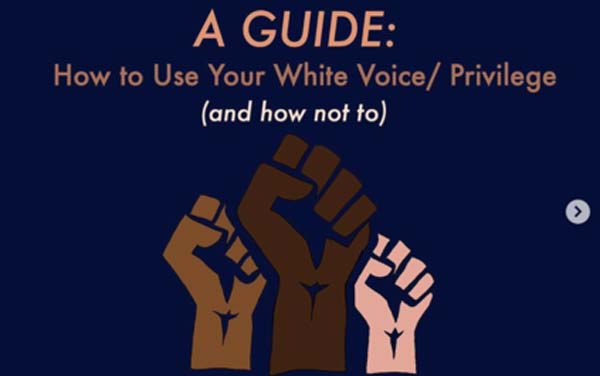 Dans la presse ou sur les réseaux sociaux, la communauté noire appelle les Blancs à utiliser leur position privilégiée dans la société pour l’aider à lutter contre le racisme systémique.
Dans la presse ou sur les réseaux sociaux, la communauté noire appelle les Blancs à utiliser leur position privilégiée dans la société pour l’aider à lutter contre le racisme systémique.
ew York (États-Unis), correspondance.– Sur les réseaux sociaux et les pancartes de manifestants, dans la presse locale et nationale… Depuis la mort de George Floyd, un homme noir tué par un policier blanc qui s’est agenouillé sur son cou à Minneapolis, lundi 25 mai, impossible d’échapper au terme « white privilege » (« privilège blanc »). C’est le fait que les Blancs, grâce à la couleur de leur peau, bénéficient d’avantages que les minorités raciales n’ont pas, aux États-Unis et ailleurs.
En ce moment, les manifestants noirs emploient l’expression pour exhorter leurs « alliés » blancs à utiliser leur position dans la société pour enrayer le racisme systémique qui sévit outre-Atlantique. « Dénoncez le racisme quand vous le voyez », « Écoutez les Noirs sans leur dire comment ils doivent mener leur combat ou faire leur deuil », « Ayez des conversations difficiles avec vos proches sur vos préjugés », peut-on lire pêle-mêle sur Instagram.
Les Blancs, eux, en parlent dans des vidéos et des messages sous les hashtags #whiteprivilege ou #whiteprivilegeisreal. « Le silence des Blancs est un consentement », écrit une jeune Instagrameuse vêtue d’un tee-shirt avec plusieurs noms d’Afro-Américains tués par la police. « Je suis blanche et j’ai bénéficié de la couleur de ma peau toute ma vie », lance une autre. Certains, comme les acteurs Blake Lively et Ryan Reynolds, ne cachent pas une certaine culpabilité. « Nous n’avons jamais dû nous inquiéter de la loi ou de ce qui pouvait se passer si nous étions arrêtés par la police », avouent-ils dans un post le 2 juin. Nous avons honte de nous être autorisés à être aussi non informés sur le racisme systémique. »
Le concept s’est d’abord développé dans les cercles académiques dans les années 1980. Peggy McIntosh, professeure d’études féministes à l’université Wellesley, l’a popularisé en publiant en 1988 une liste de 46 manifestations de ce privilège blanc – « Je peux allumer la télévision ou ouvrir le journal et voir ma race largement représentée », « Je peux parler la bouche pleine sans qu’on l’explique par ma couleur de peau » ou encore « Si je suis arrêté par la police ou que le fisc contrôle mes déclarations d’impôt, je peux être sûr que ce n’est pas à cause de ma race… »
Décrié par la droite américaine, le concept a accouché de corollaires comme « white guilt » ou « white shame », ce sentiment de culpabilité et de honte qu’éprouvent les Blancs qui s’estiment responsables du racisme ambiant. Robin DiAngelo, une spécialiste du privilège blanc, a écrit, elle, sur la « white fragility » (la fragilité blanche) pour désigner l’inconfort ressenti par les Blancs dans les discussions raciales. Un phénomène accentué par « l’insularité raciale » des Blancs américains, surtout quand ils vivent en milieu rural ou dans les suburbs (banlieues résidentielles).
« Même si l’insularité des Blancs varie en fonction de la classe sociale – les pauvres et les classes laborieuses sont généralement moins isolés sur le plan racial – ils restent globalement protégés en tant que groupe par l’environnement social, les institutions, les représentations culturelles, les médias, les manuels scolaires, les films, la publicité et les discours dominants, écrit-elle dans un article paru dans la revue International Journal of Critical Pedagogy. Pour beaucoup de personnes blanches, les cours obligatoires d’éducation multiculturelle ou les formations de “compétence culturelle” requises dans le monde de l’entreprise, sont les seuls moments ou leur vision des questions raciales est mise au défi de manière directe et soutenue. »
L’irruption du mouvement Black Lives Matter en 2014, dans le sillage de plusieurs cas de violence policière contre des Noirs, a poussé de nombreux Blancs, surtout des démocrates, jeunes et diplômés, à s’interroger sur les inégalités raciales dans le pays. Citant divers sondages et enquêtes d’opinion, le site d’analyse FiveThirtyEight explique que la part des démocrates blancs qui estiment que « le pays doit faire plus pour assurer l’égalité des droits des Noirs avec les Blancs » a bondi de 50 à 80 % entre 2008 et 2017. Ces démocrates se montrent également de plus en plus favorables au concept de « réparations », forme de dédommagement accordé aux descendants d’esclave, thème brièvement abordé lors de la primaire du parti démocrate.
Par ailleurs, les Blancs de gauche reconnaissent plus que leurs homologues républicains que les Noirs font face à des discriminations dans l’accès au vote et le traitement par la police.
Le concept s’est d’abord développé dans les cercles académiques dans les années 1980. Peggy McIntosh, professeure d’études féministes à l’université Wellesley, l’a popularisé en publiant en 1988 une liste de 46 manifestations de ce privilège blanc – « Je peux allumer la télévision ou ouvrir le journal et voir ma race largement représentée », « Je peux parler la bouche pleine sans qu’on l’explique par ma couleur de peau » ou encore « Si je suis arrêté par la police ou que le fisc contrôle mes déclarations d’impôt, je peux être sûr que ce n’est pas à cause de ma race… »
Décrié par la droite américaine, le concept a accouché de corollaires comme « white guilt » ou « white shame », ce sentiment de culpabilité et de honte qu’éprouvent les Blancs qui s’estiment responsables du racisme ambiant. Robin DiAngelo, une spécialiste du privilège blanc, a écrit, elle, sur la « white fragility » (la fragilité blanche) pour désigner l’inconfort ressenti par les Blancs dans les discussions raciales. Un phénomène accentué par « l’insularité raciale » des Blancs américains, surtout quand ils vivent en milieu rural ou dans les suburbs (banlieues résidentielles).
« Même si l’insularité des Blancs varie en fonction de la classe sociale – les pauvres et les classes laborieuses sont généralement moins isolés sur le plan racial – ils restent globalement protégés en tant que groupe par l’environnement social, les institutions, les représentations culturelles, les médias, les manuels scolaires, les films, la publicité et les discours dominants, écrit-elle dans un article paru dans la revue International Journal of Critical Pedagogy. Pour beaucoup de personnes blanches, les cours obligatoires d’éducation multiculturelle ou les formations de “compétence culturelle” requises dans le monde de l’entreprise, sont les seuls moments ou leur vision des questions raciales est mise au défi de manière directe et soutenue. »
L’irruption du mouvement Black Lives Matter en 2014, dans le sillage de plusieurs cas de violence policière contre des Noirs, a poussé de nombreux Blancs, surtout des démocrates, jeunes et diplômés, à s’interroger sur les inégalités raciales dans le pays. Citant divers sondages et enquêtes d’opinion, le site d’analyse FiveThirtyEight explique que la part des démocrates blancs qui estiment que « le pays doit faire plus pour assurer l’égalité des droits des Noirs avec les Blancs » a bondi de 50 à 80 % entre 2008 et 2017. Ces démocrates se montrent également de plus en plus favorables au concept de « réparations », forme de dédommagement accordé aux descendants d’esclave, thème brièvement abordé lors de la primaire du parti démocrate.
Par ailleurs, les Blancs de gauche reconnaissent plus que leurs homologues républicains que les Noirs font face à des discriminations dans l’accès au vote et le traitement par la police.
Quand la mort de George Floyd est devenue publique, à travers une vidéo insoutenable d’une dizaine de minutes montrant son interpellation et son étouffement, Joanne Shea, une New-Yorkaise blanche quadragénaire, n’a pas réfléchi à deux fois pour descendre dans la rue. Cette mère ne veut pas de ce monde-là pour sa fille de 12 ans. « Les Blancs doivent être actifs dans ce combat. Nous devons reconnaître que nous nous promenons tous les jours avec notre privilège, souligne cette native du New Hampshire, un État à majorité blanche de la côte Est des États-Unis, rencontrée dans une manifestation. En tant que parent blanc, notre rôle est d’enseigner ce privilège à nos enfants, raconter l’oppression dont ont été victimes les Noirs depuis des générations. Rester silencieux, c’est participer à cette situation. »
SURJ (Showing up for Racial Justice), un groupe de justice raciale présent notamment à Minneapolis, a organisé fin mai une visioconférence pour ces « white folks » (« les gens blancs ») qui veulent s’engager. Le rendez-vous a rapidement atteint la limite des 1 000 inscriptions. Hayden Mora, un des intervenants, a appelé l’auditoire virtuel à se mobiliser pour mettre la pression sur les « maires complaisants » envers les officiers de police violents et exiger le « désinvestissement » dans les départements de police au profit de programmes sociaux. Aux États-Unis, ce sont les municipalités et les États fédérés qui allouent l’essentiel des financements aux 18 000 polices locales.
« Les électeurs blancs ont un poids politique disproportionné à cause du découpage actuel des circonscriptions qui est fait pour rabaisser les minorités. Si 2 % d’électeurs blancs en plus s’étaient mobilisés en Géorgie, Stacey Abrams serait gouverneure de cet État », dit-il, en faisant référence à la démocrate noire qui s’est présentée en 2018 et a été battue d’une courte tête par son adversaire républicain au terme d’un scrutin contesté. Possible colistière de Joe Biden en 2020, elle a depuis lancé un groupe, Fair Fight, destiné à lutter contre la « suppression d’électeurs », procédé qui consiste à adopter des restrictions électorales pour empêcher certains groupes de voter, y compris les Afro-Américains.
Il n’y a pas que les sièges de maire et de gouverneur qui sont dans la ligne de mire de SURJ : le groupe vise aussi les postes liés à la justice, comme les shérifs et les procureurs (District Attorney) qui sont élus aux États-Unis. « Les personnes au pouvoir restent en place à cause du silence des Blancs, explique Carla Wallace, une autre intervenante. Le mouvement des droits civiques dans les années 1960 nous avait déjà demandé de nous mobiliser. »
Soixante ans plus tard, l’histoire se répète. À New York et ailleurs dans le pays, les Blancs participent en nombre important aux défilés organisés par les groupes antiracistes. « Nous avons besoin des Blancs, explique Anthony Ortiz, un New-Yorkais d’origine portoricaine de 23 ans, qui participait à une manifestation dimanche. Les Blancs n’ont pas les mêmes limitations économiques, financières et politiques que nous. »
Source : Mediapart
