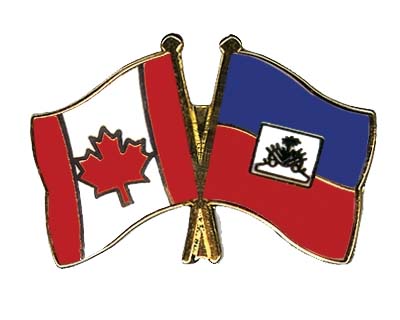 Saint-Domingue et Nouvelle-France
Saint-Domingue et Nouvelle-France
ARCHÉOLOGIE DES RELATIONS CANADA-HAÏTI1
— Par Lyonel Icart —
Nouvelle-France et Saint-Domingue, ainsi se nommaient les deux possessions françaises que l’on appelle aujourd’hui Québec et Haïti. Les historiens canadiens qui se sont penchés sur l’histoire de la Nouvelle-France ont développé leurs études dans une optique nationaliste, souvent québécoise, en cantonnant cette histoire à l’intérieur des frontières actuelles, nous dit Jacques Mathieu2. Quant à l’historiographie haïtienne, elle ne s’est jamais préoccupée des relations entre Saint-Domingue et la Nouvelle-France. La forte immigration haïtienne au Québec, aujourd’hui, invite à regarder cette présence dans une optique plus large. On a souvent fait remonter cette présence aux années 1960; mais si cette immigration a commencé à cette date, les contacts entre ces deux pays sont plus anciens que cela, et bien avant le vingtième siècle les relations étaient régulières et constantes.
1. Le commerce triangulaire
La Nouvelle-France ne se limitait pas à la vallée du Saint-Laurent. Le premier empire colonial français, qui a disparu en 17633, s’étirait sur un espace gigantesque. Du golfe du Saint-Laurent au golfe du Mexique, des Appalaches aux montagnes rocheuses, il comprenait aussi la Louisiane. Dernière colonie française fondée en Amérique du Nord, celle-ci «devait combler le vide stratégique qui séparait les possessions insulaires françaises des Antilles (Saint-Domingue, Martinique et Guadeloupe) des colonies occidentales du Nord (Canada et Acadie)4». Dans le contexte de l’époque, il était impossible que ces deux entités n’eussent pas de relations entre elles. Mais la politique de l’Empire reposait sur l’exploitation des colonies à son profit en mettant en place des mesures qui ne favorisaient pas leur développement intrinsèque. La Nouvelle France était un réservoir à fourrures et les Antilles un réservoir à sucre. Toute l’activité économique des colonies était tournée vers la métropole et elles ne devaient pas avoir de relations entre elles car les besoins des colonies étaient comblés par la métropole qui en tirait des matières premières et y exportait des produits manufacturés et des vivres. Immense atelier d’esclaves, la Martinique et Saint-Domingue, par exemple, ne produisaient pas les denrées nécessaires à la subsistance de leur population. Et il en était de même de la Nouvelle France, et particulièrement de la colonie laurentienne, tout au long du XVIIè siècle, dont le commerce de la fourrure représentait, jusqu’en 1740, 70% des exportations vers la métropole5. Deux règles dictaient la politique coloniale de l’Empire. La première stipulait que « toute colonie formée au dépent d’un Etat qui a Jugé a propos de l’Établir doit toujours estre dans la dépendance entière de cet Etat, et Il ne doit rien négliger pour l’y maintenir ». Et la deuxième tout aussi drastique établit que «tout ce qui sort d’une colonie doit aller directement dans le Royaume (et a l’inverse) une colonie ne doit rien recevoir qui ne luy soit porté et fourni par les Vaisseaux partis directement de France6». Mais les négociants et les armateurs savaient déceler les entraves d’un contrôle tatillon et trouver des failles dans le système pour faire pencher en leur faveur les décisions locales et trouver ainsi des solutions à la rentabilité de leur entreprise7. Cependant à partir de 1665, l’Intendant Jean Talon inaugura une nouvelle politique en direction des autres colonies françaises des Antilles. Ses ambitions étaient grandes pour le Canada duquel il voulait faire un Etat prospère, pourvoyeur du royaume en produits de toutes sortes. Il n’eut certes pas l’idée de ce commerce intercolonial avec les Antilles mais dès qu’il se l’appropria, à la suite de ses conversations avec le sieur Alexandre de Prouville de Tracy, il mit tout en œuvre pour sa réalisation. Son objectif était de suppléer aux défaillances de la métropole dans l’approvisionnement des Antilles. Il escomptait qu’en l’espace de deux années, l’augmentation de la production agricole canadienne permettrait d’alimenter régulièrement les Antilles et aider ainsi à leur subsistance. Les bateaux partaient du pays chargés de planches, de merrain, de poisson, de pois blancs et verts, d’huile de phoque, tous produits qui étaient débarqués aux Antilles en décembre. De là, ces mêmes navires sont chargés de sucre, de rhum, de coton et de tabac destinés aux marchés français. Le retour au Canada s’effectuait au début de l’été, alors que les bateaux rapportaient de France des tissus, des vins, des armes à feu et d’autres produits manufacturés. Même si les quantités transportées étaient modestes, le périple s’effectuait chaque année durant l’intendance de Talon8. Cependant il n’était possible d’effectuer qu’un seul voyage par année à cause de l’énorme distance à parcourir et des glaces qui paralysaient le fleuve Saint-Laurent pendant six mois. Cette courte saison de navigation rendait élevés les coûts de revient. Par la suite, avec le début de la guerre de Hollande, le désintéressement de la métropole pour les colonies nord-américaines et le départ de Talon mirent fin à cette première tentative de commerce intercolonial.
Ce n’est qu’au début du XVIIIè siècle que les conditions d’un tel commerce se trouveront réunies. L’effondrement du marché de la fourrure força la population canadienne à se tourner vers d’autres types de productions. Le travail de la terre et l’exploitation de la forêt offraient une plus grande sécurité. Entre-temps, la guerre de succession d’Espagne avait détourné la Couronne de ses colonies d’Amérique du Nord, occupée qu’elle était à régler ses problèmes en Europe. La régularité des relations avec les colonies s’en ressentait et leur approvisionnement en souffrait après les récoltes désastreuses que connut la France à la suite du terrible hiver de 1709. Mais en ce début de siècle, la Nouvelle France n’était qu’une série de petits établissements faiblement peuplés qui seraient restés isolés les uns des autres si ce n’était le commerce des fourrures qui les reliait économiquement par le réseau hydrographique. C’est grâce à l’activité maritime que les royaumes ont connu leur puissance et, principal moyen de communication, toutes les colonies en dépendaient pour leur développement économique. En Nouvelle France, sans l’incommodité des sauts et des chutes d’eau qui entrecoupent les cours du Saint-Laurent et celui de quantité de grosses rivières qui s’y jettent… il serait facile de passer de Québec au golfe du Mexique9.
Aux Antilles, si Saint-Domingue est facilement abordable, d’autres îles sont balayées par les vents et sujettes aux tempêtes. De toutes les îles, la Martinique est la plus sûre. Ses ports ont l’inestimable commodité d’offrir un asile protégé contre les ouragans qui désolent ces parages10. Par ailleurs, en 1712, la Martinique était la plus populeuse avec 33 000 habitants, dont 22 000 esclaves; deux fois plus peuplée que la Nouvelle France, et plus peuplée que Saint-Domingue qui comptait 17 000 esclaves pour une population totale de 22 000 habitants. La Martinique était le siège du gouvernement des îles françaises de la Caraïbe. Axée principalement sur la production sucrière, la production agricole des Antilles comprenait également le café, le cacao, l’indigo et le tabac qui s’ajoutaient à la canne à sucre. Par contre la culture des denrées alimentaires était insuffisante pour nourrir la population locale. Les colonies des îles de la mer des Caraïbes étaient fortement dépendantes de l’extérieur pour leur alimentation. En outre, les ouragans dévastateurs obligeaient aussi ces îles à importer du bois de construction et à renouveler leur cheptel.
Le Canada, entre Montréal, Québec et Trois-Rivières, était la colonie la plus peuplée de Nouvelle France avec environ 15 000 personnes. La Louisiane était à ses balbutiements avec à peine 200 habitants sur un territoire immense. La population de la région des Grands Lacs était marginale et instable11. L’île Royale, tout ce qui restait de l’Acadie après le traité d’Utrecht, était une terre impropre à l’agriculture mais protégeait l’accès au Saint-Laurent et le port de Louisbourg devint la plaque tournante du commerce aussi bien avec la métropole qu’entre les colonies. Les 10 000 colons de la vallée du Saint-Laurent qui vivaient de la terre dégageaient des surplus de production. Les produits de la pêche représentaient une autre denrée de subsistance abondante qui offrait des excédents. L’intérieur du continent était inexploré et les pinières et chênières fournissaient le bois de charpente et celui nécessaire à la construction des bateaux. Aussi, le marché pour ces surplus – bois, fourrures, poisson, blé, pois, légumes – se trouvait nécessairement à l’extérieur du pays à cause du faible peuplement de la colonie12.
De par le climat et la forme d’administration mise en place par la métropole, les productions respectives des colonies septentrionales et méridionales étaient différentes et complémentaires; et l’impossibilité pour la métropole d’assurer leur approvisionnement favorisa le développement d’un commerce intercolonial. Au cours de la première moitié du XVIIIè siècle, un florissant commerce se développa entre la Nouvelle France et les Antilles. Dès 1708, Pontchartrain y avait décelé le potentiel de ces relations commerciales et encourageait les canadiens à s’y investir. En 1709, l’intendant Raudot signalait qu’à l’avenir, le pays ne devrait regarder le commerce des fourrures que «comme un accessoire de son commerce13». Et dès ce moment, le circuit triangulaire France-Québec-Antilles-France était devenu régulier. Les armateurs métropolitains, plus fortunés et détenant le monopole du commerce de la fourrure, contrôlaient déjà le trafic intercontinental. Mais à ce grand triangle, il faut en ajouter un autre, à échelle plus réduite, qui reliait Québec, l’île royale et les Antilles14 et la Louisiane qui, n’ayant pas tout à fait réussi à surmonter les contraintes de son faible peuplement et de son isolement, avait développé des relations commerciales avec les Antilles15. En dehors de la saison de navigation qui se situait entre le 15 juillet et le 15 octobre, il fallait, d’un coté, redouter le gel du Saint-Laurent et, de l’autre, la saison des ouragans aux Antilles. Cette période avait l’avantage de correspondre à celle des récoltes tant en Nouvelle France qu’aux Antilles. L’autre avantage résidait dans l’utilisation de Louisbourg comme centre de transit, entrepôt et port de redistribution entre Québec et les Antilles. Les armateurs antillais n’avaient plus à craindre la navigation sur le Saint-Laurent et pour les négociants canadiens, le commerce entre Québec et Louisbourg était plus attractif sur le plan économique car il réclamait de plus petites embarcations et des équipages réduits, ce qui leur permettait de rentabiliser plus rapidement leurs investissements. Et enfin, cela permettait «aux marchands québécois et dominguois de faire deux voyages par an entre leur colonie et Louisbourg»16. Au départ de Québec ou de Saint-Pierre, les capitaines de navires avaient l’habitude d’indiquer Louisbourg comme destination, mais le cabotage sur le Saint-Laurent n’était, en réalité, qu’un prolongement du commerce entre la Nouvelle France et les Antilles17. En 1712, par exemple, le sieur Pascaud de Québec s’engagea à porter 112 quintaux de farines aux Antilles. Au Canada, les administrateurs ne tenaient pas de registres détaillés et se contentaient de descriptions générales qui satisfaisaient le ministère de la Marine. Mais, centré autour de la Martinique, ce commerce faisait là l’objet de descriptions très précises et minutieuses. Siège du gouvernement des Antilles, elle désignait souvent l’ensemble des îles françaises, tout comme le Canada signifiait, pour les antillais, Nouvelle France. Ainsi s’explique l’absence d’états détaillés pour Saint-Domingue et les autres îles, intégrés aux statistiques martiniquaises18. Et les bateaux qui naviguaient de la métropole à la Nouvelle-Orléans s’arrêtaient presque toujours dans un port des Antilles françaises, en général à Saint-Domingue19. Dans le cadre de l’administration mise en place par la métropole, ce commerce pouvait surprendre, mais la parcimonie des approvisionnements de la métropole obligeait les colonies à se pourvoir, à coûts moindres, en denrées alimentaires et autres auprès des voisins. Entre 1730 et 1740, les Antilles connurent un essor considérable, notamment Saint-Domingue dont la population servile passera de 17 00 à 500 000 en un demi siècle. La demande en articles produits en Nouvelle France attirait les négociants et marchands canadiens qui y décelaient des perspectives de profits. Ce commerce lucratif et intense est attesté même par les observateurs non spécialistes de l’époque. Ainsi Daflon notait qu’une «partie du commerce du Canada consiste dans les grains et les légumes… et dans les planches et les bois de charpente … il se charge tous les ans quantité de vaisseaux pour les isles françaises d’où ils rapportent en échange des sucres, des tabacs et autres semblables marchandises desquels les habitants ont besoin et qu’ils ne cultivent pas chez eux20». Contre de la morue, du bois, du charbon, du blé, des légumes, Saint-Domingue, la Martinique et la Guadeloupe envoyaient du sucre, des mêlasses, du rhum, du café, du tafia, du bois de gayac, de l’indigo, du cacao, du coton, du chocolat, des confitures, du sel, etc. Si les produits des îles étaient en demande et se vendaient bien en Nouvelle France, notamment le sucre, ceux de cette dernière étaient de première nécessité pour les Antilles, ce qui assurait un marché solide et fiable aux marchandises canadiennes. Les besoins des Antilles étaient si criants que «le roi dût permettre officiellement de déroger aux principes mercantilistes21» qui interdisaient aux colonies d’acheter en dehors de la métropole. Le marché des Antilles s’ouvrait pour le Canada, d’autant plus que ses prix étaient concurrentiels et d’autres produits ont pu ainsi y être écoulés : le charbon de terre, le chanvre, le goudron, l’étain et le fer se vendaient bien, ainsi que les bestiaux nécessaires au fonctionnement des moulins.
Dans ce contexte où les Antilles ne produisaient pas leurs denrées alimentaires ni ne fabriquaient les articles et équipements utiles à leurs industries, le Canada y trouvait un débouché assuré pour ses productions. Les négociants canadiens surent en tirer profit et firent jouer en leur faveur l’offre et la demande. Les armateurs européens, ces grands du commerce intercontinental, ont dû s’ajuster et ils en vinrent à participer à ce négoce en fonction de la complémentarité des produits entre les colonies et à ne plus concevoir la rentabilité selon le modèle mercantiliste qui favorisait la métropole. Ce commerce intercolonial était florissant en variétés et en quantités. «Ce qui subsiste des registres d’amirauté, de la correspondance de quelques commerçants, des procès épiques et surtout l’analyse des statistiques commerciales, permet d’évaluer l’importance de ce commerce22». Dominé par les ports de Louisbourg et des Antilles, ce commerce ne profitait pas de façon égale à toutes les colonies, mais ces échanges lui ont insufflé un dynamisme tel que le développement des colonies s’était écarté du modèle que la métropole avait voulu leur imposer. Ainsi, par exemple, Louisbourg redistribuait également les produits antillais en Nouvelle Angleterre, principalement à Boston. Et Raudot, très tôt, contre les politiques impériales, envisageait le développement de la contrebande avec les Anglais. A la veille de la guerre de sept ans, cet empire colonial français d’Amérique, qui allait bientôt s’effondrer, constituait une entité économique propre si bien qu’on a pu croire que ces colonies pouvaient «former un tout viable23».
Par ailleurs, dans le cadre de ces relations commerciales, il ne faut pas surestimer le rôle des autorités, mêmes locales, à développer ces échanges «au point que toute l’activité semble émaner du pouvoir public24». Le volume du commerce était considérable et les administrateurs, tant locaux que ceux du royaume, ne pouvaient manquer de percevoir les profits à en tirer. Et de fait, la circulation des biens et des marchandises a généré des profits énormes. Les liens étaient constants et cette activité commerciale a permis une diversification des bases économiques du Canada, orienté désormais autant vers la métropole que vers les colonies méridionales des îles. Malgré la réglementation procédurière mise en place par le royaume, ce commerce entre colonies était d’abord et avant tout une affaire d’hommes d’affaires, de marchands et de négociants à la recherche de débouchés et de profits. Les fraudes et la contrebande étaient monnaie courante pour contourner la législation pointilleuse. Sur le fleuve, les marchandises passaient d’un bateau à l’autre sans toucher terre, ou alors les capitaines indiquaient de fausses destinations25. Cette entreprise était le fruit des intérêts communs des négociants et marchands sur la base de la complémentarité des biens produits et disponibles dans les colonies, et où chaque partie trouvait son profit. Les gens circulaient entre les colonies et «à côté, avec ou contre les autorités, les paysans, les traiteurs de fourrures, les marchands, les planteurs, mais aussi les esclaves et les Amérindiens n’étaient pas de simples acteurs statiques et passifs; ils surent s’adapter, évoluer, tirer parti des opportunités offertes par les différentes situations coloniales et réagir aux sollicitations des marchés qui s’ouvraient à eux26». Ce commerce a initié les mouvements de population entre toutes les colonies. Et des destinées individuelles illustrent ce mouvement des populations.
♦
Marie-Joseph Angélique est le nom donné par les autorités de Nouvelle France à une esclave noire de Montréal. Elle appartenait à Mme de Couagne, veuve de François Poulin de Francheville. Marie Angélique jouissait d’une certaine liberté mais s’entendait très mal avec sa maîtresse qui la grondait et la battait27. Amoureuse d’un serviteur blanc de la même maison du nom de Claude Thibault, Marie-Angélique refusait catégoriquement d’épouser un autre esclave noir que ses maîtres lui avaient désigné28. Quand elle apprit que ses propriétaires avaient décidé de la vendre aux Antilles dès le retour des bateaux à Québec, elle mit le feu à la maison pour couvrir sa fuite en compagnie de son amant. Bien qu’il n’y eut que des dégâts matériels, l’incendie se propagea et détruisit 46 édifices, dont l’Hôtel-dieu, dans la partie constituée actuellement du Vieux Montréal29. Les deux amants furent rattrapés avant qu’ils n’aient pu gagner la Nouvelle Angleterre. Claude Thibault passa quelques années en prison et Marie-Angélique fut traduite en justice et condamnée à mort. Sa pendaison eut lieu le 21 juin 1734.
Marie-Joseph Angelique, negress, slave woman of Thérèse de Couagne, widow of the late François Poulin de Francheville, you are condemned to die, to make honourable amends, to have your hand cut off, be burned alive, and your ashes cast to the winds. » — Judge Pierre Raimbault, June 4, 173430
♦
Ancien conseiller au Parlement de Bourgogne, à Dijon, au moment de la Révolution française, Bénigne-Charles Fevret de Saint-Mesmin, émigra en Allemagne en 1793. Il se rendit par la suite en Angleterre avec l’intention de se rendre à Saint-Domingue où sa femme Marie de Motinans, possédait des richesses considérables. Accompagnés de leur fils Jules, ils s’embarquèrent pour Halifax et, de là, gagnèrent New-York en passant par Québec et Montréal. Ils apprirent alors la nouvelle de la révolte à t-Domingue et durent rester aux États-Unis. Leur fils Jules, qui possédait un réel talent de peintre et de graveur, assura leur subsistance. En 1802, les Saint-Mesmin passèrent à Saint-Domingue où le père mourut la même année. Jules de Saint-Mesmin retourna en France en 1810 et mourut à Dijon en 185231.
♦
Au cours du XVIIIè siècle, au moins cinq «immigrants involontaires» de Saint-Domingue étaient établis au Canada, signale Daniel Gay. «There is clear evidence of the presence of three of them – two in Quebec (1728 and 1729) and one in Montreal32». Etaient-ils esclaves? Gay ne l’affirme pas mais le sous-entend en associant leur présence à la pratique de l’esclavage au Canada à cette époque. Mais des hommes libres de Saint-Domingue ont également sillonné la Nouvelle France. De père français capitaine de navire, de mère esclave affranchie de Saint-Domingue, ayant épousé une Amérindienne, coureur de bois au pays des Illinois, territoire de Nouvelle-France qui passera sous domination anglaise, situé à la jonction du Canada et de la Louisiane, Jean-Baptiste Pointe Du Sable condense en lui les caractéristiques de cet empire colonial français. A la croisée des mondes créole, français, amérindiens et anglais, son parcours migratoire traverse l’empire et ses activités socio-économiques s’insèrent dans celles propres à cette époque tout autant qu’il les révèle. Sa fin de carrière est emblématique du déclin et de la chute de cet empire.
2. Le trappeur de Saint-Domingue
Le territoire que l’on a appelé la «Grande Louisiane Française» peut être divisé en deux sous- entités géographiques, administratives et économiques : la Basse Louisiane dont la limite était marquée, au nord, par l’embouchure de la rivière des Arkansas et la Haute Louisiane qui incluait le Pays des Illinois. Ce dernier faisait la jonction entre la basse vallée du Mississipi et le Canada duquel il dépendait administrativement jusqu’en 1718. Après cette date, le pays des Illinois fut rattaché à la Louisiane33. La présence française y est restée très forte jusqu’au milieu du XIXe siècle, comme l’attestent les récits de Juliette Magill Kinzie, épouse de John Kinzie, publiés en 185634. Carrefour du réseau fluvial entre le Canada et la Louisiane, la région des Grands Lacs était un passage obligé et un enjeu majeur dans la rivalité qui opposait les empires britannique et français. Ces derniers y avaient construit toute une série de forts sur le pourtour et tout le commerce entre le nord et le sud de la Nouvelle France y transitait. Là, s’y sont rencontrées les différentes populations.
Parmi les natifs de Saint-Domingue impliqués dans la traite de la fourrure en Nouvelle France, Jean-Baptiste Pointe Du Sable (1745-1818) est le plus connu des immigrants saint-dominguois à s’y être établi. En 1673, Le Père Jacques Marquette, missionnaire français de l’ordre des Jésuites, en compagnie de l’explorateur et cartographe Louis Jolliet avaient déjà parcouru la région de la rivière Chicago. A cette époque, des fourrures de grande valeur avaient été transportées jusqu’à Hochelaga (Montréal) le long de la voie navigable des Grands Lacs, mais aucune colonie européenne n’était établie de façon permanente35. Le premier établissement permanent, après l’échec de la mission du Père François Pinet en 169636, fut créé par Jean-Baptiste Du Sable que l’on considère aujourd’hui comme le fondateur de la ville de Chicago. « Relatant les débuts de la fondation de la ville, les Indiens racontent, avec grande simplicité, que le premier homme blanc qui s’est établi ici était un Noir. C’était Jean Baptiste Point-au-Sable37 ».
Du Sable naquit à Saint-Domingue, dans la ville de Saint-Marc. On sait peu de choses des premières années de sa vie. Sa mère était une esclave affranchie dont la mort, probablement, surprit Du Sable alors qu’il était encore un jeune adolescent. Tous les écrits présentent son père comme un marin français, sauf Maria King38 qui le désigne comme un « French-Canadian sea captain ». De la même façon, entre Nouvelle-Orléans et Nouvelle France, Eric Bennett39 laisse planer le doute quant au lieu d’entrée de Du Sable sur le continent. Plus catégorique, John F. Swenson, dans son article paru dans A Compendium of the Early History of Chicago, affirme que Du Sable était un sujet de l’Empire britannique né au Canada : « It’s not me that disagrees, it’s the documents that disagree. » Mais les documents ne corroborent pas les affirmations de Swenson40. Ces controverses ont au moins le mérite d’affirmer une chose : que Jean-Baptiste Pointe Du Sable était bien établi en Nouvelle France. On ne sait non plus exactement quel métier il exerça à Saint-Domingue. On le décrit tantôt comme distillateur, tantôt comme tanneur, mais il est le plus souvent affirmé qu’il était, comme son père, marin. Bien éduqué, homme de bon goût, la plupart des écrits allèguent qu’il aurait fait ses études en France où il avait suivi son père. Ce qui est davantage certain, c’est qu’il partit de sa ville natale, fuyant probablement les violences politiques qui agitaient la colonie, en direction de la Nouvelle-Orléans aux abords de laquelle son bateau fit naufrage en 1764. Il avait dix-neuf ans. A cette date, la Louisiane était encore possession française mais l’année précédente, en 1763, le traité de Paris avait accordé l’administration de cette partie de la Nouvelle France à l’Espagne. Dépourvu de pièces d’identité et craignant d’être mis en esclavage par les Espagnols, Du Sable trouva refuge et protection chez les Jésuites français. Plus tard, il émigra au nord vers Saint-Louis, puis vers Peoria, dans l’Illinois.
Coureur de bois parmi les Indiens, dans sa migration vers le nord le long du Mississipi, Du Sable rencontra Kittihawa, une Amérindienne Poutéouatami dont il tomba amoureux et de laquelle il eut deux enfants, Jean et Suzanne. Il s’y construit un chalet de bois et, trappeur dans le commerce de la fourrure, Du Sable s’intégra et s’impliqua de plus en plus dans la vie des Indiens qui le considéraient comme un des leurs41. Sa renommée auprès des autres colons et commerçants prospéra avec son commerce et il gagna respect et confiance auprès des Indiens du Midwest dont il devint le représentant dans les négociations avec les Européens42. Ce commerce qu’il mit sur pied à Peoria était l’embryon en même temps que l’apprentissage du fonctionnement d’un poste de traite. Du Sable y possédait une ferme de 800 acres43. Il entretint d’abord commerce avec les Indiens Poutéouatamis qu’il payait en pots et barres de fer, couvertures de laine et toutes sortes d’articles de sa ferme et de son atelier44. Ainsi, trouvant le chemin de cette contrée lointaine, le Noir de Saint-Domingue commença une vie parmi les Indiens. Si «il y a généralement une grande affection entre ces deux races… Jean-Baptiste s’est imposé parmi ses nouveaux amis en leur faisant croire qu’il était un grand chef parmi les Blancs45 ».
Au cours de ses nombreux va-et-vient au Canada où il faisait commerce, il découvrit ce lieu que les Indiens appellent Eschikagou, «land of the wild onions46» ou «place of bad smells47» à cause de l’odeur marécageuse des eaux. Il décida de s’y installer48. Au début des années 1770, il quitta Peoria et se dirigea vers ces Grands Lacs, et construisit une grande maison de cinq pièces sur les berges de la rivière Chicago, côté nord, à l’embouchure du lac Michigan, en ce lieu hostile où aucun de ceux qui l’avaient traversé avant lui n’avaient discerné le potentiel économique. De la Nouvelle-Orléans à Québec, la préoccupation principale en Nouvelle France était le ravitaillement des colons, des soldats et des esclaves du sud49. La Louisiane et le Canada étaient souvent en concurrence économique depuis la guerre de la fourrure quand, en 1740 et au début de 1750, Vaudreuil, gouverneur de la Louisiane, avait tenté d’interdire la traite du Pays des Illinois et du Missouri aux traiteurs canadiens50. Stratégiquement situé, au fil des ans, Du Sable développa et transforma ce premier établissement en un prospère comptoir commercial qui comprenait granges, étables pour le bétail, moulin, boulangerie, poulailler, laiterie, fumoir et une maison ceinte de vergers, richement meublée, décorée d’œuvres d’art et de plusieurs pièces rares d’art européen51. Travailleur infatigable, polyvalent, Du Sable était à la fois fermier, charpentier, tonnelier, meunier, et aussi probablement distillateur. Ce comptoir commercial était sur un itinéraire clef pour le commerce et son rayonnement s’étendait vers le Wisconsin, le Michigan et la Nouvelle-Orléans ainsi que vers le Canada, jusqu’à Québec où Du Sable fit de nombreux voyages pour y vendre ses produits. Les Amérindiens, dont il faisait désormais partie, jouaient un rôle crucial dans le ravitaillement des populations européennes qui faisaient appel à eux dans les moments de mauvaises récoltes52. Aussi, dans ces lieux, il y envoyait du blé, du pain, de la viande et des fourrures. Ce poste devint rapidement l’un des principaux centres d’approvisionnement et d’échanges de la région pour les trappeurs, les commerçants, les coureurs des bois et les Amérindiens.
Du Sable était très étroitement associé aux Français du Canada et ces liens qu’il entretenait tant avec ceux-ci qu’avec les Américains conduisirent à son arrestation, en 1779, par les Britanniques53. La confrontation entre ces derniers et les Français pour la possession des Grands Lacs s’était terminée en faveur des premiers par la prise de la ville de Québec en 1759. L’Empire Britannique est resté maître des Grands Lacs durant la révolution américaine, et ce n’est qu’à la fin du deuxième conflit, en 1812, que cette région est devenue la frontière entre la nouvelle république des États-Unis et le Canada britannique54. Du Sable fut d’abord incarcéré au fort Michillimackinac, sur les rives du détroit du même nom qui relie le lac Michigan et le lac Huron, là où, près de la mission de Saint Ignace55, les Français avaient construit un fort pour protéger le commerce des fourrures. Le document de 1779 rédigé par l’officier britannique qui a procédé à son arrestation rapporte que Du Sable etait « much in the interest of the French56 » et fut détenu pour «complicité de relations avec l’ennemi57». Mais son entregent et sa finesse d’esprit58 eurent tôt fait d’impressionner ses ravisseurs, comme l’atteste ce même document qui le décrit comme « a handsome negro, well educated59 ». Il ne tarda pas non plus à faire montre de ses remarquables talents, si bien que le gouverneur Sinclair lui confia la gestion d’un poste de traite, the Pinery, dans la région de Saint Clair river, dans le Michigan actuel60. Il occupa cette fonction durant cinq années, de 1780 à 178461. Polyglotte, outre le français, l’anglais et l’espagnol, Du sable parlait couramment plusieurs langues amérindiennes62. Aussi, les Britanniques l’utilisèrent-ils comme agent de liaison avec les Indiens.
A sa libération, à la fin de la guerre de l’indépendance américaine, en 1784, Du Sable retourna à son établissement de la rivière Chicago où il reprit ses activités. Seize années durant, il travailla d’arrache-pied pour faire de son domaine d’Eschikagou, comme il l’appelait de son nom amérindien, un comptoir commercial florissant. En 1788, sa famille le rejoignit et, catholique fervent, il épousa religieusement Kittihawa que les registres de l’Eglise ont inscrit sous le nom de Catherine. En 1796, leur petite-fille Eulalia devint le premier bébé né dans ce qui sera plus tard la ville de Chicago63. Grâce au dynamisme de Du Sable, autour de cette implantation s’édifia une petite communauté avec son école, son magasin général et son église. Les célébrations des premières noces et la tenue des premières élections eurent lieu dans sa maison. Et c’est là également que la Cour rendit justice pour la première fois64.
La Nouvelle France avait déjà été conquise par le Royaume britannique et les colons français rencontraient d’énormes tracasseries avec les Anglais qui, appliquant des règles strictes quant aux voyages et au libre commerce, les taxaient lourdement. Nombre de ces colons, venant d’aussi loin que la ville de Québec65, fréquentaient son poste de traite66 qui accueillait Amérindiens, Canadiens, Britanniques, Français ou Américains67. Il y avait là un extraordinaire mélange de cultures et de langues68. Dès le départ, la société du Midwest était multiculturelle. Les mariages interethniques étaient courants et des liens étroits se tissaient par-delà les barrières culturelles69.
Ce poste de commerce avait profondément modifié la vie des Amérindiens. Notable parmi les siens, la réussite de Du Sable avait suscité bien des convoitises et nombre de commerçants avec qui il faisait affaire étaient intéressés à acquérir son établissement, ce qu’il avait toujours refusé. Mais en 1800, il vendit sa propriété ainsi que tous ses biens à un de ses employés, Jean Le Lime (ou Le Mai), un Français de Québec70, prête-nom de John Kinzie, pour la somme, assez considérable à l’époque, de mille deux cents dollars71. Et il retourna à Peoria où il demeura chez son ami Glamorgan, un autre Noir de Saint-Domingue, jusqu’en 1805. Les raisons de son départ ne sont pas clairement établies. Certains auteurs avancent qu’il déménagea suite à la mort de son épouse et de son fils72, tandis que d’autres affirment qu’il s’en alla, déçu par l’échec qu’il subit dans sa tentative de se faire élire Chef parmi les Poutéouatamis 73. En 1805, les registres immobiliers74 indiquent que Du Sable s’installa à Saint Charles, dans le Missouri, où habitait sa petite-fille, tandis que sa fille Eulalia et son mari avaient émigré au Canada. Il y vécut paisiblement jusqu’à sa mort le 28 août 181875. Il est enterré au cimetière de l’église Borromeo.
3. Un même gouverneur76
La guerre bien souvent intensifie le commerce. Et en cette époque de rivalités guerrières entre la France, l’Angleterre et l’Espagne, le commerce fleurit. Il fallait nourrir et approvisionner les soldats mais aussi les esclaves des colonies. Aussi, la prise de Québec par les Anglais en 1759 n’a pas mis un terme au commerce triangulaire. En outre, la moitié nord du continent lui ayant échappé avec l’indépendance des Etats-Unis, l’Angleterre allait tenter de faire main basse sur cette île de Saint-Domingue, la plus prospère des colonies françaises, dont « le produit, en 1789, était supérieur à celui des Etats-Unis [et dont] le commerce représentait les deux tiers des échanges extérieurs de la France77». Une situation inespérée se pressentait aux Britanniques. Les colons de Saint-Domingue, qui refusaient toute idée d’affirmation des droits des Noirs et des Mulâtres, et encore moins l’égalité politique que prônait l’Assemblée de France, commencèrent dès 1791 des pourparlers avec Adam Williamson, gouverneur de la Jamaïque voisine, en vue d’une alliance avec l’Angleterre. Le 29 août 1793, le Commissaire Sonthonax avait proclamé la suppression de l’esclavage à Saint-Domingue et le 4 février 1794 la Convention de Paris l’abolissait dans toutes les colonies françaises. Les négociations des colons avec l’Angleterre aboutirent le 1er février 1793, le jour où la Convention de Paris publiait sa célèbre déclaration de guerre des peuples contre les rois. L’Angleterre entra en scène et tentera d’assujettir Saint-Domingue qu’elle contrôla partiellement de septembre 1793 à octobre 1798. Des cinq gouverneurs britanniques que connut Saint-Domingue, le troisième a été John Graves Simcoe qui fut le premier lieutenant-gouverneur du Haut-Canada. Pour éviter que les Anglais ne soient noyés dans la majorité francophone, l’Acte constitutionnel de 1791 avait séparé le Canada en deux : le Haut-Canada (Ontario) avec une population de 15 000 habitants, essentiellement des loyalistes venus des Etats-Unis, et le Bas-Canada (Québec) qui comptait 160 000 Français.
John Graves Simcoe naquit le 25 février 1752 à Cotterstock et mourut le 26 octobre 1806 à Exeter, en Angleterre. Il s’engagea dans l’Armée Britannique en 1771. Le 35e d’infanterie duquel il faisait partie fut envoyé au Massachusetts combattre l’armée indépendantiste des Etats-Unis en 1775. Il fut promu capitaine mais se vit refuser l’autorisation de lever un corps formé de Noirs affranchis. Il obtint cependant le commandement du nouveau corps provincial des Queen’s Rangers avec le grade de major, le 15 octobre 1777. Il remporta des succès militaires certains et se fit une réputation de théoricien dans le domaine tactique. Démobilisé pour cause de maladie en 1781, il passa sa convalescence dans le Devon (Angleterre) où il séjourna paisiblement pendant dix ans. Mais il ne se retira pas pour autant de la vie publique. Elu à la chambre des Communes en 1790 dans la circonscription cornouaillaise de St Mawes, sa carrière parlementaire fut courte et sans éclat. Les seuls discours qu’on a rapportés de lui portaient sur le projet de constitution pour la province de Québec et d’une proposition visant à abolir la traite des esclaves. En se lançant en politique, il n’avait d’ambition autre, semble-t-il, que de s’assurer un poste dans l’armée ou dans les colonies. Il fut nommé premier lieutenant gouverneur du Haut Canada en 1792, poste qu’il occupa jusqu’en 1796.
Tandis que l’Empire Britannique n’abolira l’esclavage qu’en 1834, la province du Haut Canada, sous l’administration de Simcoe, fut le premier territoire de la Couronne à adopter une loi anti-esclavagiste en mai 1793. Simcoe aurait souhaité une abolition immédiate mais l’Assemblée limita la portée de son projet de loi. Celle-ci interdisait d’amener une personne dans la colonie dans le but de la réduire en esclavage, ce qui équivalait à une abolition graduelle. Lorsque la névralgie et la goutte l’obligèrent à quitter la province en juillet 1796, John G. Simcoe retourna en Angleterre, mais sa carrière n’était pas terminée.
Dans ce XVIIIè siècle finissant, la guerre entre l’Angleterre et la France s’intensifiait pour le contrôle des colonies antillaises. Les succès militaires de Simcoe dans la guerre américaine lui valurent probablement d’être muté à Saint-Domingue afin de rétablir l’ordre dans cette île menacée par un soulèvement des esclaves. C’était, en tout cas, le choix du Premier Ministre William Pitt. La perspective de voir son mari, âgé maintenant de quarante quatre ans et de santé chancelante, se rendre dans cette «île de la fièvre», ne souriait pas à son épouse, Elizabeth Posthuma Gwillim d’autant plus que John P. Bastard suggérait à Simcoe d’y emmener avec lui un médecin. Patriote au service de Sa Majesté, Simcoe accepta le poste tout en recherchant des garanties pour le bien-être de sa famille et en requérant, auprès du Duc de Portland, la mise à sa disposition d’une frégate pour son retour en Europe au moment où il le jugerait opportun. Par ailleurs, ce poste lui offrait également la possibilité de passer du grade de major général à celui de lieutenant général, grade qu’il obtint le 10 novembre 1796, quelques jours après son affectation à Saint-Domingue.
Simcoe, l’anti-esclavagiste, mais fidèle à l’Empire, allait combattre pour le rétablissement de l’esclavage. C’était une tâche difficile car les obstacles étaient nombreux sur le terrain, et la situation très complexe. Les colons royalistes de Saint-Domingue affrontaient la rébellion des esclaves et des mulâtres affranchis dont certains s’étaient alliés à l’Espagne tandis que d’autres se réclamaient de la République française. Mais dès 1794, cette révolte était bien organisée car les insurgés avaient trouvé en Toussaint Louverture un chef inspiré et un brillant stratège. Entre 1793 et la fin de 1796 les Anglais avaient perdu 7 500 hommes sur le terrain. Lorsque Williamson, nommé chef des colonies britanniques des Caraïbes en 1795 débarqua à Saint-Domingue au mois d’août avec 982 hommes, six semaines plus tard il en avait déjà perdu 630. En mai 1796, 7 000 hommes débarquèrent de nouveau mais la situation ne s’améliora guère. En outre, la corruption gangrenait le service de ravitaillement militaire britannique et les services médicaux peinaient, impuissants, à combattre la fièvre jaune. Avant son départ, Simcoe s’entretint longuement avec Adam Williamson qui était rentré en Angleterre. En Janvier 1797 il embarqua pour Saint-Domingue et un mois plus tard il accosta à Port-au-Prince. C’était une guerre féroce. La brutalité des uns n’avait d’égale que la violence des autres et les appels au calme et à la modération de Simcoe restèrent lettre morte. Il s’évertua à consolider l’administration britannique de l’île et à restaurer les ouvrages de défense des plantations royalistes. Il reprit la ville de Mirebalais à Toussaint qui le lui avait enlevé en mai 1797, refoula Pétion qui attaquait Port-au-Prince par le sud et défendit victorieusement la ville portuaire de Saint-Marc d’une attaque de Toussaint qui ne réussit à lui reprendre que la ville de Verrettes. A la mi-juin il informa Londres qu’avec 6 000 hommes supplémentaires il serait en mesure de prendre le contrôle de la totalité de l’île. Mais ses demandes n’eurent pas de suite plus rapidement que celles qu’il avait formulées quand il était en poste au Canada. Bien qu’il persistât à préparer des plans de conquête, il ne pouvait, dans ces conditions, espérer vaincre la détermination et l’habileté tactique de Toussaint Louverture qui disposait d’une armée de 51 000 hommes, fraîchement approvisionnée en armes par la France. Malade, privé des troupes et des équipements nécessaires à la poursuite de sa tâche, Simcoe quitta Saint-Domingue au mois de juillet et arriva en Angleterre furieux de ce manque de soutien. Ce départ fut perçu comme une désertion par ses supérieurs et le duc de York, commandant en chef de l’armée, songea même à le mettre en accusation. Son ami Henry Dundas, ministre de la guerre, ne daigna même pas le rencontrer. Mais ses successeurs à Saint-Domingue lui donneront raison. Nesbit dira plus tard de la décision de Simcoe que « le seul geste raisonnable eût été d’user de l’autorisation que lui avait déjà donnée le gouvernement de se retirer de l’île ». Et après lui, Maitland, dernier des gouverneurs britanniques de l’île, concèdera la victoire à Toussait Louverture. L’Angleterre se retirera de l’île en 1798. Saint-Domingue se retournera contre la France en 1802 quand Napoléon voulut rétablir l’esclavage dans l’île. Il sera lui aussi vaincu en 1804 par les disciples de Toussaint Louverture.
L’Empire Britannique avait payé cher, en vies humaines et en argent, la campagne de Saint-Domingue. Et en hommage au dernier gouverneur britannique de l’île, Simcoe adressa une requête au Roi lui mandant « deux pistolets espagnols en laiton » de Saint-Domingue. Sa Majesté acquiesça à la demande et, deux ans plus tard, les deux pistolets ornaient le vestibule de sa demeure de Wolford Lodge.
4. L’éclipse
Devenue Haïti en 1804, la guerre de l’indépendance avait laissé le pays quasiment dévasté. Les esclaves de la colonie avaient vaincu deux des plus grandes puissances européennes de l’époque, mais l’esclavage n’était pas aboli dans le monde. Les Nations colonisatrices d’Europe et les jeunes États-Unis d’Amérique encore esclavagistes ne voyaient pas d’un bon œil cet exemple. Pour contrer l’influence de Saint-Domingue, ces nations la gardèrent à distance. La France ne reconnaîtra l’indépendance de son ancienne colonie qu’après 1825 et les Etats-Unis bien plus tard, en 1862.
Le commerce triangulaire qui avait été si fructueux dans le passé entre les colonies françaises d’Amérique avait fait long feu. Les Anglais continuèrent ce négoce avec les Antilles mais il se transforma et se poursuivit avec d’autres acteurs mais aussi avec d’autres colonies78, sous domination anglaise pour la plupart. Les relations commerciales de la jeune Haïti continuèrent pour l’essentiel avec l’Europe79 et, timidement aussi avec les Etats-Unis. Mais Haïti n’était plus intégrée dans l’économie monde. Durant près d’un siècle, elle est restée à l’écart des Nations.
De son côté, pendant plus d’un siècle, de la chute de Québec en 1759 à la Confédération en 1867, le Canada, sous domination britannique, était engagé dans un processus de cohésion interne. Le poids démographique des Français leur avait donné un pouvoir de négociation et permis de participer aux affaires de l’État. Entre 1812 et 1814 les Etats-Unis tentèrent d’annexer le Canada pour une seconde fois. Si lors de la première attaque en 1775 les Français refusèrent de se battre contre les Américains parce qu’ils avaient eu l’espoir que la mère patrie, alliée aux Etats-Unis contre l’Angleterre, était de retour, cette fois-ci ils étaient convaincus que la France d’après 1789 avait définitivement renoncé au Canada. Et ils combattirent aux côtés des Anglais. La rébellion de 1837-1838 voit Anglais et Français réclamer un gouvernement responsable, élu et prenant les décisions à la place du gouverneur imposé par Londres. Lord Durham qui enquêta sur les causes de la rébellion préconisa l’union des deux Canadas et l’assimilation des francophones par l’immigration, reprenant les objectifs de la proclamation royale de 1763. En 1840, année de l’Acte d’Union, les Anglais du Canada avaient considérablement augmenté leur population et ils étaient 500 000 Anglais pour 600 000 Français. Ceux-là se définissaient de plus en plus comme Canadians, terme jusque là réservé aux Français qui, en réaction, se proclamèrent Canadiens français, d’autant plus que l’Acte d’Union faisait de l’anglais la seule langue officielle du pays et accordait aux deux provinces le même nombre de députés en dépit du déficit de population du Haut-Canada. De 1838 jusqu’à l’instauration du gouvernement responsable en 1849, les Anglais tenteront en vain d’assimiler les Français. Après la suppression des tarifs préférentiels accordés par l’Angleterre au blé et au bois canadiens en 1846, la crise économique pousse 40 000 Canadiens français à émigrer aux Etats-Unis entre 1840 et 1850. L’année suivante, en 1851, les anglophones constituent le groupe linguistique majoritaire au Canada. De 1850 à 1860 plus de 250 000 immigrants entrent au Canada. La population de la ville de Québec est à 40% anglophone en 1861, et celle de l’ensemble de la province de Québec l’est à 25%. Entre 1861 et 1871, la population du Bas-Canada s’accroît de 7% tandis que celle du Canada augmente de 39%.
Cette période marque également l’enclenchement du processus de régionalisation qui va permettre l’accumulation du capital par le développement agricole, et l’accord de réciprocité avec les Etats-Unis qui entre en vigueur en 1855 favorise les exportations canadiennes. L’échec de la rébellion des Patriotes avait sonné le glas de l’ascendant des libéraux sur la société québécoise et consacré la montée de l’emprise du clergé. Ces deux facteurs conjugués vont, entre 1850-1870, servir de repères à l’identité canadienne française désormais définie comme un peuple catholique à vocation agricole. La composante catholique de cette identité persistera longtemps, traversera la période d’industrialisation, et ne sera remise en cause qu’au moment de la révolution tranquille qui s’amorcera en 1959.
Le 1er juillet 1867, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique crée la confédération du Canada. Le français redevient langue officielle à côté de l’anglais, mais le bilinguisme n’est pas à l’ordre du jour. Et en 1885, la construction du chemin de fer du Canadien-Pacifique reliant Montréal à Vancouver est terminée. L’ouverture de l’ouest à la colonisation réduit le poids politique du Québec et coïncide avec l’érosion des droits des francophones dans toutes les régions du Canada, ce qui entraînera une montée du nationalisme québécois. En 1900, la population du Canada est de 5,4 millions d’habitants dont 57 % d’origine britannique, 31 % d’origine française, 2 % d’Autochtones et 10 % d’origines ethniques autres. En 1896, le gouvernement de Wilfrid Laurier modifie la politique d’immigration et organise des campagnes de recrutement afin de peupler les grandes plaines canadiennes. Au total, c’est plus de deux millions et demi d’immigrants qui arrivent au Canada durant cette période. Mais en 1914, l’incident du Komagata Maru met en lumière la politique discriminatoire du Canada en matière d’immigration. Le navire, qui compte environ 400 passagers en provenance des Indes orientales, jette l’ancre en face de Vancouver. Il restera en rade deux mois sans qu’on laisse descendre les passagers. Il sera finalement chassé. Mais dès 1925, le Canada connaît un déficit migratoire et le gouvernement de Mackenzie King autorise le Canadien-Pacifique et le Canadien-National à recruter des immigrants du Sud de l’Europe, pays antérieurement non considérés pour l’immigration.
Alors qu’en 1831 un peu plus de 10 % de la population du Québec habitait en ville, cette proportion passe à 30 % en 1881. La ville de Montréal compte 141 000 personnes. On dénombre 3783 femmes dans les communautés religieuses féminines du Québec. Au cours de la seconde moitié du 19e siècle, 25 communautés féminines ont été fondées, et 12 ordres masculins. En 1887, les religieux représentent 48 % des instituteurs des écoles catholiques, alors que ce taux n’était que de 11 % en 1853. En 1901, près de 40 % de la population du Québec habite en ville. Le processus de centralisation est commencé et aboutira à la révolution tranquille des années 1960.
Au 19e siècle, il y eut donc éclipse des relations entre Haïti et le Canada. Mais les peuples ont toujours circulé entre les frontières et malgré ce repli et cet isolement, on trouve trace d’une présence haïtienne au Québec durant cette période. Daniel Gay signale l’établissement de deux immigrants venus de Port-au-Prince, dont un installé à Montréal en 1816 et un autre à Québec en 1820. «It is not yet known whether these early Haitian immigrants let any descendants in Canada80».
Ce n’est, à notre connaissance, qu’au tout début du 20e siècle que les journaux du Québec mentionnent une présence haïtienne dans la province. Le 11 mai 1901, Le monde illustré signale le passage à Montréal d’un avocat haïtien, Louis-Léonidas Laventure. Ancien commissaire du président Salomon, Laventure s’était porté candidat au parlement d’Haïti mais fut battu aux élections. Le journal publie la photo de cet avocat et mentionne qu’il avait le projet d’y prononcer une conférence, «en français, sa langue maternelle», souligne l’article. Il ne semble pas qu’il se soit installé au Québec. Il ne prononça pas sa conférence mais y laissa des notes, dont le journal publiera des extraits plus tard, et se rendit à New York81.
Cette présence haïtienne au Québec, épisodique et fugitive d’abord au début du 20e siècle, ira en s’accroissant pour devenir durable et définitive. Deux facteurs conditionneront cette immigration. Tout d’abord, l’émergence de la puissance économique et militaire des Etats-Unis qui captent à leur profit le commerce extérieur haïtien en éliminant l’Europe de ce marché. La pénétration de ce capitalisme étasunien dans l’espace socio-économique d’Haïti va contribuer à la déstructuration d’un mode de production pré-capitaliste à caractéristiques de sous-développement propres aux formations sociales périphériques. Dépendante et extravertie, l’économie d’Haïti se développe en fonction des besoins et de la logique des pays dominants du Centre, les Etats-Unis principalement. L’occupation militaire directe d’Haïti entre 1915 et 1934, en précipitant la centralisation de l’activité économique dans la capitale par «l’élimination des budgets communaux [et la] fermeture des ports régionaux au commerce extérieur, [va libérer] l’énorme réservoir de main-d’œuvre paysanne… au profit des centrales sucrières de la Caraïbe82», Cuba et République dominicaine notamment où les investissements américains sont de sept à dix fois supérieur. Cette occupation marque le retour d’Haïti dans l’économie monde et la première émigration massive : environ 500 000 personnes sont déplacées. Cette «traite verte» connaîtra un deuxième moment pendant la période de prospérité des années d’après-guerre. Mais alors un autre phénomène vient se superposer à cette nouvelle demande de main-d’œuvre dans la Caraïbe. L’incapacité des élites haïtiennes à trouver des solutions de sortie au sous-développement ouvrira la voie à la dictature des Duvalier qui s’imposera pendant près de 30 ans, de 1957 à 1986. Le blocage de la situation économique et la férocité de la répression des luttes contre ce régime forceront à l’exil de nouvelles catégories de travailleurs qui répondront aux besoins en main-d’œuvre qualifiée des centres capitalistes avancés : Etats-Unis, Canada, France. La fuite des cerveaux est spectaculaire : médecins, infirmières, enseignants, ingénieurs, cadres administratifs et techniques, ouvriers spécialisés, Haïti sera littéralement vidée de la quasi totalité des diplômés universitaires que la révolution de 1946 avait produits. Le rythme des départs est impressionnant. Il passe de 19 315 sorties en 1963 à 53 587 en 196783. Dans les années 1950, les travailleurs haïtiens aux Etats-Unis sont peu nombreux. Entre 1960 et 1970 ils seront 100 000. En 1980, ce chiffre atteindra 500 00084. Et ce sont de ces immigrants diplômés dont le Québec bénéficiera d’abord. Cet appel de main d’œuvre qualifiée aura été longuement préparé par les missionnaires religieux, notamment canadiens, que l’invasion américaine d’Haïti avait apportés avec elle dans ses bagages.
1 Ce texte a fait l’objet d’une présentation orale dans le cadre des midis du Celat à l’Université Laval en 2005.
2 Jacques Mathieu, Le commerce entre la Nouvelle-France et les Antilles au XVIIIe siècle, Fides, Montréal, 1981, p. 11.
3 Lorsque la France vendit la Louisiane aux Etats-Unis en 1803, elle n’en avait en fait repris possession que depuis trois semaines.
4 Joseph Zitomersky, cité par Gilles Havard et Cécile Vidal, Histoire de l’Amérique française, Paris, Flammarion, 2003, p. 82.
5 Havard et Vidal, op. cit, p. 307.
6 La Boulaye, cité par Jacques Mathieu, Le commerce entre la Nouvelle-France et les Antilles au XVIIIe siècle, Fides, Montréal, 1981, p. 36.
7 Idem, p. 10
9 Amérique Française Recueil relatif à son commerce et à ses productions par Daflon en 1771. Extraits du dictionnaire de commerce, archives nationales du Canada, MG23 L1 M.133, p. 25
10 L. Chauleau, La société martiniquaise au XVIIIe siècle (1635-1713), cité par Mathieu, op.cit., p. 18
11 Jacques Mathieu, op. cit. p. 15.
12 Idem, p. 17
13 Cité par Mathieu, idem, p. 25.
14 Idem, p. 10
15 Havard et Vidal, p. 316.
16 Idem, p. 313
17 Mathieu, op. cit. p.7.
18 Idem.
19 Havard-Vidal, op. cit., p. 310-311
20 Daflon, op.. cit. p.28-29
21 Mathieu, op. cit. p. 24.
22 Idem, p. 11
23 L.P. May, Histoire économique de la Martinique, cité par Mathieu, op. cit., p. 25
24 Louise Dechêne, Le partage des subsistances au Canada sous le régime français, Montréal, Boréale, 1994, p. 123
25 André Champagne, L’histoire du régime français, Québec, Septentrion/Radio Canada, p. 120.
26 Havard et Vidal, op. cit., p. 317
27 Havard et Vidal, op. cit., p. 354
31Journal de notre navigation partant du port de Falmouth Angleterre à celui de Halifax dans la nouvelle écosse », juin-octobre 1793, par B.-C. Fevret de Saint-Mesmin. Archives nationales du Canada, Référence : R6544-0-8-F
32 Daniel Gay, Haitians, Encyclopaedia of Canada’s people, Toronto, University of Toronto Press, 1999, p. 650.
33 Gilles Havard et Cécile Vidal, Histoire de l’Amérique française, Paris, Flammarion, 2003, p. 15.
34 Juliette Kinzie (1856), Wau-Bun: The Early Days of the North-West, Ed. Rand, McNally and Company, Chicago and New York, 1901.
35 Les grands lacs : atlas écologique et manuel des ressources, chap. 3 les habitants et les grands lacs, édition électronique bilingue, Environment Canada and United States Environmental Protection Agency,
36 A chronological history of Chicago: 1673 –, Compiled by Chicago Municipal Reference Library, Chicago public Library, août 1999. http://www.chicagopubliclibrary.org/004chicago/chihist.html
37 Juliette Kinzie (1856), « Wau-Bun: The Early Days of the North-West, Chapter XVII, Ed. Rand, McNally and Company, Chicago and New York, 1901. http://www.authorama.com/wau-bun-19.html. Notre traduction. “In giving the early history of Chicago, the Indians say, with great simplicity, « the first white man who settled here was a negro. »
38 Maria King, Jean Baptiste Pointe du Sable, http://www.historicpeoria.com/select.cfm?chose=272
39 Eric Bennett, Du Sable, Jean Baptiste Pointe, Microsoft Encarta Africana Third Edition, 1998-2000 http://www.africana.com/blackboard/bb_his_000188.htm#mat
40 Monica Davey, Tribute to Chicago icon and enigma, Copyright 2003, June 25, 2003 http://www.wehaitians.com/tribute%20to%20chicago%20icon%20and%20enigma.html
41 http://library.thinkquest.org/10320/DuSable.htm?tqskip1=1
42 http://www.thecollectionshop.com/xq/ASP/USPS/DU+SABLE-COMMEMORATIVE+PANE/StockNumber.900052/qx/Black_Shear_Gallery_Detail.htm
43 Maria King, op. cit.
44 Atlas des grands lacs, chap.7, People and the land., op.cit.
45 Monica Davey, op. cit.
46 Maria King, op. cit.
47 http://library.thinkquest.org/10320/DuSable.htm?tqskip1=1
48 http://www.cnn.com/EVENTS/1997/bhm/days/index.html#16 http://www.soulofamerica.com/cityfldr2/chicago17.html
49 Gilles Havard, et Cécile Vidal, Histoire de l’Amérique Française, Flammarion 2003, p. 302.
50 Idem, p. 295.
51 http://esperstamps.org/h10-print.htm , Voir aussi Eric Bennett, op. cit.
52 Gilles Havard, et Cécile Vidal, op. cit p. 303.
53 Annan Boodram Campaign to Give Du Sable His Due, New York, July 2002. http://www.caribvoice.org/Profiles/dusable.html
54 Les grands lacs : atlas écologique et manuel des ressources, chap. 3 les habitants et les grands lacs, op.cit.
55 Idem
56 Cite par Eric Bennett, op. cit.
57 Suspected “intercourse with the enemy”, Idem.
58A chronological history of Chicago: 1673 -, op.cit.
59 Cité par Monica Davey, op. cit.
60 Annan Boodram et Eric Bennett, op.cit.
61 Annan Boodram, op.cit.
62 Maria King, op. cit.
63Chicago history facts, Chicago city, http://www.corsinet.com/chicago/chicagot.html
64 A chronological history of Chicago: 1673 -, op.cit.
65 Dominique K. Butler, Jean Baptiste Point Du Sable, the founder of Chicago. 1995. http://www.lib.niu.edu/ipo/ihy951204.html . Le texte de Dominique K. Butler est une fiction basée sur les ouvrages factuels de Lawrence Cortesi, Jean Du Sable : Father of Chicago. Philadelphia, Chilton, 1972; Irving Cutler, Chicago; Milton Meltzer, The Negro in America; Robert M. Sutton, The Heartland.
66 Juliette Kinzie, op.cit.
67 Dan Rozek, Admirers rally for du Sable, http://www.heritagekonpa.com/archives/Haitian-born%20immigrant%20Du%20Sable%20Founder%20of%20Chicago.htm
Article originally appears on Chicago, Sun-Times
68 Russel Lewis, director of the collections at the Chicago Historical Society, cité par Annan Boodram et Dan Rozek, op. cit.
69 An atlas of biodiversity, People on the land, chap. 7
70 Juliette Kinzie, op. cit.
71 Florida A&M University Fondation, http://www.famu.edu/about/admin/vppa/Foundation/foundation.html,
Voir aussi : Annan Boodram, Monica Davey, Maria King, op. cit.
72 Dominique K. Butler, op. cit.
73 Julkiette Kinzie, op. cit.
74 Cité par Eric Bennett, op. cit.
75 Maria King, op. cit.
76 -Archives nationales du Canada, microfilm A-605
-Mary Beacock Fryer et Christopher Dracott, John Graves Simcoe, 1752-1806 : a biography, Dundurn Press, Toronto/Oxford, 1998.
– Stanley R. Mealing, Dictionnaire biographique du Canada en ligne, © 2000 Université Laval/University of Toronto
-Laws of his Majesty’s Province of Upper Canada in North America, 1792, 1793, 1794 and 1795, printed by Gideon Tiffany printer to his most excellent Majesty, 1795 (Archives nationales du Canada, Amicus no. 17075083)
77 Christian Girault, La genèse des nations haïtienne et dominicaine, 1492-1900, in Espace et identité nationale en Amérique Latine, CNRS, Paris, 1981, p. 14-15.
78 André Champagne, L’histoire du régime français, Québec, Septentrion/Radio Canada, p. 124.
79 Georges Anglade, Espace et liberté en Haïti, ERCE & CRC, Montréal, 1982, p. 89.
80 Daniel Gay, Haitians, Encyclopaedia of Canada’s people, Toronto, University of Toronto Press, 1999, p. 650.
81 Le monde illustré, 11 mai 1901, p. 22.
82 Georges Anglade, op.cit, p. 91.
83 Holly, Larose et Labelle, L’émigration haïtienne, un problème national, Collectif Paroles, No. 2, 1979, p. 21.
84 Labelle, Larose et Piché, Emigration et immigration : les Haïtiens au Québec, Sociologie et Sociétés, Vol. XV, No. 2, octobre 1983, p. 80.
