Jean-Durosier Desrivières vous ouvre ses archives
N°2 : Entretien avec Gary Victor
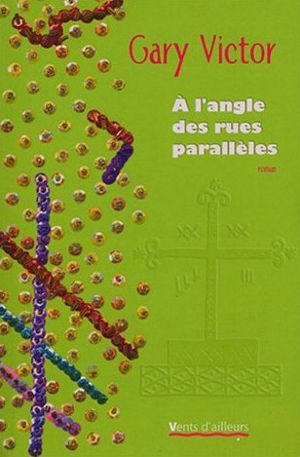 À l’angle des rues parallèles, Gary Victor • Vent d’ailleurs • ISBN 978-2911412233 • 2003.
À l’angle des rues parallèles, Gary Victor • Vent d’ailleurs • ISBN 978-2911412233 • 2003.
Son roman A l’angle des rues parallèles venait de paraître chez Vents d’ailleurs (2003), quand Gary Victor était invité par l’Association pour la Connaissance des Littératures Antillaises (ASCODELA), en Martinique. Garry Serge Poteau et moi-même avions rencontré l’écrivain le plus lu en Haïti au salon de l’Hôtel Galleria, le dimanche 9 novembre 2003. C’était l’occasion d’aborder avec lui, de façon détendue, les grandes thématiques de ce roman au titre combien énigmatique et symbolique qui semble prescrire une esthétique de la dégradation et de la déconstruction des mythes de l’espace haïtien.
Garry Serge Poteau : Gary VICTOR, dans A l’angle des rues parallèles, Eric, ton personnage principal, fait un véritable carnage aux représentants de l’autorité, de l’ordre, de l’Etat, de la culture… La volonté d’en finir avec les mythes fondateurs apparaît clairement dans tes œuvres. Comment expliquer ce besoin ?
Gary Victor : Ma perception des mythes vient d’abord de mon rapport avec le quotidien haïtien. J’éprouve la sensation constante d’être enfermé dans ce que j’appellerais un « collectif-prison ». Quand je regarde l’état de dégradation du lieu dans lequel j’évolue, et que j’entends les discours portés par le système, l’autorité, les institutions sur ce lieu qu’ils sont censés régir, j’ai l’impression en effet d’être en prison, et cette prison c’est un chaos. A ce moment, ma conviction profonde est que les mythes représentent non seulement les gardiens de cette prison, mais aussi une fuite incessante dans l’irréel, le virtuel. Il s’agit d’un système dont le but est de nous ligoter. Alors je m’interroge : en déconstruisant les mythes, est-ce que je vais accéder à la liberté, à la lumière ? Je ne sais pas, mais je ressens le besoin irrésistible de le faire, même si pour l’instant cela ne donne accès qu’à quelque chose d’hypothétique, peut-être utopique.
Jean-Durosier Desrivières : La déconstruction de ces mythes conduit vers la folie. C’est une thématique fondamentale dans tes œuvres. Une folie qui s’inspire de la réalité délirante et qui semble se poser comme une puissance positive, une force libératrice, symbole d’une lucidité déroutante, d’une générosité à fleur de peau, à fleur de sens. Peut-on dire, Garry Victor, que tu proposes la folie comme porte de sortie de la crise haïtienne, j’allais dire de la crise de l’homme haïtien ?
Gary Victor
 G. V. : Fondamentalement je ne pose pas la folie comme porte de sortie. Cependant, quand on vit dans une culture d’enfermement et qu’on souhaite s’en sortir, il faut la questionner, interroger ses mythes, ses légendes… les décortiquer, les déconstruire, les casser. C’est comme se livrer à une psychanalyse, une auto-psychanalyse qui nous plonge dans les méandres de notre imaginaire au risque évidemment de nous perdre, de déboucher sur la folie. Mais c’est le prix à payer pour se renouveler, pour se libérer. C’est un peu comme l’histoire tragique de Prométhée, ou d’Icare qui se brûle les ailes. Il faut savoir prendre des risques, on peut à tout moment se perdre, mais comme Ariane et son labyrinthe, il faut absolument un fil pour indiquer la sortie. Il ne s’agit donc pas d’une quête de folie en soi, mais son exploration comme processus, procédure de déconstruction des mythes.
G. V. : Fondamentalement je ne pose pas la folie comme porte de sortie. Cependant, quand on vit dans une culture d’enfermement et qu’on souhaite s’en sortir, il faut la questionner, interroger ses mythes, ses légendes… les décortiquer, les déconstruire, les casser. C’est comme se livrer à une psychanalyse, une auto-psychanalyse qui nous plonge dans les méandres de notre imaginaire au risque évidemment de nous perdre, de déboucher sur la folie. Mais c’est le prix à payer pour se renouveler, pour se libérer. C’est un peu comme l’histoire tragique de Prométhée, ou d’Icare qui se brûle les ailes. Il faut savoir prendre des risques, on peut à tout moment se perdre, mais comme Ariane et son labyrinthe, il faut absolument un fil pour indiquer la sortie. Il ne s’agit donc pas d’une quête de folie en soi, mais son exploration comme processus, procédure de déconstruction des mythes.
J. D. D. : En même temps on a l’impression que cette déconstruction ne va pas sans une sorte d’anamnèse.
G. V. : Absolument ! Car les mythes sont représentatifs des mémoires individuelle et collective. Il s’agit donc d’une exploration de ces deux mémoires, exploration souvent difficile et douloureuse.
G. S. P. : Exploration qui passe le plus souvent par une conscience, ou plutôt une démarche individuelle, voire individualiste. Question : face à une société aussi rigidement structurée, une mémoire collective aussi bien régentée, que peut l’individu ?
G. V. : Face au poids exagérément démesuré de la société, à la prééminence du collectif, la démarche individuelle s’impose. Haïti est un pays où prédomine le « nous », le « je » arrive difficilement à poindre. En ce sens, la démarche adoptée est non seulement légitime, mais salvatrice. Car l’émergence de l’individu permet non seulement sa libération, mais aussi à long terme celle de la société. Il faut d’abord se retrouver, plonger dans son imaginaire, trouver une porte de sortie, puis s’engager dans un mouvement collectif. N’oublions pas que nous vivons dans un pays où toute émergence du collectif est immédiatement étouffée.
G. S. P. : Gary, tes œuvres sont émaillées de thèmes, de figures représentatifs des bas-fonds (sous-sol, cave, égout, etc.…) Au-delà des connexions avec le psychanalytique, l’inconscient, l’on sent une régression, une déshumanisation de la société. De plus en plus sauvages, les personnages se terrent dans de véritables cavernes et se comportent comme des animaux féroces. Est-ce là ta lecture de la société haïtienne ?
G. V. : J’ai toujours eu la sensation que tout reposait en Haïti sur le collectif, le grégaire. Ma conviction est que le collectif relève du primitif et l’individu de l’humain. Or, mon objectif c’est de rechercher l’humain, de faire jaillir le « je », le « moi ». Je me suis personnellement extrait de ce collectif engluant, asphyxiant, car je ne l’aime pas. En ce sens, j’entretiens des relations ambiguës avec mon environnement, mon imaginaire, les mythes. C’est une relation à la fois d’amour et de répulsion.
J. D. D. : Je souhaite revenir sur le thème de la mémoire, de la mémoire comme boucle, répétition du passé. A travers le motif omniprésent du miroir aveugle, l’on retrouve sans doute le symbole d’une mémoire morte, figée, fixant le présent dans une espèce de carcan, de rythme monotone qui emprisonne le personnage. Quel est, selon toi, le type de relation que l’individu devrait entretenir avec la mémoire ?
G. V. : Toute relation avec la mémoire devrait se fonder sur la méfiance, car finalement la mémoire (collective) relève d’un héritage culturel imposé. Il faut se méfier des dictats, surtout quand entre le mythe et le réel apparaît une dichotomie, un décalage aussi flagrant. Il y a quelque part manipulation de la mémoire, manipulation de la conscience. Or, j’ai toujours eu une crainte terrifiante d’être manipulé, d’être détenteur d’une mémoire trafiquée. A partir du moment où l’on prend conscience d’avoir été manipulé, on a qu’une solution : remonter la mémoire et déterminer l’origine de la déviance. Ainsi, j’entreprends un autre type de rapport avec mon passé.
J. D. D. : La mémoire que tu mets en scène est quelque part aussi sélective. A travers elle, à travers ton discours l’on entend l’écho d’autres intellectuels, écrivains, artistes… comme s’il existait une volonté de mettre en évidence des valeurs disons… plus positives. Ferais-tu une distinction entre ce que j’appellerais, à défaut de mieux, culture élitiste et culture populaire ?
G. V. : Ma démarche est celle d’un rebelle qui s’inscrit à la marge de la société, qui se bat contre la société et qui se refuse à toute perpétuation des traditions culturelles aliénatrices que d’autres intellectuels et écrivains ont pendant longtemps aider à préserver.
G. S. P. : Garry, avec Eric, tu as inventé un personnage profondément subversif et nouveau dans la littérature haïtienne : il ose aller jusqu’au bout dans le meurtre du père. L’on passe de Manuel (Jacques Roumain), El Caucho (Jaques-Stephen Alexis), des personnages larmoyants, dévorés par le doute et la culpabilité sous la dictature des Duvalier, à ce révolté impitoyable qui s’en prend violemment à sa culture. Chercherais-tu ainsi à créer un type nouveau, un surhomme dans le sens où l’entendait Nietzsche ?
G. V. : C’est une question qui m’a déjà été posée. Mais Eric est un anti-héros sans repères ni valeurs. Aussi, est-il obligé d’aller en chercher d’autres, d’en créer d’autres. Il est constamment en quête. Ce n’est pas une logique nihiliste, mais constructiviste.
J. D. D. : A te lire on a l’impression qu’il n’y a pas de déconstruction et de construction sans violence. Violence sur soi, violence peut-être stratégique conduisant vers une éventuelle solution.
G. V. : C’est une violence à la fois symbolique et psychologique. Eric fait violence sur lui-même et sur son entourage. Là, commence la déconstruction : il remet en cause les valeurs acquises, sa vision du monde et s’engage sans doute dans une nouvelle construction.
G. S. P. : Garry Victor, quelque chose m’a intrigué dans ce projet de déconstruction. Je pense précisément à la déconstruction de la langue, à l’inversion généralisée des signes. Nous savons, après Lacan, que s’attaquer à la langue, c’est s’attaquer au signifiant, au symbole, à l’ordre, à la Loi, au Père… Or, ton personnage, révolté, subversif, a été le dernier à subir cette mutation. Le mouvement est parti de son entourage. N’y a-t-il pas contradiction ?
G. V. : Autour du personnage gît, vit un immense chaos, un délire total qui conduit à ces inversions linguistiques jusqu’à la disparition du langage. Eric, lui, est immunisé, protégé de cette folie générale car il a pris conscience et a décidé d’une méthode, contrairement à la foule, à la population qui est en train de se désagréger.
J. D. D. : Eric, présenté comme fou, est donc un personnage positif et lucide par rapport à son entourage qui vit dans la désillusion, le désespoir et la détresse, enfermé dans une logique absurde.
G. S. P. : Est-ce que, comme c’est un peu la mode aujourd’hui, tu t’inscris dans une esthétique de la dégradation ou du délabrement comme le dit Lyonel Trouillot ?
G. V. : Je suis dans un processus d’évasion du délabrement, du chaos. Toute mon œuvre cherche à s’en échapper pour essayer de construire autre chose.
J. D. D. : Est-ce que ça voudrait dire que l’esthétique se trouve dans l’intention et non dans l’expression ?
G. V. : Tout à fait. Mais elle se trouve également dans l’expression.
G. S. P. : Ton roman est à cheval entre le merveilleux, le fantastique, le réalisme, le polar… on sent une tendance à pervertir les genres. Quelle est ta vision du roman ?
G. V. : Ce sont des questions que je ne me pose pas. Cette technique d’écriture reflète mon environnement, l’urgence permanente dans laquelle l’on vit… On est dans la mort toujours inéluctable, dans le suspens, le polar, car on se demande constamment si la fin n’est pas pour demain ; on est aussi dans l’investigation, car il faut comprendre mon chaos, trouver le coupable ; on est dans le fantastique, dans ce glissement quotidien dans l’invisible, le mystique…. Bref on baigne dans tout ça. C’est probablement ce qui justifie mon écriture, ou comme disent certains, mon inclassabilité.
J. D. D. : Est-ce que tu es à l’écoute de ce qui ce qui se passe dans le monde littéraire tant dans la Caraïbe que dans le reste du monde ?
G. V. : Je suis un grand lecteur, je m’intéresse à tout : mon environnement immédiat, moins proche et le reste du monde. Je ne suis pas particulièrement à l’écoute de la créolité, mais j’adore par exemple ce que fait Chamoiseau. Je lis ce qui m’intéresse, c’est une question d’affinité, de plaisir.
J. D. D. : Est-ce que tu te considères comme un écrivain engagé ou un écrivain tout court ?
G. V. : Un écrivain tout court. Je n’aime pas le terme « engagé » car il laisse entendre que le message précède la création. Or ce n’est pas ma conviction, le message doit se dégager de la création. Etre écrivain engagé, c’est se ligoter. Or je refuse tout cloisonnement car l’écriture est une quête, une aventure dont on ne connaît pas l’issue.
