 — Jean-Noël Chrisment (revue Esprit n° 517-518, janvier-février 2025) —
— Jean-Noël Chrisment (revue Esprit n° 517-518, janvier-février 2025) —
Il y a une élégante humilité dans ce titre, L’Homme qui voulait peindre des fresques, faisant d’emblée douter qu’il y soit parvenu. Au dernier tiers du recueil, un poème au ton très détendu, reprenant, à peine modifié, ce titre dans le sien, en émettra de nouveau le doute, plus explicitement encore, resserrant sa dérision d’un humoristique « peut-être ». C’est une position d’écriture à laquelle peut d’emblée répondre, ici, celle d’une lecture qui sera celle, en toute simplicité, d’un partage attentif d’intérêt avec Michel Herland pour ce qui insiste en l’homme, persiste en lui de ce « haut-langage » du poème, dont le rapport au merveilleux terrifiant du monde s’est sans doute instauré bien avant que la Grèce ne lui prête cette hauteur. Au fond, sans doute, dès que l’homme a su s’interroger sur ce qui le dépassait de ce monde incompréhensible où il se trouvait jeté, au mutisme « déraisonnable » en tout cas devant ses questionnements. Sur ce qu’il redoutait comme plus durable, plus éternel ou d’une menace plus opiniâtre, derrière les rugosités passagères de l’instant ou les atermoiements fragiles d’une époque. Un bel exergue de Baudelaire vient justement souligner que la modernité n’est jamais que le « transitoire » d’une époque et, en somme, « la moitié de l’art » face à « l’éternel et l’immuable » qui en figurent l’autre moitié.
Dans le même sens, le « Petit manifeste poétique » placé en début de recueil a l’intérêt de mettre au net certains points d’achoppement ou certaines nodosités de concept, de la diction du poème à son engagement. Car c’est tout de même cet engagement qui saute aux yeux du lecteur dès qu’il entre ensuite dans le corps du recueil (dans « Décembre 1959 », par exemple, ou « Hommage à Édouard Glissant »), pas uniquement politique, économique et social bien sûr, mais aussi esthétique dans une élévation bien personnelle cette fois (et non sans réticence à cette élévation ici ou là, on le sent bien) débordant des formes prises, éclatant, mais éclatant véritablement sous le poids d’un contenu trop dense et s’éparpillant en quelque sorte plus loin, plus haut, comme les brisures d’un vase trop fragile. Il y a dans la première section, Tropiques, cette élévation concrète prenant pour socle la splendeur de la négritude, montrée, démontrée, comme tenue à bout de bras, trophée gagné de haute lutte, mais ici hautement légitime, intime, tout près, puisque bien condensée, magnifiée jusqu’à l’obscène, dans la figure de l’épouse.
 L’émotion de la femme en présence et celle des paysages qu’elle ouvre derrière elle, dans un autre et pourtant toujours similaire espace, même si les limites et l’horizon n’en sont pas toujours évaluables, mais également dans un temps inchangé, et cependant distinct, où le paysage vient se resserrer, se définir en de « vieilles femmes ridées au sourire de fleurs ». Où la beauté de vieillir, sous la fatigue souriante du visage, s’habille en somme de quelque chose d’inusable comme un alexandrin. À travers cet espace-là, cette temporalité naturelle parfois réduite ainsi à un sourire, « Le visiteur qui passe se promène et se perd / Dans des rêves simples mystérieux et sauvages / Debout sur la jetée et tourné vers le large » n’est autre alors que vous, lecteur, celui qui « se noie lentement dans un grand soleil noir », inusable aussi ou plutôt perçu comme tel dans l’étroite perception, peu cosmique, d’une existence humaine. Mais ailleurs le ton devient plus désinvolte, plus direct, voire moins ébarbé, par une sorte de recul espiègle qui vous fait volontiers, à votre tour, venir un sourire aux lèvres. Et vous vous laisserez aller au délassement d’une chanson comme « Au village de Sainte-Anne ».
L’émotion de la femme en présence et celle des paysages qu’elle ouvre derrière elle, dans un autre et pourtant toujours similaire espace, même si les limites et l’horizon n’en sont pas toujours évaluables, mais également dans un temps inchangé, et cependant distinct, où le paysage vient se resserrer, se définir en de « vieilles femmes ridées au sourire de fleurs ». Où la beauté de vieillir, sous la fatigue souriante du visage, s’habille en somme de quelque chose d’inusable comme un alexandrin. À travers cet espace-là, cette temporalité naturelle parfois réduite ainsi à un sourire, « Le visiteur qui passe se promène et se perd / Dans des rêves simples mystérieux et sauvages / Debout sur la jetée et tourné vers le large » n’est autre alors que vous, lecteur, celui qui « se noie lentement dans un grand soleil noir », inusable aussi ou plutôt perçu comme tel dans l’étroite perception, peu cosmique, d’une existence humaine. Mais ailleurs le ton devient plus désinvolte, plus direct, voire moins ébarbé, par une sorte de recul espiègle qui vous fait volontiers, à votre tour, venir un sourire aux lèvres. Et vous vous laisserez aller au délassement d’une chanson comme « Au village de Sainte-Anne ».
Dans la section « Autres ailleurs », soulignons le poème « Nouméa culpa », dont le titre si pertinent, emprunté au livre de Jean-Claude Bourdais, outrepasse de beaucoup le jeu de mots et qui ne peut que prendre un éclairage bien plus tragique à l’heure actuelle, dans une Nouvelle-Calédonie encore fumante de ses récents embrasements. L’ambivalence de l’attrait qu’elle suscite est ici brossée à grands traits révoltés. Une page plus loin, quelques encablures dirait-on sur la carte, c’est une halte à « Sydney », où le vent de mer aura balayé l’odeur des fumées et des cendres. Une escale tout à la fois géographique et affective, rafraîchissante et aérée, mais dont la réalité immédiate paraît prendre ses distances. Cette aération intemporelle sera le prétexte, l’avant-poème, d’un remerciement, presque suranné dans le ton et le vocabulaire, à la luxueuse beauté d’une femme qui s’avère hors de portée ou inactuelle : « et merci à vous ma gracieuse / pour votre crinière tant délicieuse / celle qui fait de vous la sans pareille / et tout ce qui est vous cette merveille / celle que jusqu’ici oncques ne vis / qu’aime fidèlement et que suivis / en ces antipodiques contrées / pour vous faire ma cour ma retirée ». D’autres espaces, d’autres temps se croisent donc, échangent un clin d’œil. C’est qu’il y vibre encore, ainsi, l’écho d’un appel ronsardien, l’accent d’un bien sempiternel reproche adressé à un amour par définition inaccessible et d’autant plus insaisissable qu’il est soumis à d’autres mœurs, dont le dépit depuis le temps se lasse à rebondir ici sur la modernité d’un hall d’aéroport. « Ne voyez-vous pas que le soir / tombe et que si vous tardez davantage / je serai parti dans la nuit de l’âge ? » Et, par une semblable mise en perspective malicieuse, avec le sonnet d’octosyllabes « Plus me ravit ma Provence », dédié à l’amitié cette fois, l’affectivité vient également s’amplifier d’une temporalité qui la dépasse, par une langue halée d’un temps bien plus ancien que l’amitié contemporaine ancrée dans le poème.
Les textes d’« Amères destinées » marquent une rupture. Le ton désabusé, agressif et cynique en dérange efficacement le lecteur et désarme au fond le commentaire par une accumulation sans merci de répugnances volontiers argotiques et de voracités mi-figue mi-raisin – « Parce que nous sommes bien des chiens n’est-ce pas darling ». Ce sont ainsi : « Gens de peu pauvres et puants », « marmaille infâme » parmi les « tristes odeurs de bouffe » et je m’arrêterai là, avec les résurgences aborales de ces odeurs, mais que, par endroits, aèrent ou relèvent un peu de suggestives sonorités, comme, du fond de « son grabat », cette vieille femme « qui aimait tant jadis foutre avec fougue ». Autant d’amertume comme paradoxalement adoucie par de gouailleurs basculements de registre. Je vous laisse les lire, ou plutôt les entendre, en ressentir la sombre affliction. Et pousser jusqu’à la chansonnette faussement légère des « Trois gamins sur la butte », fouillant le sable sale. Et puis, tournant la page, jusqu’à l’émouvant hommage à « Une mère » dont le mot « courage » n’est pas séparable, ici non plus, dans ce théâtre de l’intime traversé par la guerre, la mort et la folie. « Les malheurs l’ont noyé sous la pluie / Notre mère, touchée, s’est un peu plus tordue. » Le désespoir trouvera son « refuge » avec un « Sonnet sur le mode ancien », venu clore cette section amère, comme dans un temps inguérissable.
Il faudra bien pour s’en remettre la secousse d’un rajeunissant coup de foudre, assorti au passage d’un coup de coude verlainien, avec le « Monday blues » inaugurant la section suivante, et s’accrocher à un « amour si grand qui pousse en nous / Comme une liane dans la jungle ». Et ce d’autant plus que nous menace encore, au bout du compte, dans toute passion, le trop-plein d’un manque insatiable, « un manque d’elle », d’autant plus que nous déchire une séparation dans le contact même des corps, auxquels la mort confère en dernier lieu – à la va-vite et lesquelles, bon sang ! – des ailes. C’est le thème, cruel, risqué, de ce poème intitulé « Motomatique », acceptant qu’il s’agisse bien là de ce qui peut attendre un pareil appel d’air d’un sexe à l’autre, quand la griserie de l’air, ici la vitesse grisante, mal maîtrisée, d’une escapade à moto peut si vite se transformer, au détour d’un virage, en « un grand oiseau noir une frégate la gorge rouge de sang ». Une mort mécanisée « des amants enfin réunis », dit le poème. Enfin réunis ? Serait-ce que cette union finale des amants, dans la mort, viendrait remettre en cause leur étroit contact dans la vie, et l’ultime enlacement de leurs deux corps assis sur la même selle de moto en l’occurrence, avant l’accident, l’envol dans le virage.
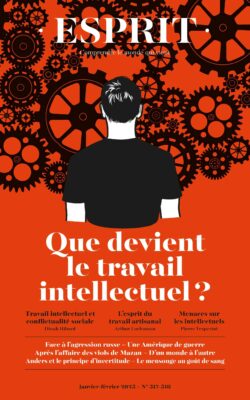 Le recueil est par ailleurs agrémenté de mystérieux collages syntaxiques, mesurés, contraints, à l’accroche envoûtante, comme « Sur son rêve étendu le lac », où quelque troubadour vient dire, sans vraiment le dire bien sûr, ce qu’il a sur le cœur. On ne peut que souligner à propos combien il est insistant qu’à travers le recueil, par fantaisie, refus de se prendre au sérieux, les textes se prêtent au jeu de l’amour courtois, y recrutant jusqu’à son lexique, mais avec une sorte d’à-côté narquois, un décalage tel que le je tire l’épingle de son jeu comme il le peut dans sa remontée du temps jadis, fût-elle bien ébrieuse comme avec cette « Fantaisie éthylique et pentasyllabique », où passent Rabelais, Villon, Louise Labé, « gentilles personnes » que le je, envahi d’un doute en les apostrophant, se remémore : « Comment vous riiez / Aimiez et pleuriez / Tout est dans les livres / Si j’étais poète / j’y serais aussi. » L’humeur est à l’inévitable distance, à la nostalgie haussée jusqu’à nous, et permet aussi cette belle évocation épurée, surgissant de « Galimatias » et qui vous a un air attendri d’antan : « Elle est assise au coin de l’âtre / La grand-mère toute chenue /Elle se rêve belle et nue /Caressée par les mains du pâtre. »
Le recueil est par ailleurs agrémenté de mystérieux collages syntaxiques, mesurés, contraints, à l’accroche envoûtante, comme « Sur son rêve étendu le lac », où quelque troubadour vient dire, sans vraiment le dire bien sûr, ce qu’il a sur le cœur. On ne peut que souligner à propos combien il est insistant qu’à travers le recueil, par fantaisie, refus de se prendre au sérieux, les textes se prêtent au jeu de l’amour courtois, y recrutant jusqu’à son lexique, mais avec une sorte d’à-côté narquois, un décalage tel que le je tire l’épingle de son jeu comme il le peut dans sa remontée du temps jadis, fût-elle bien ébrieuse comme avec cette « Fantaisie éthylique et pentasyllabique », où passent Rabelais, Villon, Louise Labé, « gentilles personnes » que le je, envahi d’un doute en les apostrophant, se remémore : « Comment vous riiez / Aimiez et pleuriez / Tout est dans les livres / Si j’étais poète / j’y serais aussi. » L’humeur est à l’inévitable distance, à la nostalgie haussée jusqu’à nous, et permet aussi cette belle évocation épurée, surgissant de « Galimatias » et qui vous a un air attendri d’antan : « Elle est assise au coin de l’âtre / La grand-mère toute chenue /Elle se rêve belle et nue /Caressée par les mains du pâtre. »
Et ce, alors même qu’aujourd’hui « On est les rois de la technique / On a des autos qui font vroum / Des grosses bombes qui font boum », et qu’avec « Misères », la dernière partie du recueil, toutes les misères du monde, en effet, défilent dans les évocations aussi déprimantes qu’enjouées de nos enfermements humains, nos certitudes cimentées, nos bassesses, nos effrois, nos « amours défuntes ». (Notons-le au passage, l’éventuelle liberté des poèmes, le vers jamais libre en définitive quelle que soit l’apparence qu’il se donne, tout ce frivole-là ne semble plus avoir droit de cité devant la sévérité du propos qui cherche une métrique plus raide.) Mais l’adieu, alerte, au lecteur se fait tout de même sur une chanson, où la jupe de l’amante et l’oiseau de mer peuvent, au-dessus de toute grise lourdeur, échanger leur mouvement, leur légèreté.
Le livre refermé, il se dégage au fond, un peu floue, un peu trouble sous vos yeux, comme la silhouette enfouie, intrinsèque ou intériorisée, aux contours esquissés çà et là d’un poème à un autre, de quelque chose de discret et presque silencieux, de retenu, qui tiendrait un peu d’une contre-figuration temporelle et verbale, et ferait presque penser à ces « contre-livres » complémentaires sans lesquels, ainsi que Borges l’inclut dans l’une de ses philosophies imaginaires, il n’y aurait pas de livre complet ni, peut-être, ici, quand il n’est plus question de livre seulement, de fresque aboutie.
Michel Herland, L’Homme qui voulait peindre des fresques, Paris, Andersen, 2023, 136 p., 14,90 €.

