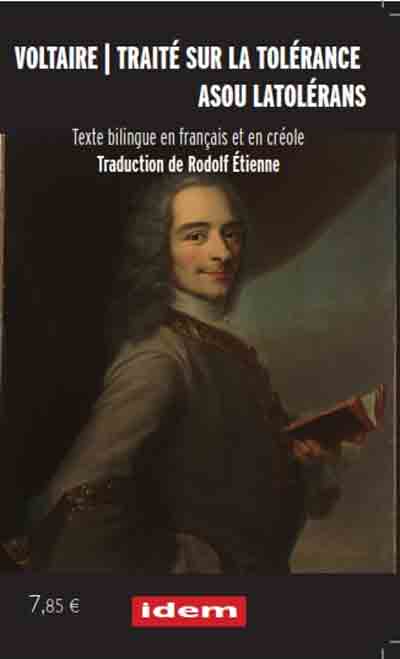
A l’occasion de la publication du Traité sur la tolérance » de Voltaire qu’il a traduit en créole Rodol Étienne nous a accordé un entretien.
Madinin’Art : Le Traité sur la tolérance connaît un succès de librairie non démenti à ce-jour, suites aux attaques terroristes qui ont bouleversé la France en 2015. Vous publiez aujourd’hui une traduction en créole. La première question qui vient est : quelle nécessité avez-vous éprouvée pour ce faire?
Rodolf Étienne : Ce texte est une commande de l’éditeur Idem Editions. Son directeur, qui est un ami personnel et pour qui j’ai un grand respect pour son engagement littéraire et éditorial, m’a présenté le texte en me demandant si cela m’intéresserait. Et c’est à partir de là que tout semble provenir de la magie. Parce que ce texte, après ma première lecture, répondait parfaitement aux questionnements liés à la langue, sur plusieurs aspects essentiels, que je me posais justement. J’étais justement en pleine réflexion et écriture d’un colossal exposé sur les problématiques de traduction créole que je devais présenter à l’Université Birmingham en Angleterre. Le projet n’a pas abouti, je me suis consacré à la traduction du Traité sur la Tolérance. C’était littéralement époustouflant de se rendre compte que les problématiques abordées par Voltaire, pour ce qui concerne exclusivement la langue et le rendu du discours – dans sa fidélité à la pensée de l’auteur et du message essentiel qu’il souhaitait faire passer – était similaire aux problématiques de l’auteur créole moderne. Trois siècles nous séparaient, mais les états de la langue coïncidaient parfaitement. Il était essentiel pour Voltaire, impérieux même, de découvrir un nouveau langage, une nouvelle manière de dire et d’écrire le français, pour subvenir aux nécessités de son discours, qui lui aussi tendait à l’innovation des idées. Et le Traité, qui porte bien son nom, est un exemple de parfaite réussite d’une avancée de la langue dans l’écrit et dans sa fidélisation aux attentes du plus grand nombre, non seulement dans sa compréhension immédiate, mais surtout dans sa faculté à rendre compte des réalités humaines dans leurs plus profonds signifiants. Ce texte était donc parfait pour une aventure rocambolesque, je veux dire sur le plan littéraire, une percée dans la langue de l’écrit, une percée dans le monde des idées que peut véhiculer la langue créole, pour ce qu’elle a de jeune et de contrainte. Par ailleurs, traiter du thème du fanatisme aujourd’hui comme hier, et en l’occurrence ici, du fanatisme religieux, nous réclame d’être vigilants à propos de tous les fanatismes et pas seulement envers ceux qui défraient la chronique. Voltaire n’épargne personne, aucun groupe religieux ne sort indemne du Traité, toutes sont épinglées. Lorsque l’on sait que Voltaire était un adogmatique, franc-maçon tardif, on saisit encore mieux les nuances de son langage et de son discours. Si le texte a du succès aujourd’hui, c’est surtout parce que le monde se sent menacé dans tous ses fondamentaux, dans ces invariants nous dirait Glissant. Ce n’est pas seulement la peur islamiste qui alimente le monde moderne : la peur est permanente et justifiée par la prise de conscience par l’homme de son immense fragilité dans la totalité de l’univers qui l’entoure, de sa petitesse cosmique et de l’inévitable chaos qui le menace.
M’A: En quoi donc la France de 1763 a-t-elle des traits communs avec les théocraties contemporaines?
R.É. : Encore une fois, Voltaire ne stigmatise pas tel pays, telle religion, telle église, telle théocratie. Tout le monde en prend pour son grade. La France est la première visée parce que l’affaire Calas, qui est le prétexte au développement des idées de Voltaire sur la tolérance, défraie la chronique à cette époque. Mais si on y regarde bien, la période de temps brassée par l’imaginaire de Voltaire n’est pas si facilement identifiable qu’on pourrait le penser. Ainsi les monarchies européennes de son époque ou de naguère, les républiques de l’antiquité, la papauté, le protestantisme Anglican, les autres religions du monde, passé ou présente du temps de l’auteur, tout ce beau monde est passé au crible de la critique acerbe de l’auteur. En 1763, la France et beaucoup d’autres monarchies d’Europe baignait dans la plus abjecte barbarie, avec des pratiques de répression et de contrôle du pouvoir d’une violence sans précédent. C’est ce qui fait réagir Voltaire, tout autant en tant qu’auteur que philosophe, mais aussi en tant qu’homme tout simplement. La barbarie de l’état et de la religion est partout présente en Europe. Les théocraties contemporaines comme les gouvernements plus généralement, semblent eux aussi englués dans un marasme de la pensée, des idées et des volontés. Il ne faut pas non plus perdre de vue, bien sûr, la pression exercée par le monde occidental sur le reste du monde, et dans le domaine de la religion en particulier, sans nier le poids global des dogmes sur les mentalités humaines, sans là porter le jugement sur le principe des valeurs, bien sûr.
M’A : Le ton parfois enflammé de Voltaire dans son éloge de la tolérance ne contient-il pas aussi des envolées haineuses notamment dans le solide anti-judaïsme qu’il profère si souvent?
R.É. :Oui, c’est le reproche généralement fait à Voltaire, d’avoir pêché sur le judaïsme comme sur le droit ou la place des femmes dans la société, engagement – des femmes – dont ce sont les prémices. Sans parler, bien sûr, de l’esclavage, dont il ne parle pas du tout, ce dont on peut aussi lui faire griefs. Mais, dans l’ensemble, et nonobstant ces questions qui sont des questions certes d’une actualité vive au temps de l’auteur, Voltaire rempli sa mission de tolérance. Le chercheur curieux, aura tenté de comprendre l’auteur même dans ses travers et se sera surpris à admettre, non pas l’antisémitisme, ni le racisme ou le différentialisme que l’on reproche généralement à Voltaire et à cette œuvre en particulier, mais bien une incapacité de l’auteur à dépasser, pour le coup, les aléas de son temps et de son époque, et certainement à se dépasser lui-même sur ces questions-là, en particulier. A mon humble avis, si la critique est justifiée – on peut difficilement nier l’acharnement de Voltaire sur ces questions, soit par son silence ou son mutisme, soit par sa fougue ou son ton enflammé – le génie de l’auteur, nous invite à d’autres pistes d’analyse et de perception, dès lors que l’on reconnaît cette expérience littéraire comme une vraie expérience humaine, une vraie rencontre, un vrai partage, laissant libre à l’auteur une part de son intime ou tout du moins portant sur cette part de son intime un regard plus analytique, plus condescendant, plus respectueux, en définitive, plus compréhensif. A charge pour l’auteur, dans ce cadre privilégié que lui offre le lecteur – cette compréhension ? – de se dévoiler dans ses vérités refoulées. Là-dessus, Voltaire, l’homme comme l’auteur, tout autant que son œuvre en en particulier le Traité sur la Tolérance, sont véritablement des invites en même temps que des leçons de tolérance.
M’A: Le lecteur créole n’est-il pas aussi et d’abord un lecteur francophone? Ne dit-on pas qu’il faut préférer l’original à la traduction?
R.É. : La littérature est une matière sérieuse. Elle engage des phénomènes de la pensée et du discours qui sont d’un ordre essentiel pour la maturation et le développement de la pensée collective. Je veux parler de la mémoire comme de la psychè, ou mieux encore d’un projet littéraire collectif. Projet littéraire que d’aucuns ont construit comme une quête de l’authenticité, de la vérité de notre identité et de son rendu littéraire. Ces auteurs ont laissé une marque, une empreinte sur le tracé des lettres créoles ou antillaises où le bilinguisme est une réalité non seulement du champ de l’écrit, mais plus généralement en rapport avec la mémoire collective, qui elle aussi est engagée dans ce même bilinguisme. A partir de là, c’est le choix du lecteur qui décidera en définitive. Pour sa part, l’auteur, lui, aura répondu aux injonctions de son temps. Malheureusement, dans notre contexte, nous avons affaire à un lecteur quasi analphabète en créole, et cela en dehors de tous les clivages qui minent par ailleurs la société créole. L’analphabétisme créole, qui n’est une réalité que si on veut bien la concevoir, est un phénomène qui affecte toutes les couches de la société créole, sauf l’auteur créole ou le traducteur. A partir de là on comprend certainement mieux la position de l’écrivain antillais qui s’engage à défendre le patrimoine littéraire créole, sans que le lecteur créole ne soit de nos jours encore, pour lui l’auteur, une réalité tangible, brimé qu’il est – le lecteur créole – par des phénomènes connus et décrits à travers la notion familière de la diglossie et de ses atavismes. Il faut bien comprendre que les réalités de l’auteur créole, vis-à-vis du texte à composer ou à traduire, sont très largement au-delà des réalités intellectuelles du lecteur créole qui n’existe pas, je veux dire en tant que forme dynamique. Le lecteur créole est aujourd’hui encore une contrainte qui s’oppose au développement de la littérature créole, parce que ce lecteur est analphabète pour ce qui concerne la langue qu’emploie l’auteur créole. Alors, préférer l’original à la traduction ? Certainement ! Tant que la traduction n’existe pas. Sinon, le lecteur averti, le bon lecteur, n’hésite pas et se familiarise sans complexes, sans à priori, avec passion en définitive avec les deux versions du texte, cela pour autant qu’il maîtrise l’une et l’autre, la langue d’origine et la langue de destination. Sinon, ce ne sont que prétexte pour éviter un exercice vécu comme une tragédie, une impossibilité, une incurabilité.
M’A : Si toute traduction est une trahison, quelles sont celles qui vous semblent les plus grandes et à quoi sont-elles dues?
R.É. : La plus grande des trahisons du traducteur serait de s’accaparer l’œuvre de l’auteur à des fins qui sont contraires aux discours de l’œuvre ou de l’auteur. Les mauvaises traductions existent, mais lorsqu’elles existent elles sont les œuvres de mauvais traducteurs et ne défraient généralement pas la chronique. Cependant, il arrive aussi que ce soit la critique qui soit mauvaise ou animée d’un mauvais esprit vis à vis d’un auteur et/ou de son traducteur, décidant arbitrairement que telle ou telle œuvre n’est pas bonne pour telle ou telle raison, fallacieuse bien évidemment. Dans notre cas, la trahison ne vient pas de l’auteur ou du traducteur créole, mais bien d’un lectorat qui n’existe pas, d’un lecteur qui n’existe pas et qui s’invente mille et une raisons pour ne pas lire en créole, ou ne pas lire le créole, préférant demeurer dans une relation bien sûr de conflit avec la langue créole, ne mesurant pas les enjeux véritables d’un tel sacrifice de la mémoire et de la cognition du langage et du discours. Il y a pourtant les mauvaises traductions qui peuvent résulter, en dépit d’une bonne volonté de l’auteur comme du traducteur, d’un manque de connaissances ou d’une méprise pure et simple de la culture de destination comme de la culture d’origine du texte. On peut aussi imaginer une mauvaise traduction comme d’un rendu inachevé dans une langue de destination qui n’est pas encore prête à recevoir ou accueillir tel ou tel discours. Mais, pour ce qui est de la langue créole, les traductions sont généralement de bonne, voire de très bonne facture, avec un lectorat et une critique, en l’occurrence, qui eux, ne sont pas préparés à de tels exercices : l’exercice de la lecture créole.
M’A : Et quid de l’imparfait du subjonctif traduit en créole?
R.É. : Je n’ai jamais été intéressé par cette problématique particulière, bien qu’elle ait pu passionner les linguistes. Je sais simplement que le créole répond à des normes du langage et du discours qui lui sont propres et que la littérature créole, pour sa part, doit se construire à partir de ces normes particulières. Après, les débats de clochers ou de chapelles m’intéressent peu en tant que traducteur. Je tente pour ma part de mener un travail sérieux et efficace, plus pertinent à mon avis que des débats de clochers sur telle ou telle question. D’autant que la langue créole comme toutes les autres langues de l’écrit se construit sur plusieurs générations de locuteurs, d’auteurs comme de traducteurs, ravalant chaque fois que nécessaire les difficultés inhérentes à son système de codification ou d’expression pour atteindre à l’original de l’intimité humaine dans ses variantes expressives les plus complexes. “Laissons le temps au temps, disait Glissant, et la langue créole se fixera d’elle-même dans l’écrit, inspirée par les auteurs, qu’elle aura elle-même, fatalement, inspiré”. Je le cite de mémoire. Le vrai enjeu est là, dans l’écrit plutôt que dans la recherche systématique ou systémique de complexes ou de conflits au cœur de la langue pour telle ou telle justification de rejet ou de renoncement. Il faut oser la langue créole dans l’écrit et elle se dévoilera d’elle-même gommant ses propres aspérités à mesure du temps et de la volonté de ses locuteurs.
M’A : Vous avez traduit d’Alain Guédé (Le Chevalier de Saint-Georges), illustré par Serge Hochain, en littérature de jeunesse, d’Edouard Glissant (Les Indes et Monsieur Toussaint), d’Aimé Césaire (La Tragédie du roi Christophe). Quel est le fil conducteur de ce travail? Lequel vous a semblé le plus difficile à traduire et pourquoi?
R.É. : Le travail de traduction le plus difficile a été sans conteste à ce jour la traduction de Les Indes d’Edouard Glissant. D’une part, parce que c’était la première que je tentais en vue d’une publication et puis aussi parce que il s’agissait de poésie pure, sans parler du ton épique du texte. De plus, la poésie de Glissant est dotée d’une métrique bien particulière, dans la mesure où Glissant sait se jouer des syllabes et de leurs diverses sonorités. Il fallait tout inventer ou réinventer : un vocabulaire, une grammaire, une syntaxe, mais pas seulement, il fallait aussi découvrir un rythme, un rythme créole – je veux dire un débit dans l’écrit, une métrique singulière – qui soit capable d’envisager le langage dans cette mesure particulière du texte poétique et épique et du langage singulier de Glissant. C’est comme si on décidait de traduire Cahier d’un retour au pays natal d’Aimé Césaire. Ce serait, sans nul doute, un vrai challenge pour le traducteur. On peut aussi signaler les traductions de la Bible comme des expériences enrichissantes pour la langue de destination comme pour les locuteurs et lecteurs, mais surtout sur le plan strict de la littérature, par la variation des langages ou des niveaux de langues que l’on est amené à présenter. A l’inverse, la traduction la plus simple, la plus facile, a été celle de La Tragédie du Roi Christophe d’Aimé Césaire. A ce titre, je tiens à préciser que, contrairement à ce qui est dit dans le dossier de présentation de l’ouvrage – que l’on peut trouver encore sur Internet – l’idée de la traduction est de moi – d’ailleurs, je côtoyais Césaire depuis plusieurs années, lorsque j’ai contacté Caraïb’Editions – et non pas de l’éditeur, qui en la matière manquait infailliblement de culture comme de contacts d’ailleurs. Cela mérite d’être rappelé pour rendre justice à l’auteur comme au traducteur, lorsque l’on connaît les réalités de l’édition aux Antilles et en particulier, aux Antilles françaises : Guadeloupe, Martinique, mais également, plus généralement encore en Guyane comme à la Réunion. Nonobstant la difficulté ou la facilité, l’exercice de la traduction est toujours très enrichissant. La relation intimiste qu’elle permet avec la pensée d’auteurs majeurs est inévitablement un facteur d’émulation, tout autant pour l’auteur, le traducteur que la langue elle-même dans une dynamique de développement et de valorisation qui trouve ainsi un terreau fertile. Encore une fois, ne reste aux auteurs créoles qu’à trouver le lecteur créole. Là, le débat est ouvert…
Rodolf Etienne
Journaliste – Auteur
rodolfetienne_at_yahoo.fr
0696820247
Facebook : rodolfetienne
Propos recueillis par Roland Sabra.
