Réflexions, le site de vulgarisation de l’Université de Liège du 28/02/12
 Faut-il sanctuariser telle ou telle catégorie de la société -les Juifs, les Arméniens, les descendants d’esclaves africains, etc. – en donnant à chacune la satisfaction d’une loi mémorielle qu’elle pourrait avoir de bonnes raisons de revendiquer ? Appartient-il à l’autorité politique de définir la vérité historique sur certains traumatismes du passé pour préserver, sous la menace de sanctions pénales, la mémoire collective ? Ne risque-t-on pas, ce faisant, d’attiser les conflits de mémoires ? Telles sont quelques-unes des questions cruciales, et très actuelles, qu’aborde La concurrence mémorielle (1), un ouvrage collectif sous la direction de Geoffrey Grandjean et Jérôme Jamin.
Faut-il sanctuariser telle ou telle catégorie de la société -les Juifs, les Arméniens, les descendants d’esclaves africains, etc. – en donnant à chacune la satisfaction d’une loi mémorielle qu’elle pourrait avoir de bonnes raisons de revendiquer ? Appartient-il à l’autorité politique de définir la vérité historique sur certains traumatismes du passé pour préserver, sous la menace de sanctions pénales, la mémoire collective ? Ne risque-t-on pas, ce faisant, d’attiser les conflits de mémoires ? Telles sont quelques-unes des questions cruciales, et très actuelles, qu’aborde La concurrence mémorielle (1), un ouvrage collectif sous la direction de Geoffrey Grandjean et Jérôme Jamin.
Le 22 décembre 2011, à Paris, l’Assemblée nationale adoptait en première lecture une proposition de loi de la députée Valérie Boyer (UMP) visant à réprimer « la contestation des génocides établis par la loi ». Le Sénat faisait de même le 23 janvier, mais la Cour constitutionnelle a invalidé le texte de cette loi le 28 février 2012. En France, deux génocides sont reconnus légalement : la Shoah – dont le négationnisme était déjà sanctionné par la loi Gayssot (13 juillet 1990), ainsi que le génocide des Arméniens (loi du 29 janvier 2001) qui a fait un million et demi de morts entre 1915 et 1917. Contester ou minimiser ce dernier sera donc également punissable dans l’Hexagone: jusqu’à un an de prison et 45.000 euros d’amende. Ce texte a déjà suscité son lot de réactions courroucées. Avec, en prime, des menaces de rétorsions économiques de la Turquie et des cyberattaques de hackers turcs contre de nombreux sites français (ceux de l’Assemblée nationale, du Sénat et de l’UMP, notamment). En France, la communauté d’origine arménienne est estimée à quelque 400.000 personnes, pour une population d’origine turque quasi comparable… Ces deux communautés ne mobilisant pas du tout – faut-il le préciser ? – la même mémoire collective, cela donne lieu à des formes de concurrence, voire de conflit, de plus en plus aiguës. En votant cette nouvelle loi mémorielle, les élus français ont en tout cas réenclenché un « engrenage périlleux » (2). Car, si la France reconnaît deux génocides, les Nations unies en reconnaissent deux de plus : celui perpétré par les khmers rouges au Cambodge (entre 1975 et 1979), et celui des tutsis, commis au Rwanda en 1994. La simple reconnaissance par la France de ces deux autres massacres impliquerait mécaniquement que la loi s’applique à eux. Ce qui ouvrirait la voie à des querelles explosives, s’agissant en particulier du cas rwandais, dans lequel le rôle de l’Etat français doit encore être élucidé. La Belgique a déjà légiféré, rappelons-le, en ce qui concerne le génocide des Juifs. La loi du 23 mars 1995 en réprime la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation. Par contre, les propositions de loi visant à réprimer le négationnisme du génocide des Arméniens n’ont pas abouti jusqu’à présent. Seule une résolution a été adoptée par les sénateurs belges, le 17 mars 1998, invitant « le gouvernement turc à reconnaître la réalité du génocide perpétré en 1915 par le dernier gouvernement de l’empire ottoman ».
Chez nous, 150.000 personnes se réclament d’ascendants turcs, alors que la communauté arménienne ne dépasse guère les 10.000 individus (3). Précisons qu’en Belgique, le droit de voter aux élections communales a été accordé en 2004 aux étrangers non européens. Les controverses mémorielles ne sont donc plus exemptes de préoccupations électoralistes. Le débat politique autour de la sanction pénale du négationnisme est loin d’être clos. Il risque même de s’exacerber, en France comme en Belgique, a fortiori lorsqu’il porte sur des faits qui ne se sont pas déroulés sur leur territoire, à l’instar du génocide arménien.
Un livre qui vient à point
L’ouvrage dont il est question ici, La concurrence mémorielle, arrive donc à point nommé. Il montre que les intellectuels veulent eux aussi prendre part au débat, en le recontextualisant d’abord, en rappelant ensuite et fort opportunément, que « l’histoire ne doit pas être l’esclave de l’actualité politique ni s’écrire sous la dictée de mémoires concurrentes » (1). En proposant enfin quelques pistes pour sortir de la crise qui se développe entre histoire et mémoire. Chez nous, comme en France, beaucoup d’historiens s’inquiètent de la généralisation de ces lois dites mémorielles, voire la désapprouvent. Pierre Nora, qui préside l’association « Liberté pour l’histoire », critique même vertement ce sport législatif purement français qui ouvre la voie « pour toute mise en cause de la recherche historique et scientifique par des revendications mémorielles de groupes particuliers puisque les associations sont même habilitées par le nouveau texte (loi Boyer) à se porter partie civile » (2). « Faut-il rappeler, conclut-il, que c’est l’histoire qu’il faut d’abord protéger, parce que c’est elle qui rassemble, quand la mémoire divise ?».
Face aux lectures simplificatrices du passé, quelques digues ont été érigées. L’appel des historiens du Comité de vigilance face aux usages publics de l’histoire en est une. Il s’adresse autant au législateur qu’aux médias. Nous en avons assez d’être constamment sommés de dresser des bilans sur les aspects « positifs » ou « négatifs » de l’histoire, peut-on y lire. Ces discours ne tiennent compte ni de la complexité des processus historiques, ni du rôle réel qu’ont joué les acteurs, ni des enjeux de pouvoir du moment (…). La mission des historiens est d’élaborer et (…) transmettre des connaissances rigoureuses sur le passé. C’est d’ailleurs dans le même état d’esprit que se situe d’emblée Georges Bensoussan (3), en préface du livre La concurrence mémorielle. Pour lui, la mémoire est trompeuse et n’obéit pas à un souci historien. « L’image que nous nous faisons du passé n’est pas le passé, ajoute-t-il, ni même ce qu’il en reste, mais seulement une trace changeante de jour en jour, une reconstruction qui n’est pas le fruit du hasard mais relie entre eux des îlots de mémoire surnageant dans l’oubli général »
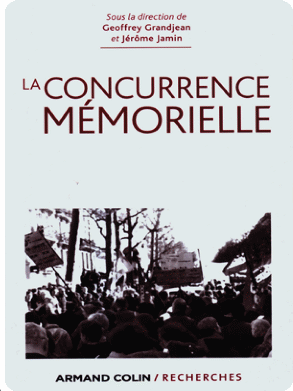 Les deux chevilles ouvrières de l’ouvrage, Jérôme Jamin et Geoffrey Grandjean, réfléchissent ensemble à ces questions au sein du Département de science politique de l’Université de Liège, où le premier est chargé de cours et le second aspirant du FNRS. Les recherches de Jérôme Jamin portent sur le populisme, le nationalisme et l’extrême-droite en Europe et aux Etats-Unis. Geoffrey Grandjean, lui, consacre sa thèse de doctorat aux conséquences des connaissances génocidaires sur les formes de socialisation politique. « Nous avons le sentiment très net, expliquent-ils, que la concurrence mémorielle est le point de départ – et non d’aboutissement, de beaucoup de problèmes de société. Notamment à l’école… Le télescopage médiatique autour des questions de mémoires peut avoir des effets désastreux sur les jeunes. Nous pensons d’ailleurs que la concurrence mémorielle est un concept pertinent depuis qu’existe une hyperinflation médiatique sur ce thème. »
Les deux chevilles ouvrières de l’ouvrage, Jérôme Jamin et Geoffrey Grandjean, réfléchissent ensemble à ces questions au sein du Département de science politique de l’Université de Liège, où le premier est chargé de cours et le second aspirant du FNRS. Les recherches de Jérôme Jamin portent sur le populisme, le nationalisme et l’extrême-droite en Europe et aux Etats-Unis. Geoffrey Grandjean, lui, consacre sa thèse de doctorat aux conséquences des connaissances génocidaires sur les formes de socialisation politique. « Nous avons le sentiment très net, expliquent-ils, que la concurrence mémorielle est le point de départ – et non d’aboutissement, de beaucoup de problèmes de société. Notamment à l’école… Le télescopage médiatique autour des questions de mémoires peut avoir des effets désastreux sur les jeunes. Nous pensons d’ailleurs que la concurrence mémorielle est un concept pertinent depuis qu’existe une hyperinflation médiatique sur ce thème. »
Ce concept qu’ils ont forgé, Jérôme Jamin et Geoffrey Grandjean pensent qu’il ouvre des perspectives pluridisciplinaires dans l’analyse de l’usage généralisé de la mémoire à des fins politiques. Contrairement à l’histoire-connaissance, énoncée par un historien selon des méthodes scientifiques, la mémoire (collective) renvoie au partage d’expériences historiques communes. Elle est une reconstruction d’une portion du passé, choisie de manière arbitraire. Elle n’existe que par la visée qui lui est assignée – construire, par exemple, une identité collective – et elle est forcément plurielle. Dans chaque société, il y a autant de mémoires collectives qu’il y a de groupes ou de communautés.
Même si elle est fondée sur les sentiments les plus nobles, les aspirations démocratiques les plus élevées – il s’agit de combattre la négation des pages les plus noires du siècle passé, les lois mémorielles assurent-elles pour autant la paix civile ? On peut en douter, expliquent Jérôme Jamin et Geoffrey Grandjean. Contestées dans leur efficacité, on les accuse aussi d’entraver la liberté de la recherche. Il était donc utile de rassembler en un même ouvrage l’analyse de plusieurs chercheurs qui travaillent sur cette question…

Une pléthore de mémoires
La sociologue Régine Robin (Professeure associée au Département de sociologie de l’Université du Québec à Montréal) aborde la concurrence mémorielle dans le cadre français. Après s’être penchée sur les polémiques autour du communautarisme et du port du foulard à l’école, elle constate que « la France semble avoir perdu le grand récit de ses origines à partir des années 1960, sous les coups de boutoir de la modernité, des retombées de la guerre d’Algérie ou encore de l’entrée des sciences humaines dans les interrogations et questionnements de l’école ». Selon elle, ce pays a dû faire face à une fragmentation de sa mémoire par l’émergence d’autres mémoires, dans un contexte de débat permanent autour de la présence accrue sur son territoire de populations immigrées. La France, insiste-t-elle, a véritablement connu un changement d’époque, au cours du demi-siècle écoulé. L’ancien passé glorieux est souvent devenu « un passé piteux où plus aucun événement historique ne se trouve digne d’être commémoré sans controverse ». Sans compter les chapitres longtemps négligés ou marginalisés dans l’histoire officielle : le rôle de Vichy dans la déportation des Juifs de France, l’ampleur de la collaboration en 1940-45, les déchirements de la guerre d’Algérie ou de celle d’Indochine, etc. Ce passé récent trouble et divise. En émerge aujourd’hui toute une série de mémoires concurrentielles, qui demandent à leur tour de trouver place dans les replis du « roman national ». Roman national que les autorités françaises, président de la République en tête, voudraient à présent « revivifier » pour contrer la France plurielle qui s’affirme. Et cela, dans une atmosphère que Régine Robin n’hésite pas à qualifier d’ « irrespirable » : on ne peut pas à la fois rendre « la fierté » aux Français en magnifiant l’Eglise et la France des vieux clochers, en faisant comme si la Révolution française n’était qu’une péripétie sanglante, que le régime de Vichy n’avait pas existé, et en même temps, prôner le métissage culturel et la France de la diversité. On ne peut pas à la fois parler des Lumières et de la laïcité tout en les remettant en question à tout bout de champ, », écrit-elle.
Gare aux visions simplificatrices !
D’un point de vue théorique, la concurrence mémorielle renvoie souvent à la compétition complexe et parfois douloureuse entre des groupes sociaux (entre eux ou vis-à-vis d’une autorité) pour défendre et promouvoir le souvenir de certains faits historiques. Elle se manifeste particulièrement au niveau de l’usage du mot génocide, un terme qui connaît depuis quelques années une « inflation boursouflée ». Le caractère totalement idéologique et principiel de l’extermination des Juifs par le régime hitlérien fait qu’on la considère généralement comme « un génocide sans précédent, paradigmatique et absolu » (Joël Kotek, Chargé de cours à l’Université Libre de Bruxelles). La Shoah (génocide des Juifs par les nazis) est l’un des fondements de la culture européenne d’après-guerre. Sa singularité a façonné dans la douleur l’identité des Européens dans leur relation à l’histoire et à la mémoire. C’est le sens même des débuts de la construction européenne.
Comme le souligne l’historien Philippe Raxhon, professeur à l’Université de Liège, la transmission de la mémoire de la Shoah fut douloureuse et donc lente, conséquence d’une expérience inédite dans l’histoire, en contrepoint d’une historiographie sur le sujet qui s’élabora elle aussi progressivement dans les décennies d’après-guerre et surtout à partir de la fin des années 70. On doit donc parler, à ce propos, d’un éveil de la mémoire, éveil stimulé sans aucun doute aussi par la remontée des populismes d’extrême droite couplée à l’antisémitisme et au négationnisme, eux-mêmes réactivés par une certaine perception des problèmes du Proche et du Moyen-Orient.
A ce propos, Philippe Raxhon dénonce sans équivoque l’accusation régulièrement portée contre l’Etat d’Israël d’instrumentaliser la Shoah à son profit politique. « L’existence d’une tension monstrueuse, au premier sens du terme, entre d’une part une extraordinaire production historienne de qualité, des avancées remarquables en matière muséologique et pédagogique, des efforts institutionnels considérables et de dimension internationale (…) ; et d’autre part, à l’opposé, un négationnisme de diverses sources, des dévoiements médiaticoidéologiques, des banalisations caricaturales, ou des comparaisons anachroniques ».
L’historien liégeois s’attarde également sur ce qu’il appelle la « globalisation de la mémoire » autour des passés coloniaux et de l’esclavage. En somme, le lieu de mémoire de la domination de l’homme par l’homme devient la planète entière, à toutes les époques confondues. Phénomène à la fois troublant et inquiétant, écrit-il, sans oublier de remarquer que certains historiens y ont eux-mêmes contribué « en déboulonnant les statues de bronze des héros du positivisme national ». La distorsion entre l’histoire et la mémoire devient déchirure, avec l’abandon des contextes et des singularités des situations historiques. Avec un risque majeur à la clef : la vision simplificatrice du passé, si caractéristique des idéologies totalitaristes. Non sans avoir mis en garde contre la prolifération des lois mémorielles « qui oriente notre modèle de société vers une conduite des affaires par les juges et non par les élus », Philippe Raxhon préconise au final de remplacer le mot mémoire par celui de patrimoine, un concept « moins lourdement chargé ». Cela permettrait de sortir de la crise entre histoire et mémoire. Et de retrouver, au passage, le chemin de la richesse et de la complexité du passé, en particulier dans la relation entre les nations, les hommes, les classes sociales, les sociétés. Histoire, en somme, de susciter un partage des mémoires…
Désenclaver l’histoire
Sophie Ernst (Professeure associée à l’Institut français d’éducation) nous invite à réfléchir sur un autre acteur important : l’école. Se focalisant sur ce qu’elle appelle « les commémorations négatives », c’est-à-dire celles qui « ne portent rien d’autre que de la douleur, la conscience de désastres irréparables », elle propose différentes pistes pour réintégrer la transmission des mémoires dans le milieu scolaire. Elle considère en effet que les jeunes ne doivent pas se retrouver écrasés sous le poids de passés traumatiques et anxiogènes – et parfois sources de conflits difficiles à gérer par les enseignants -mais davantage dans une dynamique porteuse d’espoir et d’intérêt pour l’altérité culturelle. Bref, tout autre chose qu’une martyrologie. Il vaudrait peut-être mieux, suggère-t-elle par exemple, faire découvrir aux enfants la merveilleuse culture yiddish, la musique klezmer, leur faire découvrir la culture tzigane, que de les emmener à Auschwitz, et ce serait une forme de commémoration qui en vaudrait une autre. La culture yiddish a été assassinée, mais ce qui en survit vaut la peine d’être transmis ; tziganes séduisent énormément et rappellent au monde l’existence précaire d’un peuple toujours menacé dans son existence. De même, il vaut la peine de rappeler que nous devons à l’esclavage la musique qui a révolutionné nos goûts et conquis le monde… Témoignant, en tant que chercheur, de l’investissement de nombreux professeurs dans des projets inventifs, Sophie Ernst rappelle que la mémoire s’empare du passé de façon subjective et que « c’est cette subjectivation, cette concentration sur un sujet d’affects, de désirs, de volontés, d’actes…- qui en fait la valeur pour les élèves ». Cela fait toute la différence entre une présentation de la guerre de 1914-1918, comme nous en avions l’habitude, il y a quarante ans : les causes de la guerre, les péripéties politiques, les batailles, la description du front, les conséquences et les traités de paix. Il a fallu des films de fiction, des pièces de théâtre, parfois la redécouverte de livres oubliés, pour que l’on reprenne conscience d’une donnée essentielle, ce qu’avaient vécu les soldats dans les tranchées, ce qui était arrivé à toute une génération de très jeunes hommes. C’est en passant par la subjectivité et le récit individuel qu’on a pu retrouver une objectivité bien plus consistante, que la description « vue d’en haut » oblitérait.
Or nos contemporains et les jeunes générations en particulier ont une demande de culture qui s’attache en priorité aux visions subjectives (que l’historien regarde avec méfiance précisément). On aurait donc tout intérêt à désenclaver l’histoire, Sophie Ernst entendant par là qu’ « on doit cesser de considérer l’enseignement d’histoire comme seul ou principal concerné ». La mémoire comme telle, en tant que récit subjectif porteur de significations, de valeurs et d’interrogations, a toute sa place dans d’autres disciplines, notamment les enseignements littéraires et artistiques. Et d’ajouter, non sans un brin de perfidie, que « bien des contradictions vécues par les enseignants d’histoire viennent de ce qu’ils finissent par porter presque à eux seuls toutes les demandes adressées à l’ensemble d’un curriculum de culture humaniste ». C’est une chose de faire comprendre comment des processus historiques se sont produits, comment des configurations sociales se sont mises en place et ont permis des enchaînements désastreux, et c’en est une autre d’éduquer des enfants et des adolescents à rejeter le racisme et l’antisémitisme. On relèvera aussi que Sophie Ernst plaide pour l’instauration de tiers lieux pédagogiques, du type « ciné-philo », pour l’éducation morale et civique des jeunes. Elle recommande aussi l’intégration dans les parcours éducatifs des productions télévisuelles de qualité, en ajoutant – sans doute, avec un peu trop d’optimisme que « la caution éducative importe à la direction des chaînes de télévision notamment publiques »…
Études de cas
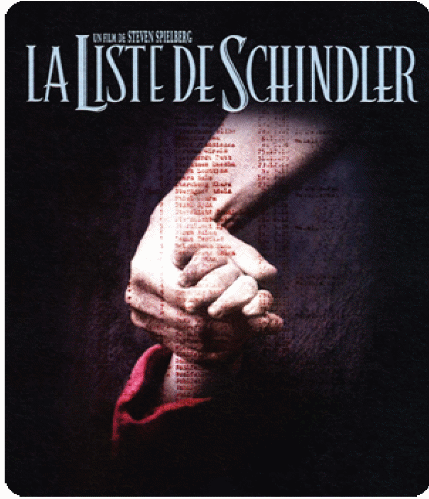 D’autres contributions intéressantes enrichissent La concurrence mémorielle. Ce sont des études de cas. Sébastien Boussois (Postdoctorant à l’IEE-Pôle Bernheim de l’Université Libre de Bruxelles) se penche sur les remises en cause, par de « nouveaux historiens israéliens », des fondements de l’historiographie traditionnelle en Israël. Giulia Fabbiano (Chercheuse associée au CADIS) s’intéresse aux « narrations du passé familial » produites par les descendants des harkis (c’est-à-dire ces Algériens ayant servi les Français pendant la guerre d’Algérie) et d’immigrés algériens nés pendant ou après cette guerre. Elle attire l’attention sur le fait que ces narrations ne sont pas nécessairement sources de concurrence. Louis Bouza Garcia (Doctorant l’Université Robert Gordon d’Aberdeen) traite de la « surenchère mémorielle » que semble aujourd’hui connaître l’espace public et politique européen, même si les mobilisations autour de ces enjeux restent relativement rares. En Europe, selon l’auteur, les acteurs politiques ont tendance à mettre en œuvre une « stratégie de l’oubli » pour privilégier le compromis et la construction d’une mémoire commune. Geoffrey Grandjean, enfin, s’attache à décrypter les propos que peuvent tenir les jeunes sur la thématique des génocides. Allant à la rencontre de vingt-deux focus groups (groupes de discussions) organisés avec sept écoles de l’enseignement secondaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il a notamment pu constater que les jeunes d’origine immigrée ne tendent pas plus que les jeunes Belges à relativiser les faits génocidaires. Néanmoins, précise-t-il, la concurrence mémorielle se matérialise entre la mémoire des faits qui se sont déroulés il y a une soixantaine d’années (le génocide des Juifs) et la mémoire de faits relevant d’une temporalité plus immédiate (comme le conflit israélo-palestinien). Et de conclure que cela « peut entraîner un certain repli sur soi ou à tout le moins sur sa communauté ».
D’autres contributions intéressantes enrichissent La concurrence mémorielle. Ce sont des études de cas. Sébastien Boussois (Postdoctorant à l’IEE-Pôle Bernheim de l’Université Libre de Bruxelles) se penche sur les remises en cause, par de « nouveaux historiens israéliens », des fondements de l’historiographie traditionnelle en Israël. Giulia Fabbiano (Chercheuse associée au CADIS) s’intéresse aux « narrations du passé familial » produites par les descendants des harkis (c’est-à-dire ces Algériens ayant servi les Français pendant la guerre d’Algérie) et d’immigrés algériens nés pendant ou après cette guerre. Elle attire l’attention sur le fait que ces narrations ne sont pas nécessairement sources de concurrence. Louis Bouza Garcia (Doctorant l’Université Robert Gordon d’Aberdeen) traite de la « surenchère mémorielle » que semble aujourd’hui connaître l’espace public et politique européen, même si les mobilisations autour de ces enjeux restent relativement rares. En Europe, selon l’auteur, les acteurs politiques ont tendance à mettre en œuvre une « stratégie de l’oubli » pour privilégier le compromis et la construction d’une mémoire commune. Geoffrey Grandjean, enfin, s’attache à décrypter les propos que peuvent tenir les jeunes sur la thématique des génocides. Allant à la rencontre de vingt-deux focus groups (groupes de discussions) organisés avec sept écoles de l’enseignement secondaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il a notamment pu constater que les jeunes d’origine immigrée ne tendent pas plus que les jeunes Belges à relativiser les faits génocidaires. Néanmoins, précise-t-il, la concurrence mémorielle se matérialise entre la mémoire des faits qui se sont déroulés il y a une soixantaine d’années (le génocide des Juifs) et la mémoire de faits relevant d’une temporalité plus immédiate (comme le conflit israélo-palestinien). Et de conclure que cela « peut entraîner un certain repli sur soi ou à tout le moins sur sa communauté ».
Finalement, Jérôme Jamin, dans sa conclusion, invite à interroger le rôle des médias dans ce processus de concurrence mémorielle. En effet, les images se télescopent et se bousculent, notamment à la télévision. Ainsi, les victimes d’un génocide en cours qui parfois n’est même pas encore terminé ni même nommé comme tel côtoient l’une ou l’autre commémoration de la libération d’un camp de concentration nazi quand le rappel au souvenir du tsunami japonais ou du génocide rwandais croise les victimes libyennes de la répression du colonel Kadhafi. Le résultat peut alors être catastrophique. Jérôme Jamin indique d’ailleurs que « ce qui est préoccupant avec les médias, ce n’est pas tant l’effet grossissant mais le flux continu et hasardeux d’images qui provoque de l’incompréhension et du ressentiment de tous les côtés, chacun pensant de surcroît être lésé par rapport aux autres ! ». Et de poursuivre en précisant que « compte tenu de l’impact des médias dans la construction de nos représentations, l’hyperprésence, l’absence ou le mélange malheureux d’images posent un sérieux problème pour la cohésion sociale ».
Au total, La concurrence mémorielle a le grand mérite d’ouvrir un nouveau champ de recherche en science politique. L’ouvrage offre en outre des outils de réflexion sur l’usage de plus en plus prononcé de la mémoire à des fins politiques. Il croise certes des regards essentiellement francophones, mais Jérôme Jamin et Geoffrey Grandjean envisagent déjà d’explorer d’autres univers mémoriels, anglo-saxons notamment.
(1) Grandjean G., Jamin J. (dir), La concurrence mémorielle, Ed. Armand Collin, Coll. Recherches, 2011
(2) Le Monde, « Lois mémorielles, la folle mécanique », Jérôme Gautheret, 5 janvier 2012.
(3) chiffres cités par le sénateur honoraire François Roelants du Vivier, dans une carte blanche du journal « La Libre Belgique » du 30 décembre 2011, Loi pénale et négationnisme : un combat inachevé.
(1) extrait de l’appel « Liberté pour l’histoire » (Blois, octobre 2008), signé par plus d’un millier d’historiens européens. Cet appel est porté par des historiens à l’autorité incontestable comme Pierre Vidal-Naquet ou Jean-Pierre Vernant.
(2) Le Monde, 28 décembre 2011. Pierre Nora est l’auteur notamment de « Présent, nation, mémoire », aux éditions Gallimard
(3) Historien, responsable éditorial au Mémorial de la Shoah
Lire aussi :
Lettre ouverte au Président de tous les Français
La concurrence mémorielle
Contre la (stupide) idée de « concurrence mémorielle »
« Quelques mots pour Joëlle Ursull »
La mémoire de l’esclavage n’est pas une victime collatérale de la commémoration de la Shoah!
L’extermination des Amérindiens et la déportation des Africains relèvent du génocide
Sitôt la première atteinte
« Joëlle Ursull se trompe »
Cette logique de dépendance symbolique qui régente nos imaginaires
