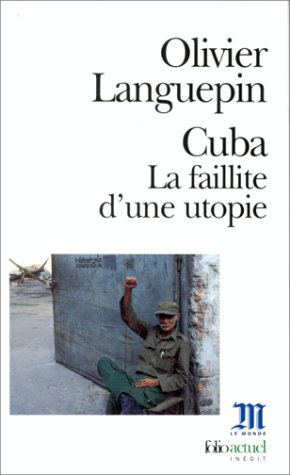
LA HAVANE, le 29 novembre (Jorge Diego Rodriguez, Cuba Press) – «Cuba: La faillite d’une utopie», d’Olivier Languepin, est une livre qui vient d’être publié en France par les Editions Gallimard.
L’œuvre comprend une interview avec Elizardo Sanchez Santa Cruz, président de la Commission Cubaine des Droits de l’Homme et de la Réconciliation Nationale, sur la situation cubaine actuelle, le rôle de l’opposition et la possibilité d’une transition.
Le livre relate aussi une conversation entre son auteur et le poète et journaliste indépendant Raul Rivero, directeur de l’agence alternative de nouvelles Cuba Press.
«Cuba: La faillite d’une utopie», publié en français, passe en revue le débâcle économique des années 90, plusieurs sujets d’aspect religieux et le traitement du gouvernement de phénomènes comme l’homosexualité, la prostitution et le sida, parmi tant d’autres.
Olivier Languepin, licencié en Sciences Politiques et journaliste, pénètre plus profondément les faits et processus qui ont servi de modèle depuis l’arrivée au pouvoir du castrisme. Il s’arrête ainsi sur le rôle du Che Guevara, la Crise des Missiles, l’exportation de la révolution, la copie du modèle soviétique et le cas Ochoa, parmi d’autres événements.
Dans cet essai, le journaliste français offre de la même manière une vision objective et mesurée de l’étape de la dictature de Batista.
Il présente en plus un portrait des personnalités du régime castriste, et une interview accordée par Ricardo Alarcon, président de l’Assemblée Nationale, au journal français La Tribune.
Traduction: Genevieve Tejera
CubaNet News, Inc.
145 Madeira Ave, Suite 207
Coral Gables, FL 33134
(305) 774-1887
**********
INSTITUT DE RELATIONS INTERNATIONALES ET STRATEGIQUES
Cuba. La faillite d’une utopie
Olivier Languepin – Paris, Gallimard, coll. Folio et Le Monde Actuel, 1999, 270 p.
Cuba est à la mode. Les touristes s’y pressent ; ils devraient atteindre, cette année, la barre des deux millions. Les diplomates aussi : la direction du personnel du Quai d’Orsay croule sous les demandes de mutation à destination de La Havane.
C’est que l’île caraïbe semble vivre une délicate transition. La chute de l’empire soviétique, la désintégration du Comecon (auquel Cuba avait adhéré en 1972) n’ont pas eu raison de la révolution castriste. Malgré la terrible récession qui a frappé l’île entre 1989 et 1993 (le PIB cubain n’a pas encore rattrapé son niveau de 1989), le Lider maximo tient toujours solidement les rênes du pouvoirs. Mieux : il semble avoir renforcé son autorité en effectuant, sur la scène internationale, une remarquable percée diplomatique. Après le pape en janvier 1998 et le premier ministre canadien, Jean Chrétien, en avril (le premier chef d’État en exercice du G7 à se rendre à Cuba), Castro a accueilli le roi d’Espagne lors du sommet ibéro-américain de La Havane de novembre 1999. Si le retour au sein de l’OEA (Organisation des États américains) se heurte au veto américain, l’adhésion de Cuba à l’Aladi (Association latino-américaine d’intégration) et au Caricom (Communauté des Caraïbes) n’est plus qu’une question de temps. Et Cuba devrait bientôt être admis au sein du groupe des pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) éligibles aux régimes préférentiels communautaires définis par la Convention de Lomé.
Pour autant, cette remarquable percée diplomatique ne doit pas cacher la crise que traverse un régime véritablement à bout de souffle. Pour faire face à la crise économique les dirigeants cubains ont mis en place, à la faveur de la «période spéciale en temps de paix», un processus dangereux. Non sans hésitations (la politique économique cubaine de cette dernière décennie a pu être comparée à la conga, une danse populaire où l’on alterne un pas en avant et un pas en arrière) s’est mise en place une timide libéralisation économique. La circulation du dollar a été autorisée, consacrant la dollarisation de fait de l’économie. Les capitaux étrangers sont acceptés et même attirés : la participation étrangère peut atteindre 100 % du capital des entreprises (mais avec l’accord de l’État à qui les salaires doivent être versés). L’initiative privée a été reconnue : des paladares, petits restaurants familiaux, se sont multipliés tandis que les petites professions indépendantes (plombiers, menuisiers, coiffeurs, taxis …), les cuentapropistas, se sont vus autorisées. Cette libéralisation économique, aussi timide soit-elle, a donné naissance à une classe moyenne (l’agence de presse officielle Granma préfère parler de «strate parasitaire qui s’enrichit et vit comme des bourgeois»), dont l’expression politique fragilisera inévitablement l’État.
La seconde inconnue qui pèse sur l’avenir cubain est celle de l’inévitable succession castriste. Né en 1926, Castro cumule les fonctions de président du Conseil d’État, de premier secrétaire du PCC et de commandant en chef des armées. Il n’est pas, à proprement parler, haï par son peuple. «Il est plus une sorte de grand-père encombrant dont on n’arrive pas à se défaire et dont on attend avec résignation la mort pour pouvoir enfin s’amuser un peu …» (Languepin, p. 239). Si personne n’ose évoquer l’après-castrisme, la question est dans tous les esprits. Une génération montante de technocrates émerge, timidement. Elle est entraînée par Carlos Lage, actuel vice-président du Conseil des ministres. Coqueluche de la presse occidentale, il est l’homme de l’ouverture économique de Cuba aux investisseurs étrangers. Derrière lui se profilent la silhouette de Ricardo Alarcon, qui a longtemps occupé les fonctions de représentant permanent auprès de l’Onu, aujourd’hui président de l’assemblée nationale du pouvoir populaire, et de Roberto Robaina, l’ancien dirigeant de l’Union des jeunes communistes, ministre des Affaires étrangères de 1993 à 1999.
Quelles sont les options possibles pour cette jeune garde ? Le constat d’Olivier Languepin est plutôt pessimiste. Cuba incarne pour lui «la faillite d’une utopie» : une économie «dans la tourmente», une société «sans certitudes» et, au bout du compte, une introuvable alternative pour une opposition émiettée. André Linard est à la fois plus optimiste et plus utopiste. Il fait d’abord, objectivement, le constat paradoxal de l’échec du régime et de l’absence d’une «attitude généralisée de révolte» (Linard, p. 50). Il parie ensuite sur l’émergence d’une société civile autonome (organisations de défense des droits de l’homme, Églises, coopératives, bibliothèques privées, embryons de presse et de syndicats indépendants…) brisant le monopole du PC.
Parier sur la capacité du régime cubain à se réformer de l’intérieur est sans doute pertinent et sage. Cela vaut incontestablement mieux que le désir de vengeance que nourrit la diaspora cubaine à Miami, il est vrai affaiblie par la disparition de son chef charismatique, Jorge Mas Canosa. Pour autant, ces analyses ressemblent trop à celles que nourrissait l’URSS dans les années 70 pour convaincre totalement. À l’époque, les kremlinologues avaient eux-aussi compté sur la capacité du communisme soviétique à se réformer de l’intérieur. N’était-ce pas là le pari de Mikhaïl Gorbachev ? Pourtant, l’Histoire allait montrer que le marxisme-léninisme n’était pas réformable (sauf à limiter, comme la Chine et le Vietnam en font l’expérience, les libertés au seul champ économique) et que les aspirations de la population à plus de liberté et de richesse l’emportent sans peine sur le gradualisme des équipes dirigeantes.
Note rédigée par : Yves Gounin – été 2000
